Emmanuel Kant
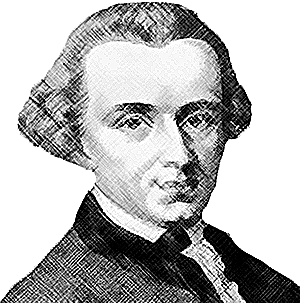
La loi pénale est un impératif catégorique. Elle est une exigence rationnelle. Elle s'impose à nous, sans considération des conditions extérieures. Emmanuel Kant n'énonce pas cet impératif catégorique de la loi pénale, comme il a énoncé l'impératif catégorique moral. Nous allons le faire à sa place, en le comparant à ce dernier. Rappelons d'abord l'impératif catégorique moral, tel qu'on peut le trouver dans les Fondements de la métaphysique des moeurs.
"Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature."
La "nature" désigne "dans le sens le plus général (quant à la forme) l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée suivant des lois universelles."
Il s'agit ici de la nature raisonnable qui existe comme fin en soi. L'impératif pratique que nous allons également rappeler exprime bien cette notion de fin en soi: "Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours en même temps comme fin, jamais simplement comme moyen."
Comment la loi pénale qui est selon Emmanuel Kant un impératif catégorique pourrait-elle s'énoncer sans contradiction et être universelle ?
Précisons qu'il s'agit de la loi pénale juridique et non de la loi pénale naturelle. Par cette dernière, dit Kant, "le vice se punit lui-même et à cette peine naturelle", le législateur n'a point égard." (p. 214). Cette loi pénale s'impose comme l'impératif catégorique à soi-même sans autre but que de faire payer le crime commis. La loi pénale (juridique) ne vise pas par exemple l'amélioration du criminel ou la protection de la société civile.
Selon cette loi pénale, le criminel conscient de son crime devrait lui-même réclamer son application. Mais si en règle générale, le criminel tente d'échapper à la peine, il sait au fond de lui-même que son crime exige qu'il paie la faute qui lui est imputable. Aussi, cette loi pénale, autre impératif catégorique, pourrait s'énoncer: "Pour le crime que tu as commis, exige toi-même que tu sois puni" et l'impératif pratique: "par respect de l'humanité en toi et dans autrui, considère et exige que le crime que tu as commis est punissable pour lui-même et pas seulement comme un moyen de te faire pardonner ou de rembourser la dette que tu dois à autrui, ou encore pour protéger la société civile."
On conçoit donc que la punition est une fin en soi, comme l'obéissance à la loi morale, le respect de l'humanité en moi et en l'autre. La loi pénale est donc bien, comme la loi morale un impératif catégorique et pratique de la raison. Reste à savoir: 1- s'il est vraiment question ici de la loi pénale juridique ou plutôt de la loi pénale naturelle; 2- quelle punition correspondant à tel crime est légitime donc légale.
La réponse d'Emmanuel Kant est claire à la fois sur le premier point et sur le second. Mais c'est précisément parce qu'elle est claire qu'elle est problématique. Kant distingue bien la peine juridique (poena forensis) et la peine naturelle (poena naturalis) (p. 214) et c'est la première qu'il identifie à l'impératif catégorique et pratique: "La loi pénale (juridique) est un impératif catégorique, et malheur à celui qui se glisse dans les anneaux serpentins de l'eudémonisme pour trouver quelque chose qui, par l'avantage qu'il promet, le délivrerait de la peine ou l'atténuerait, d'après la sentence pharisienne: "Mieux vaut la mort d'un homme que la corruption de tout un peuple."
En second lieu, en vertu du principe d'égalité, la peine du talion (ius talonis) (1) (...) "peut fournir avec précision la qualité et la quantité de la peine, toutes les autres sont chancelantes et ne peuvent, en raison des considérations étrangères qui s'y mêlent, s'accorder avec la sentence de la pure et stricte justice." (p. 215). Rappelons que la loi mosaïque du Lévitique ne transige pas avec la mort: "Si quelqu'un frappe à mort n'importe quel homme, il sera mis à mort" (...) "fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent." (24, 17 à 22), etc. Moïse est censé parler au nom de Dieu.
L'exposé d'Emmanuel Kant appelle plusieurs critiques de notre part. La première est que l'auteur de la remarque E: Du droit de punir et de gracier est passé de l'impératif moral catégorique qui est une proposition pratique synthétique a priori à un impératif de la peine juridique qui devrait être lui aussi une proposition pratique synthétique a priori puisque Kant déclare que la peine juridique relève d'un impératif catégorique.
Elle est pratique parce qu'à la volonté (indépendante de toute inclination), je joins l'action a priori, nécessairement.
Elle est synthétique car elle lie immédiatement au concept de la volonté d'un être raisonnable l'acte consistant à réaliser une représentation volontaire, comme quelque chose qui n'y est pas contenu.
Cette action est la conduite morale qui est l'application de la loi morale et de l'impératif catégorique, même si cette conduite est nécessairement impure puisqu'elle est médiée par la liberté empirique.
Y a-t-il identité entre l'impératif moral catégorique et l'impératif pénal catégorique ? Oui, dans la mesure où ce dernier est également une proposition pratique synthétique a priori. Non en fait, pour deux raisons: la première est que la peine se fonde sur le principe d'égalité et qu'elle substitue par là subrepticement à l'impératif catégorique l'impératif hypothétique pragmatique: "Si tu tues, tu seras tué." (2)
D'ailleurs, deuxièmement, Kant introduit cet impératif conditionnel sur le terrain de la peine naturelle, non sur celui de la peine juridique quand il dit: "le mal immérité que tu infliges à un autre dans le peuple, tu le fais à toi-même.
Si tu l'outrages, c'est toi-même que tu outrages; si tu le voles, tu te voles toi-même; si tu le frappes, tu te frappes toi-même; si tu le tues, tu te tues toi-même."
Tant que ces propositions conditionnelles restent sur le plan de la peine naturelle, c'est-à-dire sur le plan de la raison pure a priori, elles ne sont pas à proprement parler une substitution de l'impératif hypothétique à l'impératif catégorique. Elles ne sont que l'explicitation pédagogique d'une conséquence contradictoire de la non observation de l'impératif catégorique ou de l'impératif pratique.
Il en va autrement au plan de la peine juridique. Ici, ce n'est pas la raison pure pratique qui s'adresse à elle-même, c'est le tribunal pénal qui s'adresse au sujet qui vient de fauter. Nous n'avons plus affaire à une conscience autonome mais hétéronome. Ce n'est plus la conscience morale thétique d'elle-même qui s'expose les contradictions de l'outrage, du vol, de la violence, du meurtre. C'est une autre conscience qui lui dicte la loi du talion, non pas: "si tu tues, tu te tues toi-même", comme précédemment, eu égard à la peine naturelle, mais "si tu tues, tu seras tué" (par quelqu'un d'autre), selon le principe contractuel d'égalité, et la peine infligée par un tribunal pénal.
Ce principe contractuel d'égalité qui fonde la peine juridique et en particulier la peine de mort est-il consistant ? Nous répondrons par la négative car il repose sur l'impératif hypothétique pragmatique, non sur l'impératif catégorique. L'institution juridique contractuelle substitue le premier au second et commande de l'extérieur au sujet: si tu commets une faute, tu seras puni par le même mal provoqué par ta faute. Si tu tues, tu seras tué.
L'impératif hypothétique contractuel est pragmatique car il est censé viser une utilité sociale, se réclamer de la prudence et avoir pour effet le bien-être des citoyens. Il est censé être utile puisqu'en punissant le coupable, il l'empêche de récidiver et protège de ses méfaits futurs les membres de la société. On pourrait dire aujourd'hui qu'il applique le principe de précaution qui comparant les avantages et les inconvénients de la détention ou de la suppression du coupable, décide ce qui est le mieux pour la société. Il assure ainsi à ses membres une protection, la sécurité et la garantie d'une vie paisible. Eventuellement, la peine est dissuasive pour d'autres personnes mal intentionnées qui seraient tentées par des crimes non punis ou mal punis. On pourrait ajouter à ces arguments des défenseurs de la peine de mort toute une liste d'avantages que procure cette peine radicale. Cela ne changerait rien au fait que tous ces arguments obéissent à l'impératif hypothétique.
En résumé, alors que l'impératif hypothétique ne saurait se substituer à l'impératif catégorique au plan de la peine naturelle, il le remplace au plan de la peine juridique et, ce faisant, prouve son impossibilité logique quand il s'agit d'instituer la peine en général, celle de mort en particulier.
Pour que cette institutionnalisation de la peine soit logiquement et pratiquement possible, il faut qu'elle soit en accord avec l'impératif catégorique et l'impératif pratique.
Ce qui est paradoxal, c'est que Kant semble appliquer l'impératif pratique à la peine juridique quand il déclare que "l'homme ne peut jamais être traité simplement comme un moyen pour les fins d'autrui et être confondu avec les objets du droit réel; c'est contre quoi il est protégé par sa personnalité innée, bien qu'il puisse être condamné à perdre la personnalité civile."
Qu'il soit punissable en soi pour le crime qu'il a commis, parce qu'il l'a commis, non pour une raison étrangère à l'acte fautif, c'est ce dont il faut convenir. Mais en quoi "[l'humanité en lui est-elle traitée dans sa personne en même temps comme fin, jamais simplement comme moyen]" lorsqu'on supprime sa vie ?
Appliquons l'impératif catégorique et l'impératif pratique au tribunal pénal, à l'Etat qui légalise la peine de mort et l'on verra que celle-ci est logiquement irrecevable donc inapplicable.
La loi du talion ne saurait obéir à ces deux impératifs: 1- On ne peut ériger en loi universelle de la nature le meurtre, qu'il soit commis par un individu ou par une institution. 2- Ce n'est pas traiter l'humanité dans ma personne comme dans celle d'autrui comme fin, mais seulement comme moyen que de supprimer un individu à la suite d'une décision collective.
En revanche, en opposition à la loi du talion, la loi du Nouveau Testament telle qu'elle est exposée dans Matthieu (5, 17 à 48) aurait pu servir de modèle à Kant pour illustrer se deux impératifs. Bien qu'il déclare qu'il n'est pas venu abroger la loi ancienne, mais pour la parfaire, le Christ annonce:
1- une justice qui surpasse celle des scribes et des Pharisiens.
2- Tu ne tueras pas. (...)
3- Au verset 38, l'opposition au talion est radicale: "Vous avez appris qu'il a été dit: oeil pour oeil, dent pour dent. Eh bien ! Moi j vous dis de ne pas tenir tête au méchant. Au contraire, si quelque un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. A qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau."
Cela ne signifie pas que le vol, la colère, la violence, le meurtre ne sont pas punissables: "Quiconque tue sera passible du jugement. Eh bien ! Moi je vous le dis: tout homme qui se met en colère contre son frère sera passible du tribunal", etc. (2) Seulement, la justice du Christ n'étant pas de ce monde, il remet la sentence du tribunal divin au temps des derniers jours.
Est-ce à dire que la justice humaine n'a pas les moyens d'appliquer les impératifs kantiens ? Nous dirons qu'elle a au moins les moyens de ne pas se mettre en contradiction avec eux et la peine de mort, comme la torture font partie des moyens utilisés qui tournent le dos à ces impératifs. A contrario, aimer son prochain et même ses ennemis est dans le droit fil de ces impératifs. Et si l'inverse se produit si souvent dans nos sociétés les plus policées, la punition des tribunaux, même si elle est nécessairement imparfaite, pour ne pas devenir à son tour injuste, voire criminelle, doit garder en mémoire ces deux impératifs moraux.
Nous sommes donc très éloigné de Kant et en total désaccord avec lui, lorsqu'il déclare: "Tous ceux qui sont des meurtriers, qu'ils aient donné la mort ou qu'ils l'aient commandée ou qu'ils y aient coopéré, doivent être punis de mort; ainsi le veut la justice comme Idée du pouvoir judiciaire selon des lois universelles fondées a priori." La critique de la position de Kant que nous venons d'émettre n'est pas externe aux catégories de l'auteur. Nous avons voulu rester à l'intérieur de sa logique. (1)
Plus kantien que Kant, nous disons donc que ce n'est pas la justice comme Idée du pouvoir judiciaire selon des lois universelles fondées a priori qui veut la peine capitale, c'est la justice comme Idée du pouvoir judiciaire obéissant à des impératifs hypothétiques a posteriori.
Et puisque Kant poursuit son propos par une critique de Cesare Bonesana Beccaria (3), nous dirons d'abord contre Beccaria que le droit pénal ne peut être fondé sur un principe relativiste et pragmatique, "punitur ne peccetur", mais avec lui (et contre Kant) que la peine de mort ne peut être comprise dans le contrat civil originaire.
Notes
1) Emmanuel Kant, Métaphysique des moeurs, 1ère partie: Doctrine du Droit, Vrin, 1971. Introduction et traduction de A. Philonenko.
2) "Si tu tues, tu seras tué". En quoi ce principe d'égalité (la mort pour la mort) est-il un impératif hypothétique ? "L'impératif hypothétique représente la nécessité pratique d'une action possible comme moyen pour quelque autre chose qu'on désire (ou du moins qu'il est possible qu'on désire) obtenir." (Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 2e section, ¶ 16). A première vue, si je te tue, je n'utilise pas le meurtre comme moyen, avec ce désir explicite d'être moi-même tué ! Puisqu'il se réfère à une loi instituée (dans certaines sociétés) (*), ce principe d'égalité s'identifie à un impératif hypothétique, comme conseil de prudence, c'est-à-dire un impératif pragmatique de conservation de son être ou de son bien-être, si "bien" il y a. "Tu sais d'après cette loi que si tu tues, la société te punira par ta propre mort. Donnant, donnant. Donc prudence". La négation de cette sentence, dans les deux sens de ce mot, fait mieux apparaître la prudence: "Si tu ne tues pas, tu ne seras pas tué." Le désir impliqué dans l'impératif hypothétique se retrouve bien dans ce principe d'agalité tout comme les notions de moyen et de fin. Désir, moyen et fin souhaitée sont dans tous les principes d'égalité. Si tu souhaites rester en vie, ne tue pas ou encore, si tu désires rester en vie, donne t'en les moyens et ne tue pas. C'est bien là un conseil de prudence qui est une des deux formes de l'impératif hypothétique (la seconde forme étant la règle de l'habileté, propre aux impératifs techniques auxquels on recourt, dans l'art par exemple). (*) Pour le principe contractuel d'égalité, voir plus bas.
3) La Sainte Bible, édition publiée sous la direction de s. Em. Le cardinal Lienart, Letouzey & Ane, 87, Bd Raspail, Paris VIe. Editions Siloe, 8 place St Sulpice, Paris Ve, 1955.
4) Cesare Bonesana Beccaria (marquis de), (Milan, 15-03-1738 / 28-11-1794), Dei delleti et delle pene (Des délits et des peines), Milan, 1764.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter