Antigone
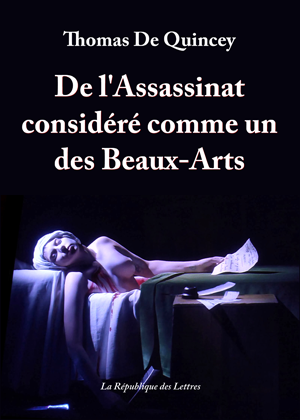
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques

George Steiner dans Les Antigones étudie, avec la science et l'intelligence qu'on lui connaît, les visages d'Antigone. La présente étude a pour objet de soulever des objections concernant la lecture par Kierkegaard de la tragédie de Sophocle, et l'interprétation qu'en donne Steiner.
Il faut d'abord résumer le propos de Steiner: Kierkegaard avait lu Hegel, la Phénoménologie et l'Esthétique en particulier. Quelle est l'essence du tragique ? La responsabilité, l'acceptation de la culpabilité. Dans la tragédie antique, le héros subit le fatum et son action est de l'ordre épique: dans la tragédie moderne, celle d'une époque mélancolique et désespérée, la séparation où vivent les individus grégaires devrait engendrer la comédie, pourtant l'individu moderne accepte sa culpabilité dans ses actes: "le mal véritable, la culpabilité vraie, ne sont pas des catégories "esthétiques" mais "éthiques" (1). Selon George Steiner, Kierkegaard se donne pour projet de "montrer comment le caractère propre de la tragédie antique est repris dans la tragédie moderne et s'y incarne". Si la seule tragédie moderne parvient, par la réflexivité éthique du héros, à subordonner l'esthétique propre à l'antique, la dureté de l'éthique est tempérée par la "douceur du religieux". Kierkegaard verrait la mélancolie, la tristesse qui console, "que renferment l'art, la poésie et même la joie des Grecs de l'Antiquité." Tel serait le paradoxe de la "grâce tragique". À présent, il faut s'attacher au spectateur: compassion du spectateur antique et moderne, mise en scène de la culpabilité tragique à laquelle il réagit. Le spectateur antique ressent une peine véritable, le moderne une souffrance vraie. Ce qui les sépare est le concept et la présentation de la culpabilité. La peine des Grecs serait "douce et profonde" qui se déverse sur la souffrance du héros auquel les dieux ont donné ce destin tragique. Pour les modernes, la culpabilité nous est transparente: nous nous jugeons et nous souffrons.
La culpabilité tragique est héritée du péché originel. Accepter cette culpabilité est un acte de piété, où se mêlent innocence et culpabilité, transparence et opacité. La compréhension réflexive et la souffrance ne sont pas grecques mais hébraïques, écrit Steiner. Jéhovah punit les enfants jusqu'à la troisième génération, et voici le "paradoxe de la culpabilité innocente". Je passe pour l'instant sur l'appropriation d'Antigone par Kierkegaard. Disons qu'elle seule connaît le secret infâme de son père incestueux, qu'elle en est saisie d'angoisse mais, soutient Kierkegaard, le drame d'Antigone distinct du crime de son père, résulte de l'interdit jeté par Créon, sa désobéissance, faits contingents qui réalisent le fatum. Pour Kierkegaard Antigone est une morte vivante, "vierge et mère" du secret: elle ne sait pas si Oedipe a su qu'il était parricide et incestueux. Elle connaît bien peu l'histoire de son père, dans ce cas. Antigone se sent "doublement étrangère dans la maison de l'être". Cette flèche qui la traverse, et que son bien-aimé Hémon voudrait ôter, la tue: si elle révèle son secret, l'héritage de la culpabilité sera poursuivi. Ici, une très belle comparaison avec la légende d'Épaminondas blessé à mort, qui mourra si on ôte la flèche de sa blessure et qui interdit qu'on le soigne, jusqu'à l'annonce de la victoire des Spartiates: alors il peut mourir. Voilà le "remodelage imaginaire" opéré par Kierkegaard selon George Steiner. Antigone porte en elle un secret mortel, le lui arracher est la faire mourir.
La lecture de Sophocle est édifiante: la tragédie commence par un dialogue entre Antigone et sa soeur Ismène, car toutes deux partagent le secret. Leurs deux frères, Étéocle et Polynice sont morts, l'un pour défendre de l'autre la Cité. Antigone relate l'édit de Créon, à Étéocle les honneurs, Polynice privé de sépulture. Tout contrevenant à l'édit serait lapidé sur l'Acropole, châtiment particulièrement exemplaire, puisque cette mise à mort souillerait la ville. Steiner répète qu'elle est enterrée vive. C'est une erreur, elle est emmurée vive, ce qui n'a pas le même sens, j'y reviendrai. Antigone pense à braver l'édit, et que lui répond Ismène ? "Ah, réfléchis, ma soeur, et songe à notre père. Il a fini odieux, infâme: dénonçant le premier ses crimes, il s'est lui-même, et de sa propre main, arraché les deux yeux. Songe à celle qui fut et sa mère et sa femme, qui mérita ce double nom et détruisit sa vie dans le noeud d'un lacet. Songe enfin à nos deux frères, à ces infortunés qu'on vit en un seul jour se massacrer tous deux et s'infliger, sous des coups mutuels, une mort fratricide. (...) Les gestes vains sont des sottises." (2)
De sorte que, non seulement Antigone n'est pas seule détentrice du secret, mais elle ne peut douter que son père ait su la vérité, comme le démontrent les propos de sa soeur et les tragédies Oedipe roi et Oedipe à Colone. Cela détruit d'évidence l'hypothèse ci-dessus évoquée. N'oublions pas d'autre part que ceci n'est pas la Tragédie d'Ismène. Elle est pourtant porteuse de la même culpabilité que sa soeur. Elle promet à Antigone de l'aider à cacher son projet, qui ne l'en détesterait que davantage, et en vain Ismène proteste de son amour pour elle. Le coryphée déclare ensuite que les deux morts issus du même père et de la même mère ont "obtenu part égale du trépas qui les a frappé ensemble". Puis paraît Créon, il s'adresse aux Thébains qui ont eu Laïos puis Oedipe pour roi et ont "tout comme ensuite après sa mort, encore conservé pour leurs fils des sentiments loyaux". On note que c'est Créon qui a succédé à Oedipe, et non les fils de celui-ci, plus étonnant encore est ce: "leurs fils". Car ou bien les mots n'ont pas de sens, ou bien ils désignent Étéocle et Polynice comme les fils d'Oedipe et de Laïos, ce qui signifie que tous savent qu' Oedipe a tué son père et épousé sa mère Jocaste. Voilà un secret très répandu. Créon poursuit en évoquant le "fratricide sacrilège". Égal crime donc des deux frères, que pourtant Créon oppose dans la mort: l'un enseveli et l'autre, rentré d'exil pour combattre sa Cité, non. Et de quel argument use Créon pour asseoir cette décision, car c'est un acte du prince dont il s'agit, non pas d'un décret des dieux. Créon proclame qu'il mérite d'être roi et pour preuve en donne cette décision atroce: s'il peut la prendre, c'est qu'il est digne de régner.
Voici qu'un garde lui apprend que son édit a été violé la nuit même -- avant que l'édit ait été formulé, et que voyant le corps de Polynice couvert de poussière, les gardes se sont mutuellement accusés du crime. Le Coryphée demande alors: "L'événement, prince, ne serait-il pas voulu par les dieux ? À la réflexion, depuis un moment, je me le demande." Étrange intervention, et pour deux raisons: le Coryphée suggère que les dieux n'ont pas voulu de cet édit, et lui, Coryphée y songe depuis un moment ! C'est-à-dire, si les mots ont un sens, au moment où Créon a prononcé cet édit, puisque le garde vient d'apprendre la découverte de la transgression. Avant même l'acte d'Antigone, le Coryphée se demandait si les dieux étaient en accord avec l'ordre donné par Créon pour asseoir son autorité. Ce doute soulève la colère de Créon: les dieux se soucieraient-ils de ce mort, qui était venu pour détruire leurs temples et toutes les lois ? Non, "c'est que depuis un moment il y a dans cette ville des hommes qui s'impatientent et qui murmurent contre moi".
Nous voici renforcés dans la certitude que l'édit de Créon est un acte politique, ni voulu par le fatum ni découlant de la loi de la cité. Les deux frères ne sont-ils pas coupables de fratricide ? Créon aurait des ennemis ? Comment mieux s'imposer au pouvoir qu'en les suscitant ? D'ailleurs il accuse aussitôt cet ennemi dans l'ombre d'avoir soudoyé les gardes. La cité à peine sauvée de l'ennemi extérieur n'est-elle pas en grand péril si ses propres gardes la trahissent ? Car c'est du salut de la cité qu'il s'agit, de ses temples et de ses lois, du respect de l'autorité. Et voici l'autorité mise en doute: quelle autorité ? Nous voici à l'un des pôles de cette tragédie, l'autorité. Steiner dresse un parallèle entre l'Antigone de Sophocle et l'Iphigénie de Goethe. C'est là que nous trouvons ces vers, dans la bouche d'Iphigénie:
"Götter sollten nicht
"Mit Menschen wiemit ihresgleichen wandeln:
"Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach,
"In ungewöhnter Höhe nicht zu schwindeln." (3)
"Les dieux ne devraient pas cheminer avec les hommes comme parmi leurs semblables: le genre humain trop faible est pris de vertige à cette hauteur inaccoutumée". (4) "Rappelons l'histoire: le corps expéditionnaire grec ne peut embarquer pour Troie parce que les vents sont contraires. Les prêtres consultés révélent que la condition mise par Artémis pour les vents favorables est le sacrifice d'Iphigénie. Elle est la fille d'Agamemnon, chef de l'expédition. Il est de la lignée des Atrides, elle-même marquée par le fatum (5). Il doit sacrifier sa fille et favoriser le succès de l'expédition grecque ou renoncer, il choisit de souscrire à l'exigence des dieux. Où est l'autorité ? Elle ne provient des dieux, eux-mêmes en litige, que selon le fatum auquel veillent les Parques. L'interférence des dieux et des mortels est la source de l'autorité (6). Ainsi, Agamemnon est chef: il n'en tire nulle autorité mais seulement un pouvoir de commandement, qui bien souvent consiste à faire valoir son bon plaisir, comme lors du partage du butin, quand il reprend Briséis à Achille. Certes celui-ci obéit, mais se retire. C'est tout différent lorsqu'il s'agit de décider le sacrifice d'Iphigénie, car Agamemnon, souscrivant au décret des dieux, participe de l'autorité, prend sur lui cette action monstrueuse grâce à laquelle les Grecs pourront faire voile vers Ilion. Tous verront en lui l'intermédiaire, celui qui a obéi aux dieux. L'autorité résulte de cette prise de part aux ordres qui n'émanent pas des hommes, qu'ils ne peuvent seuls supporter ni accomplir. L'autorité a un prix, celui qui y participe n'est plus un simple mortel, il est voué à être écrasé par les dieux et durant la période où il participe de l'autorité, sa vie est suspendue à un fil, ainsi que Denys le fit voir à Damoclès. Car celui qui incarne l'autorité -- et n'est pas l'autorité -- a maîtrisé en unissant la Cité, ou le Peuple, ou la Nation, l'ennemi intérieur autant qu'extérieur, qu'il a suscité par son oeuvre. C'est que la Cité ne peut accéder à l'être, un être propre, qu'unie par des lois, un ordre, une connivence, toutes choses qui excluent et contraignent. Le détenteur de l'autorité contient en lui cet ennemi, au double sens où il l'a suscité et fait entrer dans sa personne garante qu'il n'en sortira pas, et aussi parce qu'il est le rempart de la Cité. Sans lui le désordre naturel reprendrait la place d'où il a été chassé et régnerait selon l'ordre du monde, qui supporte mal celui que des hommes s'obstinent à établir ici ou là, contre l'harmonie voulue par les dieux. C'est pourquoi les gens de la Cité doivent désirer l'autorité et son représentant, ses successeurs aussi bien, qui se transmettent cette charge jusqu'au jour où les dieux le reprendront, tel Jupiter foudroyant Romulus (7).
Revenons à Antigone. Ce n'est pas au pouvoir qu'elle s'oppose. Dans une pièce ou un roman d'Albert Camus, ce serait l'enjeu, simplement il s'agirait d'un drame existentiel. Ici, l'autorité a été saisie par Créon, il est déjà usurpateur, pour le bien de Thèbes. Ce qu'il a saisi, il essaie de le changer en pouvoir ou potestas, puissance. Ce n'est pas chose aisée: le garde qui lui a rapporté l'affront subi, et que Créon menace d'une mort cruelle, lui dit: "Le coupable te blesse l'âme: moi, l'oreille seulement". Pour celui qui s'est institué porte-parole de l'autorité, quoi de plus terrible que de ne pas savoir qui est coupable ? Le choeur va chantant: "L'homme a l'esprit ingénieux. (...) Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que lui peut offrir l'avenir. Contre la mort seule, il n'aura jamais de charme permettant de lui échapper (...) Mais, ainsi maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal tout comme du bien". L'autorité n'a pas à chercher le coupable, elle doit le connaître déjà: veut-on un exemple ? Philippe le Bel faisait de la fausse monnaie, le peuple des marchands s'émut, les Juifs et les lépreux étaient coupables. Il faut être furieusement moderne pour penser que le coupable est responsable de quelque chose. La culpabilité n'est pas transitive ni relative, elle est absolue (8). Or, la première chose que répond Antigone à Créon lorsqu'elle paraît devant lui, qui l'accuse d'avoir osé passer outre sa loi est: "Ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamée".
Antigone ne pensait pas, dit-elle, qu'un mortel puisse passer outre la justice. Quant à mourir avant l'heure, c'est pour elle "tout profit" car si elle avait laissé son frère sans sépulture, c'est elle qui n'aurait pas eu le repos éternel. Mais Ismène ? Créon la condamne à mort avant même de l'écouter, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Ismène n'est-elle pas du sang d'Antigone, de Polynice, et surtout d'Oedipe et Jocaste, usurpateurs s'il en fût, puisque le fils tua son père et épousa sa propre mère. Étéocle, on le notera, est mort en défendant la Cité, voilà qui n'est que payer sa dette. Sacrifier les deux filles restantes, c'est faire disparaître de la surface de la terre les seules mortes-vivantes, celles qui portent la mémoire du crime. C'est, dira-t-on, ce qu'écrit George Steiner. Oui certes, mais là n'est pas l'essentiel: Créon est l'authentique héros tragique, jusqu'à présent. Ne tient-il pas son autorité d'Oedipe ? N'est-il pas son successeur ? Pourquoi Antigone lui conteste-t-elle le droit de faire des lois ? Parce qu'il n'est qu'un mortel ? Non pas, mais parce qu'il ne détient pas l'autorité, à preuve, s'il l'avait détenue, qu'il n'aurait jamais prononcé une sentence si barbare.
Créon est proche de Macbeth, la prédiction en moins, et cela fait la différence. Macbeth est le jouet du destin, il doit tuer pour régner en usurpateur, il a cru à l'Avenir, il a cru qu'il en était maître. Créon ne croit rien de tel, il occupe par heureuse fortune un trône auquel il n'était pas destiné. Par infortune, cette opportunité lui vient d'un double sacrilège. Créon est un homme accablé par le destin, sans qu'il ait osé braver le destin. Il est un héros moderne si l'on veut, au sens où il ne se croit pas lui-même détenteur du sacré, et où il est obligé de dissimuler l'origine monstrueuse de son pouvoir. D'ailleurs, Polynice n'est-il pas venu ressaisir son droit ? Polynice tué n'était-il pas le dernier successeur d'Oedipe ? Qu'il soit venu avec les ennemis de la Cité n'est rien, s'il s'agissait d'y rétablir l'autorité et Oedipe, que les Thébains avaient choisi comme roi, n'avait-il pas appris de Tirésias le meurtre duquel il avait tiré ce trône ? Ne s'était-il pas condamné lui-même, afin de sauvegarder la Cité ? Polynice vengeur était après tout le fils de la reine Jocaste, et celle-ci avait expié, tout comme Oedipe disparu. Créon régnant sur Thèbes, tenant son pouvoir d'Oedipe, c'était risquer le retour de la peste, cette épidémie qui avait dénoncé la pourriture dans Thèbes, puisque, lui régnant, la perpétuation du crime augural d'Oedipe continuait de marquer la Cité.
À présent, nous apprenons d'Ismène, décidément annonciatrice des désastres à venir, que le fils de Créon, Hémon, est fiancé à Antigone, qu'ils s'aiment et veulent s'épouser, de sorte qu'Hémon est le "maître" d'Antigone. Et le Choeur enchaîne -- c'est le mot juste me semble-t-il -- par ces paroles: "Ils remontent loin, les maux que je vois, sous le toit des Labdacides (9), toujours, après les morts, s'abattre sur les vivants, sans qu'aucune génération jamais libère la suivante: pour les abattre, un dieu est là qui ne leur laisse aucun répit. L'espoir attaché à la seule souche demeurée vivace illuminait tout le palais d'Oedipe, et voici cet espoir fauché à son tour ! Il a suffi d'un peu de poussière sanglante offerte aux dieux d'en bas, provoquant des mots insensés et un délire furieux !" Que voici un Choeur étourdi, qui parle de "la seule souche": le Choeur tient-il Ismène pour condamnée, ou ne la prend-il pas en compte ? Beaucoup plus profonde est la "poussière sanglante", car de quoi sommes-nous faits, sinon de poussière sanglante ? J'entends bien qu'il s'agit de la poussière jetée par Antigone sur le corps sanglant de Polynice, mais si l'on veut voir comme le fait Kierkegaard, Antigone victime de deux meurtriers, Oedipe dont elle garde le secret (Nous avons vu ce qu'il en était) et Hémon qui la conjure de révéler ce secret mortel, que penser ? "Doublement étrangère dans la maison de l'être, Antigone est deux fois envoyée dans les ténèbres de la mort. (10) "Voyons ce "doublement étrangère". La maison de l'être ne peut désigner que le palais d'Oedipe si l'on en croit le Choeur, mais Oedipe l'a désertée, il est sans patrie. Antigone ne tient à l'être qu'en tant que fille d'Oedipe, et sa filiation vraie est indicible, elle ne peut appartenir à cette maison qu'elle a fui aussi, emmenant son père aveugle (11). Oedipe arrivant à Colone avec elle, qui lui a pris la main, commence par s'asseoir sur une pierre sous les frondaisons. C'est pour s'entendre dire que ce lieu est frappé d'interdit, il appartient aux Euménides, c'est "le bois interdit des Vierges invincibles", et "celui qui y demeure" est le porte-torche, le Titan Prométhée: celui -- rappelons-le, qui a dérobé l'autorité. Apprenant qui il est, les gens de Colone veulent le chasser, c'est Antigone qui s'interpose: "Mais de moi, malheureuse, étrangers, je vous en supplie, de moi ayez pitié." Antigone sait donc supplier pour elle-même. Ismène paraît: ses frères, ainsi qu'elle l'apprend à Oedipe, veulent ressaisir le trône à Thèbes, qu'occupe Créon, et Polynice, l'aîné, a été chassé de sa patrie par son cadet Étéocle. Ismène révèle encore à Oedipe que Créon veut qu'il soit enseveli à la porte de Thèbes: "Il ne faut pas que tu restes en un lieu où tu sois en mesure de disposer de toi-même" (12). Mais il n'aura pas sur sa tombe la poussière thébaine, c'est comme parricide qu'il sera enseveli. Le refus d'ensevelir Polynice suit donc ce refus d'honorer son père, et Antigone est au côté d'Oedipe lorsqu'il l'apprend, de la bouche d'Ismène. Tout n'est pas dit: les deux fils connaissent ce projet et ont "fait passer le pouvoir royal avant aucun regret de moi", s'écrie Oedipe. Il exhale alors sa fureur contre eux, qui se combattent pour le trône et n'avaient rien fait pour le soutenir, lui, quand il fut banni de Thèbes: il prédit que "nul profit ne leur viendra jamais de cette cité thébaine". N'oublions pas son nom Oidipous, celui qui sait, de "je sais": oida. Oedipe a deviné l'énigme et délivré Thèbes, il sait et pourtant il a subi son destin sans savoir. Ses parents, Laïos et Jocaste, l'avaient éloigné, lui avait repris son identité afin d'empêcher que la prédiction de l'oracle se réalise. Le devin qu'est Oedipe aveugle à lui-même ignorait que le roi et la reine de Corinthe (13) n'étaient pas ses parents: il a pu prendre la route du mal comme du bien. Aussi bien le même oracle a-t-il révélé à Créon la souillure de Thèbes, sans en nommer l'auteur. Le choeur parle pour Colone: "nul ne [le] peut détruire ou saccager. Le regard vigilant de Zeus des Olivaies ne le quitte pas, et pas davantage celui d'Athéna aux yeux pers (14). "Que fera cette cité si bien protégée des dieux, en faveur d'Oedipe, que Créon vient chercher ?
Créon se dit envoyé par le peuple de Thèbes pour ramener son roi, et que voit-il ? Un mendiant dont l'unique compagne -- n'oublions pas qu'Oedipe est aussi frère d'Antigone -- est "une fille dont je n'eusse jamais pensé qu'elle pût tomber, hélas ! à ce degré d'ignominie où je la vois en ce moment tombée, la malheureuse enfant". Ce sont des paroles de haine qui lui répondent: "Ton destin, c'est de voir mon génie vengeur fixé pour jamais en ce coin du monde: et le destin de mes enfants, c'est de n'obtenir de mes terres que ce qu'il en faut pour mourir." À ces mots, Créon répond que les filles d'Oedipe sont entre ses mains et, à Antigone qui résiste, Créon crie qu'elle lui appartient. Thésée roi, survient et interdit à Créon d'emmener ces filles: "Quoi ? Tu entres dans un État qui pratique la justice, qui ne fait rien sans l'aveu de la loi: et te voilà qui négliges ses chefs, qui te précipites pour emmener ce qui te plaît et qui te l'appropries de force." Et il menace Créon: "Le chasseur est tombé dans les mains du Destin".
Et lorsque les gens de Colone demandent à Oedipe d'offrir une libation aux "Bienveillantes" (15), il s'en déclare incapable et Ismène dit: "Eh bien ! j'irai, moi, et je ferai tout". Ismène, et non Antigone. Lorsque Thésée a repris à Créon Antigone et Ismène, Oedipe déclare que, même dans la mort, il ne connaîtra pas le malheur total s'il les sait près de lui. Mais quand Thésée lui apprend qu'un parent vient le supplier, il refuse de l'entendre: c'est son fils "celui de tous les hommes dont il me coûterait le plus d'entendre la voix". Antigone le supplie de recevoir Polynice, et le choeur chante: "Celui que ne satisfait pas une part normale de vie et qui en souhaite une plus grande obéit à une sottise". Polynice vient se plaindre qu'Étéocle a pris sa place à Thèbes. L'a-t-il vaincu ? Non, il "avait su séduire la cité". Oedipe, loin de bénir sa tentative pour reconquérir le trône, le maudit pour l'avoir chassé, lui -- quoique Polynice en vérité n'a jamais régné sur Thèbes, et l'accuse d'être son assassin. Ses filles l'ont soutenu mais Polynice et Étéocle son frère, "vous n'êtes pas nés de moi". Puis encore une prédiction: les deux frères mourront et Polynice le premier tombera souillé d'un meurtre. C'est Antigone qui supplie alors Polynice de renoncer à son projet, lui qui à l'instant a invoqué les dieux: "N'allez pas me faire affront, mais mettez moi dans une tombe, entouré d'offrandes funèbres". Et à Antigone: "Ne pleure pas sur moi !"
Oedipe est enlevé par les dieux, Antigone veut aller se tuer là où il a disparu puis, raisonnée par Ismène -- les vers dans lesquels sont contenues les paroles échangées alors par les deux soeurs sont perdus -- elle demande à Thésée de lui révéler la tombe de son père: c'est ce qu'il a interdit. Ainsi s'achève Oedipe à Colone. On se souvient que dans Oedipe roi, ce malheureux prince a demandé à Créon de veiller sur ses filles, dont nul ne voudrait pour épouse. Puis, alors qu'il va partir, il supplie Créon de les lui laisser, ce qui lui est refusé. S'il est surprenant qu'Oedipe montre tant d'égarement, c'est que ses malheurs excèdent la part de l'humain. Dans les instants qui précèdent sa mort, il n'a de cesse que Thésée promette de le protéger puis, d'un coup, il annonce qu'il va mourir et lance une nouvelle prédiction fondée sur "le pieux mystère que la parole n'a pas le droit de remuer". Lui, Oedipe mort protégera la cité de Thésée, la mettra à l'abri des ravages "que lui infligeraient les Enfants de la Terre": les Thébains. Il invoque les dieux dont l'oeil sait découvrir même longtemps après, ceux qui "au mépris du ciel, se sont tournés vers la folie". On note qu'en attendant Thésée, Oedipe s'inquiète: le roi le trouvera-t-il encore en vie et maître de sa raison ?
Il y a dans tout cela un étrange labyrinthe, car Oedipe le clairvoyant s'est rendu aveugle bien avant de s'être crevé les yeux, et "longtemps après", devenu un vieillard, voudrait retrouver son trône, revivre une vie royale. Les dieux pourtant, il le sait, n'oublient pas, comment pourrait-il leur faire oublier ses crimes ? En invoquant le destin qui les lui a fait subir et non commettre. Et c'est pour mettre en garde Thésée contre ceux qui visent la démesure. On dirait que ses fils n'existent plus, déjà, et d'ailleurs il a présagé leur mort, non content de les désavouer. Mais dès Oedipe roi il a mis à part ses filles pour lesquelles seules il se lamente devant Créon. Dans Oedipe à Colone, il renie ses fils: de quel père auraient-ils pu être engendré, sinon lui ? Et pourquoi accuse-t-il Polynice, qui n'a jamais régné, de l'avoir chassé d'un trône qu'il a lui-même abandonné pour fuir Thèbes ? Et Créon s'indigne du sort misérable qu'Oedipe a fait subir à Antigone, errant sur les chemins avec lui, sans patrie. Il avait essayé, lors de la fuite d'Oedipe, de la conserver avec lui et, lorsqu'il retrouve le roi meurtrier près de Colone, c'est pour lui enlever Antigone, "qui lui appartient". À quel titre lui appartient-elle, et pourquoi Créon, menacé de l'arrivée de l'armée que Polynice a levée pour reprendre Thèbes -- où d'ailleurs Étéocle a repris le trône, s'en va-t-il si loin, à la seule fin de prendre Antigone avec lui ?
On voit l'inceste au coeur de la tragédie, la volonté de posséder les femmes de la lignée comme si elles n'étaient qu'une, mère, épouse, fille et soeur, et d'en tuer les hommes, les rivaux. On voit en somme la duplication d'Oedipe en Créon, en Polynice, voire en Étéocle qui, après tout, a voulu prendre son trône en dépit du droit de l'aîné. Oedipe est saisi de démesure: il ne peut être que roi, c'est en tant qu'autorité qu'il condamne le criminel Oedipe à avoir les yeux arrachés, et s'il ne peut l'être à Thèbes vivant, il le sera à Colone éternel. Cette démesure est mortelle pour un humain, aussi la folie de ses actes le poursuit-elle sans relâche. Et l'autorité sur Thèbes, c'est à Antigone qu'il l'a transmise: voyons cela de plus près (16). D'abord se pose la question: incarner l'autorité, est-ce un crime ? On nous dit -- George Steiner l'explique -- ce qui sépare le héros de la tragédie antique de celui de la tragédie moderne. Ce dernier est conscient de sa culpabilité personnelle, là où le premier se voyait pris dans les mailles tressées par les Parques et ballotté par l'incohérence des dieux en perpétuel conflit. Voilà qui est bien, et pourtant ne me satisfait pas. Parce que "l'homme moderne" est tout aussi impuissant. Certes, il peut faire de sa vie son oeuvre, du moins le croit-il, du moins le lui apprend l'institué qui, à la différence de la tradition n'est ni mémorial ni croyance mais un assortiment normatif. Normatif et non éthique, on ne gouverne pas les hommes selon les valeurs, vieille leçon que déjà enseignait Machiavel. Le héros moderne est pris entre deux impératifs, celui de "réussir sa vie" -- je ne prétends pas comprendre le sens de cette formule, que je cite, et celui d'obéir aux injonctions normatives. Si Hannah Arendt parlait à bon droit de la disparition de l'autorité, c'est que ces injonctions "modernes" sont dénuées de finalité et se rapprochent beaucoup de la volonté telle que la conçoit Heidegger -- volonté qui, selon Schopenhauer, n'est autre que la chose en soi du monde.
Le héros tragique moderne (17) aperçoit (au sens que Leibniz donne à l'aperception) l'absence principielle de l'autorité, de sorte que le conflit est en lui, non entre le moi et le non-moi qui, de gré ou de force est son complément au monde (18). Il n'a cependant ni lu ni aperçu Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas et croit que la séparation radicale d'avec les autres sans rompre la totalité abolit le face à face. Or "L'être est extériorité. Cette formule ne revient pas seulement à dénoncer les illusions du subjectif et prétendre que seules les forces objectives, opposées aux sables où s'embourbe et se perd la pensée arbitraire, méritent le nom d'être. [...] La vérité de l'être n'est pas l'image de l'être, l'idée de sa nature, mais l'être situé dans un champ subjectif qui déforme la vision, mais permet précisément ainsi à l'extériorité de se dire toute entière commandement et autorité: toute entière supériorité" (19). Quelle est donc la nature de ce commandement et autorité ? Si le héros tragique la voit dans le Destin, on rappellera utilement que le héros shakespearien se voit le jouet du destin, de Roméo à Macbeth, se trouve pris dans les rets du destin, d'Othello le Nègre sacrilège à Shylock, à qui la loi de Venise interdit de jouir de son bien. À ce compte, Enjolras des Misérables, qui se désigne pour être fusillé, Javert qui se jette dans la Seine sont des jouets du destin: le premier doit mourir pour la Liberté, le second ne vit que dans une poursuite sans fin. Je ne reviens pas sur Quinlan, le policier qui a vendu son âme au diable, de La soif du mal d'Orson Welles (20).
L'extériorité est vraie, l'intentionnalité de l'homme moderne, du héros tragique moderne, se perd en déformation et réfraction qui résultent des actes d'auteurs séparés, qui vivent leur séparation comme si elle était leur "maison", qui voient dans l'État le tyran absolu, violeur de leur intériorité par la révélation de leur propre absence de l'oeuvre accomplie (21). Antigone témoigne de l'authenticité de l'autorité, tandis que Créon redoute que Thèbes lui dicte ses ordres, ce qui advient en effet, non pas que le peuple de Thèbes veuille la mort d'Antigone, mais parce que, vivante, elle interdit à Créon de paraître devant le peuple en figure d'autorité. Antigone vivante se voit "couverte d'une neige éternelle" telle Niobé "l'étrangère phrygienne", petite-fille de Zeus, changée en pierre. Si elle songe à ce destin, c'est qu'il a frappé une petite-fille de Zeus qui avait épousé un roi de Thèbes. Le coryphée saisit aussitôt la métamorphose d'Antigone, désormais fille d'un dieu, et elle, au destin semblable à celui des Héros, se voit engloutie dans le cachot sans pleurs des siens: c'est qu'elle a franchi le pas pour aussitôt se lamenter sur les fautes que sa mort seule peut apaiser. Lorsqu'on l'entraîne dans le tombeau -- encore une fois, elle n'est nullement enterrée vive -- elle est saisie de crainte et illuminée d'espérance, comme Juliette au moment d'enfoncer la dague dans son coeur, au fond d'un tombeau elle aussi. L'admirable déploration sur son sort dit ce qu'elle sait devoir être: différente de toute autre femme, elle n'aura connu de la vie que la faute et le séjour souterrain des morts, elle implore les dieux que nul autre qu'elle ne subisse le sort qui lui était échu.
Tirésias vient apprendre à Créon que "Ce mal dont souffre Thèbes, il nous vient de ta volonté": entendons bien, le mal ne vient pas de crimes atroces comme en avait commis Oedipe, il résulte de cet effort de volonté par lequel Créon s'imagine avoir saisi l'autorité. Et Créon réplique à Tirésias que tous à présent le visent de leurs flèches: "Grâce à leur engeance, je deviens depuis quelque temps celui qu'on vend, dont on trafique !" Il a beau accabler l'engeance des devins avides d'argent, la réponse qu'il reçoit le dénonce: "et celle des tyrans de profits mal acquis". Qu'est-ce que l'on vend, dont on trafique, sinon du pouvoir ? (22) N'évoque-t-il pas l'interdit fait aux mortels de souiller les dieux ? Le pouvoir voulu par un mortel sur les autres n'est-il pas la pire souillure faite aux dieux ? "Mon esprit se trouble", avoue Créon, "Céder pour moi est terrible". Céder est renoncer au pouvoir de la volonté, renoncer au vouloir-vivre selon sa volonté démente: est-ce un héros antique, qui s'exprime ainsi ? Et Créon ordonne qu'on aille délivrer Antigone, selon le voeu du Coryphée. Trop tard ! Créon est allé honorer le corps de Polynice, déjà dévoré par les chiens. Hémon s'est tué avec Antigone, elle pendue comme sa mère Jocaste et lui, étreignant le corps d'Antigone, se perce de son épée. Après quoi Eurydice, épouse de Créon se tue, appelant le malheur sur lui.
Que signifie cette fin d'Antigone, qui se pend pour échapper au lent trépas qui l'attendait ? Est-ce le même refus de vivre qu'exprime Juliette voyant Roméo mort à ses pieds ? C'est la démesure en elle, qui l'a élevée au-dessus de ce qu'un humain peut endurer. Mourir de sa propre main, c'est se ressaisir, reprendre au destin -- ou aux dieux, comme on voudra, son existence humaine, serait-ce pour en finir avec elle, mais débarrassée de la charge écrasante de l'autorité. Son visage convulsé, humain reparaît. Kierkegaard écrit: "Les anathèmes de Jéhovah, quoique terribles, n'en sont pas moins de justes châtiments. Il n'en était pas de même en Grèce: la colère des dieux n'a pas un caractère éthique: elle offre l'ambiguïté de l'esthétique [...] La vraie tristesse tragique exige donc un moment de faute, et la vraie douleur tragique une part d'innocence: la première, un moment de transparence, la seconde un moment d'obscurité" (23). Kierkegaard appelle l'attention des lecteurs au moment où il envoie dans le monde son héroïne tragique et "donne comme viatique à la fille de la tristesse la dot de la douleur". Le facteur qui permet à Antigone -- son Antigone - de prendre conscience de la faute "doit toujours relever de la substantialité": la faute. La réflexion d'Antigone est éveillée, mais bornée à la faute héréditaire qui donne la tristesse. Voilà une axiomatique que je conteste, et plus encore qu'Antigone "passe ses jours dans l'insouciance". Allons donc ! Elle vit, écrit-il, dans l'ignorance du souci, certes: elle est bien au-delà du souci et notre philosophe s'égare, quoi qu'il remarque fort bien qu'il n'y aurait pas de tragédie si l'affaire se limitait à l'ensevelissement interdit de Polynice. Antigone est l'épouse de la tristesse, cela est vrai, mais non pas parce que "l'héroïne grecque" ne serait que la vierge offerte au sacrifice. Cette lecture de la tragédie porte Kierkegaard à voir une "dialectique étrange", de la transgression commise par Antigone au "funeste destin" de son père. Il n'y a rien d'étrange dans cette dialectique, si l'on veut bien renoncer à cette vision "romantique" de la tragédie grecque. Sophocle n'est pas Goethe, ce n'est pas la piété qui fait agir Antigone et l'élève dans la démesure, c'est bien la détention de l'autorité, qui en elle-même est malédiction. Aussi l'histoire d'Antigone est-elle celle d'une délivrance. Le peuple de Thèbes, écrit enfin Kierkegaard, a gardé d'Oedipe le souvenir d'un roi heureux et seule -- avec son secret, nous l'avons vu -- sa fille souffre la douleur de ce mensonge. Elle se destine à une vie spirituelle, et voici qu'elle se découvre amoureuse. Que d'étrangetés dans cette dialectique ! Sophocle notre contemporain écrit la tragédie des hommes à qui l'autorité a adressé le signe de l'élection, qui ont cru à ce signe jusqu'à ignorer tout d'eux-mêmes, armés du savoir qu'aucun mortel ne peut contenir en lui. "Nous avons brûlé une sainte !" auraient dit les Anglais devant le bûcher de Jeanne d'Arc, et c'est grande pitié que l'humain héroïque.
Notes
1) George Steiner, Les Antigones, traduction Paris, Gallimard, 1986, ch. I, p. 62.
2) Sophocle, Antigone, Paris, Gallimard, 1954, traduction Paul Mazon, préface de Pierre Vidal-Naquet 1973, p. 87.
3) Ce passage est cité par George Steiner, Op. cit., p. 51. J'ai modifié la traduction proposée.
4) J'ai modifié la traduction proposée dans Steiner.
5) Agamemnon, Clytemnestre son épouse, Iphigénie, Électre et Oreste leurs enfants. Dans la trilogie l'Orestie d'Eschyle, Clytemnestre avec son amant Égisthe tuent Agamemnon à son retour. Oreste avec Pylade son ami tue les coupables, aidé par Électre. Il intervient dans l'Iphigénie de Goethe.
6) Nous référant à Alexandre Kojève, La notion de l'autorité, Paris, Gallimard, 2004, nous voyons bien que l'autorité "se manifeste" dans une modification de "l'entité Temps", du temps naturel où prévaut le présent dans le domaine physique, le passé dans le domaine biologique on passe au primat de l'Avenir: il n'y a pas d'autorité atemporelle, c'est-à-dire dans l'Éternel. Avec la temporalité, le temps devient lui-même l'autorité: le Passé est sacré, l'Avenir recèle une autorité éminente: quel destin attend les hommes ? L'autorité du présent est tyrannique. L'autorité de l'Éternité s'oppose à ces autorités-là, mais elle est comme une fonction du temps, sa négation. L'autorité éternelle n'existe que par ses actions: l'action juste est de toute éternité, l'autorité éternelle, dit Kojève, peut être vue comme totalité ou intégration -- on pourrait dire l'intégrale au sens mathématique -- des trois autres. Au plan ontologique, Kojève conteste les théories de l'autorité qui la font reposer dans l'Être considéré comme "l'Être intégral", de sorte que ces théories supposent un Tout préalable. Il est regrettable que, dans cet essai, Kojève ne fasse qu'ébaucher cette ontologie, pour passer au politique. Nous pouvons pourtant déduire que l'autorité "se manifeste" lorsque le temps des hommes s'écarte du "temps naturel", c'est-à-dire lorsque les hommes ont besoin de justifier cet écart, qui doit être soumis à cette hypostase du Temps.
7) Pour rendre le propos aussi clair qu'il se peut, je donnerai un exemple opposé: en 1938, le président Daladier se rendit à Munich, où il signa une capitulation qui déshonorait ceux qui avaient garanti la sûreté de la Tchécoslovaquie. De retour à Paris, cet homme fut acclamé, et il paraît qu'il a murmuré: "Les imbéciles !" Examinons comment il venait de se dessaisir de l'autorité. Il avait accepté les conditions de l'Allemagne hitlérienne, premièrement de négocier ce qui n'était pas négociable en termes de souveraineté telle que celle de la France était fondée: deuxièmement en acceptant de mettre l'URSS à l'écart et d'inviter l'Italie fasciste pour faire pendant à la présence britannique: démocraties repues et régimes autoritaires affamés: troisièmement en rompant le traité passé avec la Tchécoslovaquie. Mais, que pouvait faire Daladier ? Précisément rien, et c'est ce qu'il fit, car il n'accomplit par ce voyage à Munich que le dessaisissement de l'autorité de la République française, autorité qui n'avait été préservée comme fiction que par des édifices de gloire, mémoriaux aux héros de la guerre 14-18, soumission illusoire du vaincu à des "réparations" qui, sans entrer dans les détails, ne furent jamais reçues, pactes signés avec les voisins de l'Allemagne, pactes l'un après l'autre dénoncés, par la Belgique notamment, trahis, ainsi par la Pologne des colonels, jamais signés, comme avec l'URSS, extrêmement conditionnels, comme avec la Grande-Bretagne. On me pardonnera ce détour, mais il rend évident ceci, que le principe de souveraineté avait disparu dans la République, que les discours d'alors relatifs aux factions, aux partis antinationaux, aux sacrifices consentis par "la France" lui valaient la paix et la sécurité, sans parler de l'effacement de la dette contractée envers les États-Unis. Que les plus clairvoyants -- Simone Weil, vers qui je reviendrai à propos d'Antigone -- annonçaient l'ignominie d'un État proclamé défenseur des droits de l'homme, et qui cautionnait et le principe colonial et bien plus les pratiques consubstantiels à ce principe. Que depuis longtemps "la France" fondait une politique extérieure de garantie d'intervention en faveur de ses alliés au moyen d'une armée vétuste, conçue et équipée selon les principes tirés de la "Grande Guerre", c'est-à-dire contraires à ses enseignements militaires mais conformes à la hantise d'un recommencement, commandée et inspectée par les plus hautes nullités militaires que l'on puisse imaginer. Que les industriels et financiers français attendaient un "grand nettoyage" pour revenir sérieusement aux affaires après avoir laissé passer l'orage. Qu'on désirait le Messie, apparu sous les traits d'un Glorieux Maréchal de France qui parla de son sacrifice: c'était annoncer le retour de l'autorité, décidément une bien étrange chose !
8) Je rappelle à toutes fins, qu'en 1973, les "cheiks du pétrole" et les Arabes en général (surtout les Arabes d'Iran, du Venezuela, du Nigeria, du Mexique) ont été proclamés coupables de la "crise" qui frappait l'Occident, et la malédiction persiste.
9) Laïos et sa descendance.
10) George Steiner, Op. cit., p. 68.
11) Voir Oedipe à Colone.
12) Ces passages sont tirés d'Oedipe à Colone.
13) Ses parents adoptifs, qu'il croit ses parents naturels.
14) Idem, également les citations qui suivent.
15) Les Euménides.
16) Laissez-moi vous conter l'histoire d'Arkadine, ou "le dossier secret", une tragédie d'Orson Welles, où lui-même incarne le personnage tragique: un financier formidable règne sur l'argent, de son château en Espagne -- déjà le mythe. Il donne des fêtes somptueuses et n'a de souci que de garder sa fille Raina. Il l'a enfanté à lui seul, tel Zeus Athéna, ce roi frappé de la perte de sa mémoire d'avant, et lui a donné son propre caractère, nous verrons pourquoi ce trait est décisif. Raina complète Arkadine, elle est son existence cachée, elle a pris la place de sa mémoire morte, des sbires à tout instant veillent sur elle. Un aventurier assez quelconque a assisté à un meurtre, et le mourant lui a dit le nom "Arkadine".
L'aventurier, baptisons-le Créon, et aussi Tirésias pourquoi pas ? sur les traces d'Arkadine découvre sa fille Raina. Elle l'avertit que son père l'entoure d'espions afin d'écarter d'elle tout prétendant, et celui-ci est peu reluisant, un trafiquant assez médiocre -- sa façon de parler est vulgaire, son esprit est vulgaire, ses visées sont vulgaires: il pense que Raina est une riche héritière. Pour se débarrasser de lui, puisque Raina refuse d'obéir, Arkadine offre une très grosse somme à l'homme pour qu'il mène une enquête: il s'agit de retrouver les traces du passé d'Arkadine, dont les souvenirs avant 1927 ont disparu. Comme s'il était arrivé au monde avec une fortune et aucun souvenir. Que cache une amnésie ? L'homme retrouve peu à peu les gens qui ont connu Arkadine, ce sont de bouffonnes épaves effrayées: Arkadine a autorité sur eux. Pourtant la vérité se fait jour, en 1927, Arkadine faisait partie d'un gang de "trafic de blanches". Il n'était pas le chef, une femme, "Sophie", dirigeait la bande. Il a volé l'or qui constituait le butin et a laissé les autres. La femme, que l'aventurier finit par retrouver, pleure d'émotion sur son passé avec Arkadine: "Il m'a volée, mais j'en ai eu avec lui pour mon argent". Cette femme a été en quelque sorte la mère du jeune Arkadine, elle conserve son portrait dans un album qu'elle serre sur son coeur. L'enquête d'Arkadine le mène irrésistiblement vers cette Sophie. Or tous ces survivants sont assassinés, alors même qu'ils ne voulaient pas trahir le voleur. C'est Arkadine, qui suit ou plus exactement précède son homme de main, et détruit ces vestiges de son passé. Détruisant ceux qui, en quelque sorte l'ont engendré, il acquiert autorité, sur eux d'abord et par là l'autorité absolue. Cette autorité est mortelle: on l'entend se dire à lui-même: "Pourquoi avoir une conscience et pas de souvenir". C'est qu'il ignorait vraiment ce qu'il était, avant ce jour de 1927 où il s'est retrouvé, tout cet or entre ses mains.
Ces meurtres sont accomplis, dirait-on, avec l'acquiescement des victimes, en connivence avec elles. Un jour, lors d'une fête, Arkadine conte deux histoires: l'une est celle d'un cimetière qu'un étranger visite. Sur les tombes sont inscrites des dates très rapprochées. Est-il possible, demande-t-il au gardien, que ce gens soient tous morts si jeunes ? Non, répond le gardien, ici la coutume est de ne porter sur la tombe que le temps qu'a duré l'amitié pour ces gens. L'autre histoire est celle d'un scorpion qui veut traverser une rivière. Il demande à la grenouille de le prendre sur son dos -- Tu me piquerais, répond-elle. -- Sois logique, si je te piquais, tu mourrais et je me noierais. -- C'est juste, et la grenouille obéit. Au milieu de la rivière, le scorpion la pique: elle, mourante et incrédule: "Tu m'avais dit... - Oui, répond le scorpion, mais c'est mon caractère". Buvons au caractère, conclut Arkadine. Arkadine est-il un héros tragique moderne ? Il porte sa culpabilité personnelle même lorsqu'il n'en a pas le souvenir, il a fait de son "caractère" la cause nécessaire de ses crimes et s'est composé un visage en conséquence -- sa fille le lui fait remarquer. Elle a reçu en dot le sacrifice.
Lorsque le dernier témoin a disparu, l'aventurier retourne en Espagne, afin de tout révéler à Raina. Alors qu'Arkadine arrive par les airs -- il a un avion privé, on entend sa voix, par le haut-parleur de l'aérodrome, ordonnant qu'on lui passe sa fille. On lui obéit, mais au moment où Raina prend le micro, l'aventurier s'est glissé près d'elle est lui dit de prononcer ces mots: "C'est trop tard". Elle les prononce, et l'on entend un sifflement, comme si le ciel entier s'engouffrait par le haut-parleur. L'avion désormais vole sans pilote, il est vide, Arkadine a été enlevé au ciel. Arkadine a appris son propre secret et se tue comme il a tué les témoins, lorsque l'aventurier lui dit qu'il révélera tout à Raina, Arkadine de brute féroce devient pathétique, victime du destin. Et Raina saura, elle porte à présent le fardeau.
Ce que les mots ne disent pas, ce sont les visages de la tragédie: terribles, mais selon deux aspects opposés et pourtant contenus l'un dans l'autre. Arkadine est terrifiant de cruauté, il tue cruellement des êtres sans défense, il est pourtant accablé de cette cruauté, c'est son caractère. Raina est terrible de son acceptation: son père est un monstre, elle lui succède, elle le tue en prononçant les mots, et par quelle fatalité faut-il qu'elle répète ce qu'un vulgaire escroc la supplie de prononcer, terrifié qu'il est d'être le dernier témoin vivant. Elle, Raina, accepte sans émotion les assiduités de cet homme, il n'est pas de commerce possible entre eux. Elle désobéit à son père, c'est de cette désobéissance qu'il mourra. En quoi ressemble-t-elle à Antigone ? D'abord par son père monstrueux et par le secret que son visage toujours dissimule: elle est l'énigme même. Elle a surmonté la crainte, elle sait qu'elle est promise à la seule autorité, quoique nul ne puisse dire comment elle en usera ni en mourra. Sitôt Arkadine mort, elle est transfigurée et absente du monde humain.
17) Je ne me donnerai pas le ridicule de situer son apparition historique, j'ai trop ri des Passions et des intérêts de M. Albert Hirschman pour cela. Disons que le héros moderne se dessine avec les figures de l'esprit de révolte contre l'institué scolastique-religieux. Mes préférences me portent vers Spinoza et je laisse l'axiologiquement neutre à ceux qui en font profession de foi.
18) Voir Principes de la doctrine de la science de Fichte.
19) Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, essai sur l'extériorité, Paris, Livre de poche, 2006, p. 322-323.
20) Voir la conclusion de mon Principe de misère, Éditions du Félin, 2007.
21) E. Lévinas, Op. cit., p. 191-192 en particulier
22) On ne saurait se contenter de la note (Op. cit., p. 419, note de la p. 119), selon laquelle Créon insinuerait que Tirésias s'est laissé acheter. C'est bien de Créon qu'il s'agit.
23) Sören Kierkegaard, "Tragique ancien et tragique moderne" in Ou bien... ou bien, Paris, Laffont, 1993, p. 137.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter