Adolf Hitler
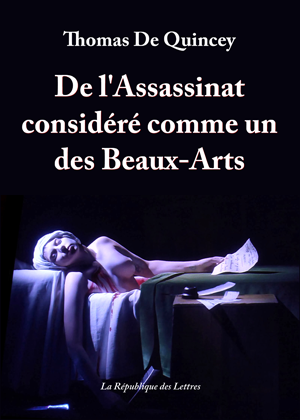
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques

Antoine Raybaud a demandé à Renate Böschenstein, professeur à la Faculté de lettres de Genève, et qui dirige un séminaire de recherche sur la littérature contre le fascisme et contre le régime de la R.D.A., de dessiner quelques positions d'écrivains en Allemagne au regard de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler.
Alors que l'opposition des intellectuels et des écrivains a été une des premières à se déclarer (avec Ricarda Huch, Heinrich Mann, puis les émigrés à Paris, etc...) la rafle géante de la Gestapo, après l'attentat du 20 juillet, tombe d'abord sur des théologiens, des économistes, etc., mais pas sur des écrivains. Que s'est-il passé ? Ont-ils déjà été tous dispersés ou neutralisés, se sont-ils désengagés ?
C'est plutôt dû au milieu très spécial de ce cercle de résistance, militaires, aristocrates sans contact personnel avec des écrivains. De plus, beaucoup d'entre eux se sont dispersés et puis il fallait garder le plus grand secret. Comment aurait-on contacté ces écrivains ? Quelqu'un comme Klepper qui était un poète très marqué par le théologie protestante, qui a beaucoup eu en commun avec la pensée du cercle de Kreisau (Delp, Bonhoeffer, von Molkte), était mort: marié à une juive, il s'est suicidé avec elle et sa fille cadette en 1942 quand ils se sont sentis pris dans la nasse, après avoir pu faire sortir la fille aînée. C'était en 42, et bien qu'il ait été très croyant. Ricarda Huch avait eu des contacts avec Elisabeth von Tadden, exécutée après le 20 juillet: d'aristocratie prussienne, et par là en contact avec le groupe, E. V. Tadden, en bonne jeune fille de l'aristocratie poméranienne avait été éducatrice à la cour de Guillaume II et en avait retiré une image très négative de l'impérialisme, aussi dans sa famille avait-elle animé l'esprit de critique qui l'avait rendue hostile à Hindenburg. Elle a payé de sa vie. Ricarda Huch avait fait sa connaissance.
Parlons de Ricarda Huch.
Elle a déjà prouvé son courage lors de l'affaire de l'Académie en 1933, très tôt après la prise de pouvoir, en mars, comme on alignait toutes les institutions culturelles. L'Académie des arts de Prusse, très ancienne, s'était ouverte à la littérature en 1920. C'était un grand honneur d'en faire partie. Tout de suite on a demandé au Président de faire signer une déclaration d'allégeance au nouveau régime. Elle, qui était une grande dame de la littérature, a refusé. Elle s'est rangée du côté de Döblin, H. Mann, des socialistes, des Juifs qui étaient condamnés à l'exclusion. Ricarda Huch a refusé de signer, et souligne au Président qu'elle lui dénie le droit de poser une telle question, que l'on était appelé à l'Académie pour ses mérites littéraires, et non pas selon une confession de foi politique. Ricarda Huch était non-marxisante et historienne, ancrée dans la vieille culture allemande. Elle a coupé court et les termes de son refus sont devenus très célèbres. Et elle quitte définitivement l'Académie.
Et pendant dix ans, elle ne baisse pas sa garde...
Elle était une trop vieille dame pour faire de la résistance active. Et puis, il faut penser à que point dans un régime totalitaire, dans la méfiance générale, on est dans l'isolement, et il est très difficile de prendre des contacts. Ricarda Huch a d'ailleurs eu des ennuis lorsque son gendre, professeur de droit, a été dénoncé vers la fin des années trente. Lui a perdu son poste et elle a dû répondre à un long interrogatoire. D'après l'amie qui a édité sa correspondance, elle et sa famille ont été bouleversées par l'annonce de l'attentat. Dès la fin de la guerre, elle a fait le projet d'un martyrologe du 20 juillet, et elle a engagé un travail énorme de recherche - mais c'est un projet qu'elle n'a pas pu mener à terme, elle avait plus de quatre vingts ans. Elle voulait faire quelque chose sous forme de portraits, comme elle avait fait pour la révolution de 1848: une forme particulièrement innovante. Elle était en contact avec Gollwitzer, un théologien qui est devenu un des théologiens les plus connus en Allemagne, encore jeune pasteur qui l'a mise en contact aussi avec Niemöller, qui a été en camp de concentration pour ses sermons à la fin des années trente. Elle avait d'ailleurs, pendant la guerre écrit une lettre - c'était très courageux - à l'évêque de Münster, le comte de Galen, un théologien catholique qui avait pris position publiquement contre le nazisme, en chaire, pour les persécutions contre les Juifs. Le défaut de Ricarda Huch, ce qui fait qu'elle n'a pas l'écho qu'elle mériterait, c'est le caractère traditionnaliste de sa forme: on pense toujours que la hardiesse intellectuelle doit s'exprimer par la hardiesse formelle, ce qui est faux à mon avis. Elle voulait découvrir les racines de cette résistance dans la personnalité de l'homme - et elle en aurait déployé comme une galerie. Elle s'est encore engagée dans un mouvement de soutien aux familles des victimes.
Stauffenberg lui-même a beaucoup à voir avec la littérature: très littéraire dans son enfance, grand lecteur de Guillaume Tell et Wallenstein, les drames de Schiller, il a joué Lucius dans le Jules César de Shakespeare. Il lit Hölderlin, Rilke. Et surtout il est un disciple de Stefan George, et disciple d'élection. Il semble que l'ascendant de Stefan George ait été très fort...
En souabe, il y a eu les poètes comme Hölderlin ou Schiller qui appartiennent à toute l'Allemagne cultivée, et il y avait malheureusement au moment du nazisme un chantre célébré et honoré par le régime qui s'appelait Gerhart Schumann que personne ne connaît plus, mais qui avait alors une place très importante dans l'organisation culturelle du nazisme. Mais l'influence de George, une action en faveur du renouveau de la culture était sûrement pour beaucoup dans la décision de Stauffenberg. Stefan George n'était pas seulement un poète, il voulait créer une école, au sens platonicien, former des jeunes gens pour fonder une nouvelle culture qui aurait son modèle dans la culture grecque: l'idéal héroïque et aussi la participation à la vie politique en faisaient partie...
Mais Stefan George méprisait le politique, le jugeait de très haut.
Il méprisait la politique politicienne, oui. Déjà très jeune, il était très critique du Reich de Bismarck et de Guillaume II, dans leur volonté de substituer à l'Allemagne ancienne, dont la gloire était la culture, une Allemagne de puissance mondiale. C'est ce qu'on trouve dans des lettres et de discours. Ses poèmes disent le mépris de l'époque actuelle sous des formes moins directes. Il avait la même critique que Nietzsche - dont il différait du tout au tout à d'autres égards - contre les valeurs de la société bourgeoise qui se fondaient sur la victoire de 1870. Mais c'est lui qui a dit: "Quand j'étais jeune, si j'avais eu une armée de 20.000 personnes, j'aurais vaincu l'Europe", et qui se voyait un peu comme Napoléon. Il a transféré ce désir dans l'ordre de la poésie, et espérait jouer un rôle par le biais de ses disciples: il ne rêvait pas de faire des disciples poètes (la plupart sont plutôt devenus professeurs - Histoire de l'Art et philosophie très inspirés de Stefan George), mais des disciples qui dans les domaines de la société pourraient agir, réaliser la vie haute (das schöne Leben), spirituelle, sans plus de division entre psychisme et physique - une conception de l'homme entier.
La démocratie neuve d'une élite de héros...
Oui, élite est un mot très positif sous sa plume...
...qu'il aurait essaimée à travers la société...
Il voulait former des artistes, des sculpteurs. S'il y en a eu moins qui se sont lancés dans la politique, c'est dans la logique de son école que Stauffenberg voyait les nazis, comme des faux héros (il y a eu pourtant des disciples de George qui ont cru retrouver un idéal chez les nazis, mais ils n'ont pas été nombreux) - mais formé à l'image du vrai héros, en homme de haute culture, il a bien vu que les nazis n'étaient qu'une contrefaçon du modèle et, dès lors, c'était à lui de jouer le rôle que Hölderlin a toujours imparti à ses héros grecs: le tyrannicide, par exemple les libérateurs de la Grèce, Harmodios et Aristogieton. C'était là le modèle à suivre.
Ceci permet peut-être jusqu'à un certain point de comprendre que Stauffenberg, jusqu'en 1938, s'il n'était pas hitlérien, était en tout état de cause exalté par l'aventure hitlérienne. En 1933, il écrit une lettre à Stefan George pour lui annoncer une "grande révolution", il a été ensuite très heureux de la chevauchée de ses panzers. Et quand il parle de la campagne de France, il écrit une lettre, et justement à son libraire, où il dit du Führer: "Cet homme n'est, à coup sûr, pas fils de petits-bourgeois: il est fils de la guerre". L'ébranlement donné par Hitler aux institutions, et à la situation militaire et internationale de l'Allemagne, ne l'a pas heurté d'abord. Il faudra que se cumulent, d'abord, les méfaits SS envers les Juifs et envers les Polonais. Là Stauffenberg parlera de sa honte.
Pour ce qui est du modèle de George, il faut distinguer plusieurs phases. A la fin de sa vie, il n'aurait plus considéré la guerre en termes positifs. En 1933, déjà très malade, en Suisse, il n'est pas intervenu sur le nazisme. Mais qu'une révolution soit appelée à renouveler l'Europe décadente, c'est une idée qui était très répandue en Allemagne avant la première guerre mondiale - on en a beaucoup de témoignages à Berlin et à Munich. Les plus lucides trouvaient effrayant le naturel avec lequel on disait avoir besoin d'une guerre pour purifier la société: Thomas Mann décrit très bien ce phénomène dans le Doctor Faustus, mais déjà la guerre de 14-18 avait détruit cette euphorie. George, qui au début avait partagé cette foi, le dit dans un poème très cité: Viele Untergange Ohnewürde (beaucoup de déclins sans honneur). Il a aussi vu la réalité de la guerre: beaucoup de ses disciples y sont morts. Aussi voyait-il plus clair. Claus von Stauffenberg était encore jeune, mais il y a là une position difficile à reconstruire: une sorte, je ne dirais pas de nationalisme, mais de foi dans les valeurs traditionnelles - comme la patrie, l'honneur, la fidélité, la bravoure (devise SS), la noblesse, qui interviennent fortement dans l'idéologie nazi, ne doivent pas être outrageusement simplifiées. Il y a à nuancer: des jeunes gens ont vu dans le nazisme une continuation des traditions reçues de leur famille, tandis que d'autres ne voyaient là qu'un déniement de cette tradition par des partisans qui en étaient indignes. Et cette seconde optique a joué un très grand rôle dans la résistance et aussi parmi les conjurés du 20 juillet, de la part d'une noblesse qui méprisait les nazis. On cite toujours le mot de Hindenburg qui a accepté Hitler à contre-coeur: "der böhmische Gefreiter", le caporal de Bohême. La question se pose pour Ernst Jünger...
Il faut ici s'arrêter un peu parce qu'on touche à quelque chose de très important: l'interprétation du 20 juillet comme un complot "national-conservateur", expression d'une aristocratie tant civile (Graf von Molkte) que militaire (Claus von Stauffenberg, Graf von Tresckov), appuyée par les "hautes classes" (Hoher Schichter) contre la "révolution national-socialiste". C'est d'ailleurs la version qui était celle du "caporal de Bohême" en personne qui enjoint à Himmler, après le 20 juillet, de s'attaquer aux "hautes classes", comme on l'avait fait pour la Gauche dix ans plus tôt, et qui annonce à la radio l'échec du complot, comme la conjuration d'un "clique d'officiers ambitieux" que Martin Bormann qualifiera "d'officiers réactionnaires".
Je veux rappeler un souvenir personnel qui me revient. A un cours de vacances où j'étais, un ministre du gouvernement de Bonn, un noble a fait un exposé sur le 20 juillet, l'a présenté comme un acte de l'aristocratie. Et des étudiants se sont insurgés là contre, ont affirmé que la résistance était l'affaire du peuple, non de l'aristocratie. Et l'orateur s'est énervé et disait: "Mais qui a joué sa tête ?? !". Jünger, dans son journal Strahlungen, qui décrit son séjour à Paris, trouve très typique que des nobles prennent l'initiative. Au début de l'année 44, il note (sur le moment ? Après coup ?) que l'état-major de Stülpnagel était suspecté de trahison -- de désertion --, bref anti-nazi. C'est l'année aussi où le jeune fils de Jünger (17 ans) est arrêté, comme aide-soldat, pour critique envers le régime, et Jünger a vu qu'il était mal reçu à Berlin (où il était venu pour défendre son fils). Puis l'état-major a été dissous, et lui Jünger, renvoyé dans ses foyers ; et Stülpnagel appelé à Berlin a tenté de se suicider sur le trajet Paris-Berlin, y a perdu la vue, et a été jugé dans cet état à Berlin.
Etait-ce le Stülpnagel qui sévissait brutalement, à ce moment en France ? Le général qui a fait montre de beaucoup de brutalité envers la résistance était Otto v. Stülpnagel, qui lui avait paru manquer de compétence, et avait été rappelé. Ce qui me frappe, c'est que le même Stülpnagel ait sévit si durement au nom du Reich et en même temps comploté contre Hitler.
Peut-être les deux Stülpnagel partageaient l'idée qu'ils avaient d'abord à mener la guerre, et ceci montrerait qu'ils étaient moins conduits par des problèmes de conscience que par le souci d'éviter un désastre à l'armée allemande devant la coalition alliée. Quant aux sévices, les journaux de Jünger montrent qu'il était choqué de la manière dont des jeunes approuvent des mesures de représailles lors d'attentats contre des soldats ou Allemands.
Mais Jünger était-il au courant qu'au-delà d'un attentat, un coup d'état allait éclater ? Non seulement pour renverser Hitler, mais pour lui substituer un autre régime ?
Jünger n'avait rien contre l'élimination d'Hitler qu'il appelait "Diabolo" le diable (comme Goebbels, "grand gaucher"). Mais on touche là un point vulnérable de la mentalité d'alors: Jünger n'attendait rien d'un attentat. Il était convaincu que les grands mouvements de l'histoire ne dépendent pas d'un personnage. Pour lui, ça n'avait pas beaucoup de sens d'éliminer Hitler. Il partage avec d'autres intellectuels de son époque une certaine pensée à l'égard de l'histoire. C'est vrai pour toute l'image du monde de Jünger: il y a un deuxième monde derrière la réalité, et c'est dans ce monde que les vrais mouvements se font. C'est difficile de décrire précisément cet autre monde: Ernst Jünger est le magicien qui voit ce monde et ses effets sur le monde réel, mais il n'y a pas comme chez les romantiques des références à la philosophie: rien de tel chez lui. Je crois, quant à moi, très néfaste cette confiance de certains intellectuels à quelque chose qui n'est pas la surface, et qui "en profondeur" serait la vraie réalité des choses: un sens, derrière, qui se réalise, sans que Jünger soit jamais très clair à cet égard. A Paris justement il avait commencé à écrire un essai sur la paix, il pensait qu'avec cette guerre le rationalisme technicien était parvenu à sa fin absurde et qu'alors la vraie raison, spirituelle, devait se réaliser. Il ne prend pas position pour la guerre, cette fois, comme dans la première guerre mondiale, en termes bellicistes...
La guerre que recommande Goethe, à la fin du second Faust, avec le personnage d'Euphorion, le fils de Faust et d'Hélène.
Non, non, il ne faut pas prendre cela à la lettre. D'ailleurs lors des guerres de Napoléon, on lui a plutôt reproché ses réticences au moment où les états allemands se mobilisaient contre les Français... Jünger, lui, donne un sens à la guerre en tant que sacrifice nécessaire pour l'avènement de l'esprit, de la raison purifiée. Il aura fallu toutes ces victimes de la guerre. Tout ceci me semble assez dangereux.
Une conception sacrificielle de la guerre.
Une apologie. Je voudrais encore poser la question: pourquoi ce projet de Ricarda Huch ? J'en reste à la question. Mais il faut relever que ni en R.D.A., ni en R.F.A., il n'y a rien eu d'autre. Peut-être est-ce que, en R.F.A., les écrivains très vite ont pris le parti de la critique de la "restauration".
Un âge de la critique, qui refuse la tragédie. En Allemagne, va-t-on célébrer le 20 juillet ? On ne voit rien poindre en France, où l'on célèbre, et avec beaucoup d'éclat, le débarquement allié, et bientôt la libération de Paris. On est encore capable de commémorer l'épopée, mais on se dérobe devant la tragédie, on se révèle incapable d'affronter l'histoire dans ses plus grandes tensions, mais sur le mode de l'échec.
En Allemagne, après la guerre, nous étions la génération sceptique, ironique, et on se méfiait des grandes questions. Notre point de départ était la catastrophe du faux héroïsme et par là le tragique était récusé. Et justement Ricarda Huch voyait le 20 juillet comme un mouvement religieux sans qu'il soit nécessairement le fait de pratiquants, c'était Dieu contre le Diable. Mais, en profondeur, après la guerre, il n'était plus question de cela.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter