Yehuda Amichaï
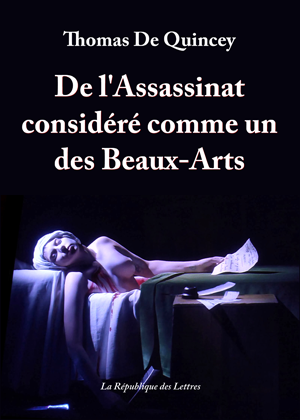
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
LE MONDE EST UNE CHAMBRE
Ils revinrent par un chemin différent de celui qu'ils avaient emprunté pour sortir, traversant la moitié d'un bois avant d'arriver à une vallée absolument vide de tout : vide de pierres et d'arbres et d'hommes. Au loin, ils entendirent les cris d'enfants en train de jouer. Il tira son appareil-photo et la photographia. Puis ce fut son tour à elle de le prendre en photo. C'est ainsi qu'il leur resta de ce merveilleux jour une photo où ils s'embrassent tous les deux. Mais par quel hasard la chose avait-elle pu se produire, puisque l'appareil n'était pas automatique et qu'ils avaient été les seules personnes de cette vallée aussi vide qu'une planète fraîchement découverte ? Qui avait pu les photographier ? Qui avait suivi le cours de leur destin et tenu leur pâle sourire en face de la lumière ? Qui avait tout vu ?
Ils passèrent par Tivon, gravirent une colline. Elle eut de nouveau le corps scié en deux, la tête fatiguée. Toute l'enfance en elle était fatiguée, comme la mer dans ses yeux avec tout son fretin et ses regrets. Il lui enroula les bras autour des épaules et sa petite tête brisée s'y nicha. C'est ainsi qu'il la ramena de la vallée comme on ramène une morte. Au moment où ils s'assirent dans l'unique petit café du lieu, la radio jouait une ravissante mélodie. Longtemps plus tard, il se souvint que la guerre avait éclatée aux dernières notes de la musique, quand elle s'était fondue dans les premiers coups de feu. En réalité un intervalle de quelques heures s'était écoulé entre les deux moments que la distance de la mémoire confondait ensemble. Cette nuit-là, tout avait changé dans le pays. La voix du monde avait muée comme à la puberté ; la voix du monde était devenue dure et rauque sans qu'ils le sachent puisqu'ils continuèrent à ne garder de lui que son timbre pur.
Ils se levèrent pour régler leur café, ils n'oubliaient jamais de payer pour la tranquillité de ce soir aussi, ils payèrent le prix de nombreuses nuits de guerre. Les amants payent sans regarder au prix, et ne volent pas la différence qui existe entre une monde vide d'arbres et d'humains semblable à la vallée vide de l'après-midi et un monde affublé de multiples camouflages. Puis ils retournèrent en ville, il retrouva sa chambre de célibataire. Les propriétaires de la maison étaient absents et il s'offrit un bain chaud. Quand il eut fini, il rinça la baignoire et la regarda se vider. Il songea aux derniers jours d'été qui s'éloignaient lentement pour ne plus revenir. C'est cette nuit-là que fut décidée la partition du pays. Les gens descendirent dans les rues, l'orchestre des pompiers inaugura une nuit d'étranges danses. Elle vint chez lui à la manière d'une amnésie bénite. Quand il s'assirent ensemble, la clameur les recouvrit et ils s'en firent une cachette. L'immense joie roula comme une balle dans la nuit, rebondissant d'un visage à l'autre pour retomber dans l'espace vide qu'ils avaient laissé. Elle roula jusqu'au matin et se perdit quand furent tirés les premiers coups de feu. Des voitures circulaient déjà, dévoilant des regards graves et pâles, dissimulant des armes ; d'autres voitures passèrent encore drapées de leur première mort.
Deux ou trois jours après, elle vit un cadavre pour la première fois. C'était celui d'une femme. Mortellement touchée au côté, elle gisait sur l'autre flanc. La morte semblait se plier à la mode de l'époque qui était de souligner le galbe féminin : couchée comme elle l'était, elle bombait le bassin et sa longue chevelure trempait dans une épaisse mare de sang.
Son amie s'offrit de descendre dans la ville basse, isolée et cernée de maisons arabes (...).
Puis il lui annonça que dans trois jours il devait rejoindre son unité. Il la raccompagna chez elle. Ils entendirent une explosion et un fracas de vitres soufflées. Pourquoi ne préservait-on pas suggéra-t-elle, les objets fragiles du monde entier. Les vitrines pouvaient être utiles pour les générations futures, ou pour les anges qui les fixeraient aux fenêtres du firmament. Les gens d'aujourd'hui sont incapables de conserver les objets délicats et fragiles. Le verre est la chose du monde qui se casse le plus vite (...).
Il rejoignit le régiment de ceux qui brisèrent le siège de Jérusalem. Il se retrouva bientôt perché sur le toit d'un château d'eau à proximité de la route. Dans un moment d'accalmie, il inscrivit son nom à l'encre noire sur le parapet. Chaque fois qu'on évoque son nom, les gens disent : "Attendez voir, bien sût je connais son nom", mais ils ne le reconnaissaient pas, vu que toutes les pluies et les vents effacent son nom. Puis ils commencèrent à s'écrire des lettres. Il fut transféré dans le sud du pays et connut de nouvelles terres. Il se dit : Cette guerre est comme mon menton, mes coudes ou mes genoux, touchent la pierre ou le sable ou l'argile rousse. Et d'épineux halliers veillent telles des sentinelles au-dessus de ma tête fatiguée. Il y avait des paysages qu'il n'avait connus que la nuit, à la manière dont Itzhak avait connu Yaacov : en touchant et en humant l'odeur des champs. Il ne savait plus qui bénir ou maudire. Il n'était pas un héros mais un homme sans peur. Après quelques batailles s'abattit sur lui la fatigue. Il alla jusqu'à s'endormir au cours d'un bombardement. Il arriva aussi que par fatigue le destin se trompa : ils amenèrent un canonnier dans l'unité, et il fut versé par erreur à l'infanterie. C'était le temps où on cherchait dans tout le pays des canonniers et lui fut envoyé dans une division de fantassins. Il mourut dans une bataille. Par erreur. Puis ils se retirèrent à travers les terribles sables blancs. Le canonnier mort resta étendu sur la voie de chemin de fer qu'on n'utilisait plus pour voyager. Dans leur groupe, il y avait un anglais chrétien qui s'appelait Shelley. Toute la nuit, comme ils marchaient vers la dernière bataille, au bout de leur retraite, il songea au nom de l'Anglais qui était le même que celui du poète dont il ne connaissait probablement pas les poèmes. Le volontaire anglais portait un chapeau tropical à larges rebords, en souvenir de l'Empire des Indes. Ils se rencontrèrent avant la bataille quand ils s'arrêtèrent bivouaquer au milieu des ruines d'un camp militaire abandonné. Les bâtiments avalent blanchi : on discernait ce qu'avaient été la cuisine, le club des officiers et les douches. A la première relève de l'aube, l'Anglais était mort de ses blessures. Ses yeux moururent sous le chapeau tropical aux larges rebords, et avec lui la mémoire du poète. Les vestiges de la division se retirèrent dans un kibboutz où ils ne trouvèrent plus de nourriture à cause du siège : aussi mangèrent-ils des galettes de pain azyme. Puis le kibboutz fut bombardé à son tout et ils se réfugièrent de nuit dans le même camp militaire à moitié détruit. Avant d'abandonner le kibboutz, il se reposa dans l'une des chambres évacuée de ses occupants. Sur un buffet étaient disposés de rares objets de céramique et une étagère remplie de livres de Marx, des traductions de la Bible de Rosenzwelg et de Buber, et des poèmes de Rilke. Par les fenêtres on voyait les arbres et plus loin encore d'autres arbres, près des positions de l'ennemi.
Le lendemain, des avions passèrent au-dessus de leurs têtes, et ils se mirent debout à crier "Ces sont les nôtres ! Ce sont les nôtres !", jusqu'à ce qu'un avion leur tire dessus et lâche des bombes. Quand il revint dans sa tranchée au pies de la colline, il lui écrivit une lettre : "D'ici peu, je remonterai vers le nord. Quand le siège sera fini". Une autre fois il lui écrivit : "Quand les nuages se transformeront en pluie et la pluie en prés et les prés en joie, je reviendrai". Et il ajouta qu'elle ne devait pas pleurer. Elle répondis que les pleurs meurent dans le désert, quand tout s'achève.
Il souffla un antique vent de Mésopotamie qui sécha ses larmes et sa sueur ; les jours difficiles furent oubliés. Les choses difficiles meurent en douceur : la pierre sombre dans le sable. Les dures paroles d'Isaïe s'enfoncent dans les coeurs sans laisser de traces. Son âme endurcie coula au fond de sons amour. Son amie fut mobilisée et envoyée enseigner l'hébreu en Galilée à des soldats nouveaux immigrants. Il finit par quitter le siège en avion sur une piste poussiéreuse éclairée par des torches. Le lendemain, il était à Safed où son unité stationnait.
Il traversa un pont et arriva au monastère, qui servait de quartier général, il entra dans le bureau : "D'où venez-vous ?" Il expliqua d'où il venait. Tout en parlant, il regardait le Lac de Tibériade par la fenêtre. Il pensait que c'était bien plus important que de regarder son interlocuteur. On l'envoya chez une femme-officier qui l'informa que son amie avait été accidentée sur la route et transportée dans un hôpital de Haïfa. Elle lui suggéra de dormir sur place, mais il voulut une voiture pour Haïfa. Il n'y en avait pas et il descendit jusqu'à Rosh-Pina. Là il guetta une voiture qui ne vint pas. Il vit s'approcher l'obscurité. Le monde lui parut être une énorme chambre, dont villes et villages constituaient le mobilier. Il se mit à marcher vers Tibériade. Le monde était une énorme chambre et au bout de cette chambre son amie reposait dans un lit. L'écho net de ses pas retentissait encore sur la route quand il entendit des voix derrière lui. Et de ces voix émergèrent deux blouses blanches. Les voix et les blouses étaient celles de deux jeunes filles du kibboutz voisin. Elles portaient des pantalons courts et aussi noirs que la nuit, mais leurs jambes nues et leurs chemises blanches éclataient de lumière. D'où venait-il ? Il le leur dit, et ils se découvrirent des amis communs. Le pays entier était fait d'amis, tous mobilisés dans un régiment ou un autre, ou bien morts.
Il arriva au kibboutz, encadré par ces deux voix, abasourdit. On l'invita à entrer et à passer la nuit. Les bâtiments du kibboutz s'étageaient sur le flanc d'une montagne, dont le sommet était invisible la nuit. Il effleura les cheveux de l'une des filles qui dit : "Viens avec nous".
La nuit se parfuma de l'odeur du gâteau au beurre apporté par les filles et de l'odeur des terres désertées. Assises, elles continuaient à lire. Il s'excusa de rester silencieux, il était fatigué. Elles lui dirent qu'il pouvait se déshabiller sans gêne. Elles étaient seules au monde avec lui et les quelques canons dissimulés sous un treillis qui les faisait ressembler à de gros poissons tirés de la mer. Il se dévêtit et se coucha nu. Elles aussi se déshabillèrent, si bien que trois tas de vêtements s'empilèrent bientôt en face des trois lits. Des filles comme elles ne portent pas grand chose l'été, surtout quand elles se retrouvent seules entre deux combats, au côté des canons muets. Tous les trois regardaient le plafond de leurs lits respectifs. Il essaya vainement de régler le rythme de sa respiration sur celles de ses voisines. Il ne s'endormit pas et resta éveillé à se demander s'il pouvait les rejoindre. Elles furent bonnes pour lui, elles étaient jeunes et le monde était une chambre vide dont ils étaient les seuls occupants. Il fini par s'apercevoir que l'une d'elle s'était déjà endormie tandis que l'autre gardait les yeux ouverts. Il s'approcha et elle le laissa entrer dans son lit. Il mit sa main sur sa hanche. Elle lui prit la main et la posa sur son ventre plat et frémissant.
Quand il se réveilla le lendemain matin, il vit que les lits des deux filles étaient vides. Il descendit sur la route et trouva une voiture. Une fois qu'il fut à Haïfa, il accourut à l'hôpital, entra dans une salle traversée d'une longue rangée de lits qui semblait, à cause de la perspective, ne jamais avoir de fin.
Quand il était petit, il demandait à son père de lui dessiner des pièces de maisons en perspective. C'était pour lui une sorte d'acte magique. Depuis, il avait appris lui-même la perspective et connaissait bien toutes les distances et les altérations dues à la distance.
Elle guérit et la guerre reprit. Ils se voyaient durant les cessez-le-feu. Parfois son amour pour elle prenait le parfum sauvage des figuiers. Brusquement cet amour l'envahissait et il avait du mal à l'esquiver. Une fois il vint derrière elle sans qu'elle le voit s'approcher, il lui planta les mains sur les yeux, il lui demanda : Devine qui est-ce. Elle savait, mais ne souffla mot. Il arrivait ainsi au destin de revenir vers eux et de jouer aux devinettes. Ils devinaient alors les noms d'ennemis et d'amants et d'autres. Mais il ne devinèrent jamais à qui appartenait la main du destin. Aussi quand cette main se referma sur leurs yeux, ils devinrent aveugles.
Elle lui rendit visite au camp militaire deux jours avant la conquête de Beer-Sheva ou d'une autre ville. En sortant, ils virent un caroubier solitaire, et ils firent l'amour sous sa feuillée. Il dit : "Ecoute, nous avons donné notre part à la construction du pays. Nous avons écrasé les chardons, amendé la terre". L'endroit où ils se trouvaient était légèrement plus élevé que les terres du sud qui les entouraient et de ce promontoire il dirigèrent des rayons de bonheur vers la plaine.
Puis ils rentrèrent au camp, dans le réfectoire où le repas tirait à sa fin. Une confiture douce et épaisse de melon de Californie était répandue sur les tables entre les quignons de pain déjà rassis. Il l'attira à lui et l'embrassa. Les autres apprirent ainsi qu'elle était sienne. On entendit des chuchotements aux coins de la salle. La lune monta dans le ciel et s'arrêta à la verticale d'un canon de tank garé dans la cour.
La guerre ne les toucha pas du tout. Ils étaient comme des canards protégés de l'eau par leur plumage. Elle était occupée par le problème de son corps lourd et de sa tête enfantine, lui par le problème de l'avenir et par la vue des paysages à l'autre bout des fenêtres. Ne luttant pas contre le destin ni contre la guerre, cette dernière les survola sans préjudice. Ils ressemblaient à une maison vide aux fenêtres ouvertes, le vent les croisait.
Et c'est ainsi qu'arriva leur fin. Elle épousa le soldat avec qui elle avait eu son accident de voiture. C'était la conclusion claire et logique d'un accident partagé, d'une dégringolade commune sur la pente d'une colline de Haute-Galilée. Et lui aussi, préservé par la guerre, n'a plus guère d'intérêt pour nous. C'était un homme qui ne vivait pas à l'ombre de sa fin. Il n'appartenait pas à cette race de gens vivant dans la vallée au pied d'une haute montagne qui projette son ombre sur eux, influençant leur vie et leur fin. Rien ne les obligeait, ni lui ni elle, et les liens qui avaient pu autrefois se tisser entre eux étaient illusoires, comme dans les histoires.
Yehuda Amichaï
Traduction Michel Eckhardt-Elial
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter