André Gabastou
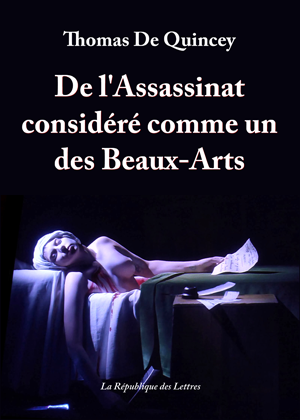
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
La langue basque, autrement dit l'euskara, a toujours été perçue comme un phénomène d'une telle étrangeté qu'on n'a pu s'empêcher de proférer à son sujet les plus redoutables sottises. A l'aube des temps modernes, Scaliger disait que c'était "le vieil espagnol, comme le breton bretonnant est le vieil anglois", et récemment un haut responsable de la société espagnole soutenait sans ciller que son usage devait se limiter à la cuisine, provoquant sur-le-champ des manifestations de rue dans tout le territoire d'Euskadi. Si le premier méconnaissait l'étymologie, il est fâcheux que le second n'ait pas lu ce que disait Jakobson de l'équivalence ontologique des langues.
L'euskara est parlé dans un pays à la fois réel et fictif. Pays fictif dans la mesure où il n'y a jamais eu dans l'histoire de nation basque, tout au plus un territoire qui s'est revendiqué comme tel, tracé par des hommes qui avaient emboîté le pas aux romantiques allemands à qui on doit la notion de peuple comme unité spirituelle (Volkgeist), et qui réunit sous une même bannière trois provinces françaises et quatre espagnoles. Pays réel cimenté par l'usage d'une même langue vernaculaire aux frontières fluctuantes, surtout en Espagne, où elle perd ici et là du terrain et en regagne ailleurs, alors qu'en France ses frontières n'ont pratiquement pas bougé depuis quatre siècles.
Le Pays basque contemporain, dans son extrême fragmentation spatiale, temporelle, linguistique (on ne comptait pas moins de huit dialectes littéraires sous l'Ancien régime), géographique, est une région laminée par un siècle de bouleversements sociaux, politiques et économiques. Après avoir été tirés à hue et à dia par les divers royaumes qui chevauchaient les Pyrénées, les Basques ont connu sur leur sol toutes les guerres auxquelles s'est livré ou a été livré le XXe siècle: société urbaine contre société rurale (paradigme des écrits "basques" d' Unamuno qui écrivait en castillan), marxisme et syndicalisme contre catholicisme, irrédentisme contre centralisme, etc. Seul point d'ancrage dans ce vertige de l'histoire : la langue, "âme du peuple", avec laquelle les Basques se sont dès le départ identifiés.
Dans ce monde si chaotique, où toute déception, depuis l'échec carliste, en appelait une autre, elle a illustré une permanence, jeté un pont entre ceux qui, à l'instar de François-Xavier, allaient arpenter le monde, et ceux qui restaient, et elle a été plus qu'un instrument de communication ou un moyen d'expression pour le créateur solitaire. Lieu de communion et de partage, elle s'est érigée en grand corps mystique et eucharistique, et ce n'est nullement un hasard si, feuilletant des anthologies de la littérature basque, y compris les plus contemporaines, on est surpris par la prééminence des hommes d'église.
En terre basque, la poésie est privilégiée, d'une part parce qu'elle se rattache sans rupture à la tradition orale des chansons populaires et des improvisations des bersolaris, et d'autre part parce que l'incantation y a presque toujours pris le pas sur le sens (évolutif par essence). Et dès ses premières formes, cette poésie a fait de la langue, (sa nature, son statut, ses objectifs) sa préoccupation majeure, comme en témoigne le premier ouvrage écrit en euskara, Lingua Vasconum Primitiae, publié en 1545 par Bernard Dechepare, curé de Saint-Michel-le-Vieux en Basse-Navarre: "Euskara, sors dans les rues ! / Béni soit le pays des Basques / Il a donné à l'euskara tout ce dont il a besoin / Euskara, sors dans les places !"
Au fil des siècles, la revendication nationale s'est identifiée à ce corps mystique de la langue qui a servi tour à tour à véhiculer une vision angélique d'un monde disparu (rural et catholique, très catholique, n'oublions pas que les Basques se sont longtemps considérés comme plus espagnols que les Espagnols parce qu'étrangers à l'Espagne hybride des trois cultures d'avant 1492 et les meilleurs dépositaires des vertus chrétiennes), ou à exprimer l'altérité radicale d'Euskadi.
L'opacité de cette langue - sans rapports avec les autres langues européennes - a maintenu la littérature euskarienne dans une fonction tautologique, et la grande aventure de la poésie européenne inaugurée par Baudelaire (déperdition du sujet au profit du langage poétique lui-même), parallèle à celle de la peinture, est restée sur elle sans effet. On a pu dire sans risque de se tromper qu'elle souffrait d'achronie et qu'elle ne réagissait qu'avec retard aux grands courants littéraires européens, quand elle ne se contentait pas de les esquiver.
De fait, les traditions dont se sont prévalus les écrivains basques sont largement apocryphes. Le travail important accompli par les folkloristes et les musicologues au siècle dernier, notamment Francisque-Michel, a peu de chose à voir avec la thématique de la poésie ou du roman régionaliste dont on trouvera un équivalent parfait et édifiant dans le roman "basque" de Pierre Loti, Ramuntcho. Sous prétexte de donner la parole à une figure européenne encore inédite, ce roman obéit à une stratégie implicite qui consiste à verrouiller le minoritaire dans sa propre métaphore. Pierre Loti amorce un processus qui reste encore chez lui d'une désarmante naïveté bourgeoise et qui trouvera son expression la plus accomplie dans le triomphe du spectacle terroriste où un événement libérateur, d'une immense portée symbolique (l'exécution du Premier ministre de Franco, Carrero Blanco, en 1973), sera répété jusqu'à la dérision, le bruit des bombes répercuté sur la scène médiatique mondiale se substituant à toute parole articulée.
Cela dit, confrontés à la mise à feu et à sang d'une partie de l'Europe, l'ex-Yougoslavie, où la guerre des minorités fait rage, persuadés que seuls le jacobinisme et le centralisme nous épargnent de tels fléaux, on s'est empressé de discréditer l'idée nationale qui se confond souvent avec l'émergence de telle ou telle minorité dont elle dit, sur le mode tautologique, l'acte de naissance. La reconnaissance qu'elle cherche est une lutte qu'elle doit mener contre l'impérialisme et contre ses propres prémices, et les moyens de succomber sont infinis, aussi arrive-t-il qu'elle balbutie, cahote, retourne les armes vers elle. Le contraire suppose une gestion politique démocratique alliée à un geste poétique et ironique qui lui permet d'accéder à cette fiction babélienne, ludique, qu' Edouard Glissant apelle "l'imaginaire des langues". Et il se peut que le Pays basque, pourtant coinçé entre le nationalisme conservateur et la lutte armée, ait emprunté ce chemin.
Les livres écrits en euskara se vendent à 2000 ou 3000 exemplaires, comme en France ou en Espagne, le Guipuzcoa est la région de la péninsule qui compte proportionnellement le plus grand nombre de lecteurs de journaux, la radio et la télévision basques fonctionnent sans problèmes majeurs, ou disons comme ailleurs. Comment en est-on arrivé là ? Par une triple révolution linguistique qui a modifié de fond en comble le paysage littéraire basque : l'unification de la langue (euskara batua) en 1968 par l'Académie de la Langue Basque, la mise en place des écoles basques (ikastolak) et enfin la reconnaissance du basque comme langue d'une partie du territoire espagnol.
Dans un tel contexte, tout acte créateur est à la fois solitaire (en l'absence de grande tradition littéraire) et social (charge symbolique de toute parole transcrite en euskara), aussi n'est-il guère aisé de recenser des écoles, des tendances, comme on peut le faire ailleurs.
Trois noms ont toutefois introduit la modernité dans la lyrique basque.
Jon Mirande est né en 1925 à Paris, où il s'est suicidé en 1972. D'origine souletine, il avait appris le breton, puis l'euskara. Très influencé par Nietzsche, fasciste, il se revendiquait d'un paganisme mi-basque mi-celte, et se proposait de révéler aux Basques leur véritable identité sur laquelle pesait, selon lui, le renoncement chrétien. Jon Mirande disait à qui voulait l'entendre qu'il remettrait le Christ en croix au cas où il oserait renaître de ses cendres. Sa poésie, déchirée, hétérodoxe, s'attaquait aussi aux tabous sexuels, lourds en terre basque. Rejetée de son vivant, son oeuvre suscite aujourd'hui l'engouement.
Fillettes
Deux jeunes soeurs dansaient,
(l'endroit, je l'ai oublié).
Leurs très longs bras
me disaient en chantant
un poème, serpent amer et envoûtant.
Toutes deux, en bord de mer,
se caressaient d'amour,
leurs seins blancs tremblaient,
leurs cuisses tendres se dérobaient.
Mort à 42 ans en 1975, Gabriel Aresti est l'auteur d'un immense poème, Maldan behera (La descente, 1960), qui retrace l'épopée du peuple basque de la préhistoire à nos jours. Sans militer sous telle ou telle enseigne, Gabriel Aresti introduit dans la poésie basque les thèmes de la vie urbaine, de la lutte des travailleurs et de la solidarité prolétarienne. Sa vision du monde est marquée par un pessimisme foncier : la société basque court à sa perte. En adoptant les formules métriques des bersolaris, le lexique des paysans de Biscaye (au grand dam des puristes à cause de la présence de mots romans) ou dans le triptyque Pierre la lettre H mystérieusement proscrite, Gabriel Aresti a préparé la révolution des années 70.
B/
Je défendrai
la maison de mon père.
Contre les loups,
contre la sécheresse,
contre les usuriers,
contre la justice,
je défendrai.
On m'ôtera les armes,
et, de mes mains, je défendrai
la maison de mon père
on me coupera les mains,
et, de mon bras, je défendrai
la maison de mon père
on me laissera
la maison de mon père.
Je perdrai
troupeaux,
champs, pinèdes
je perdrai
dividendes,
rentes,
intérêts,
mais je défendrai la maison de mon père.
Sans bras,
sans poitrine,
et, de mon âme, je défendrai
la maison de mon père.
Je mourrai,
mon âme se perdra,
ma lignée se perdra,
mais la maison de mon père
demeurera
debout.
Le grand linguiste Luis Michelena et l'historien des sociétés Julio Caro Baroja (neveu de Pio Baroja) avaient entrepris un impressionnant travail de restauration du patrimoine culturel des Basques dans un contexte difficile. Après la mort de Franco s'ouvre une période de transision où la jeune génération accepte d'utiliser le nouveau moyen d'expression mis à sa disposition sans pour autant se plier à des contraintes formelles obsolètes et aux impératifs de l'engagement politique, ce qui ne veut pas dire qu'elle reste indifférente à la répression qui frappe les Basques.
Irrévérentieux à souhait, Bernardo Atxaga, né en 1951 dans un petit village du Guipuzcoa, fonde en 1977 à Bilbao le groupe Pott qui intègre les expériences des avant-gardes d'Europe, se tourne vers la Beat generation, le pop art, le rock et la pop music. Il publie des recueils de poèmes, dont le paradigmatique Etiopía (1978) qui bouleverse la poésie euskarienne (il explique dans Nations basques (Autrement, 1994) comment la traditionnelle ligne de partage de la société basque entre monde rural et monde urbain est devenue désormais temporelle : le Pays basque qui précède les années 70 et celui qui leur succède), des textes pour les enfants, et des chansons pour des chanteurs tels que Mikel Laboa ou Ruper Ordorika. Sensible et ironique, ludique et aérienne, son oeuvre est une danse qui subjugue bien au-delà des frontières d'Euskadi. Et pourtant elle est empeinte de gravité, la pierre d'Aresti est devenue sable, l'identité est un mirage, je ne suis pas d'ici, décline sur tous les tons Bernardo Atxaga. En 1989, Obabakoak, recueil de contes et nouvelles réunis par un fil ténu qui donne à l'ensemble une structure, sophistiquée et étourdissante, joue avec la mémoire textuelle d'un lecteur qu'on flatte pour mieux le gruger. La famille littéraire d'Atxaga qui comprend Raymond Queneau, Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares a gardé des yeux d'enfant. Traduit dans les principales langues européennes, Bernardo Atxaga est devenu, à son corps défendant, le porte-parole d'une minorité dont il ne cesse de secouer les torpeurs en publiant des ouvrages dont chacun rompt avec le précédent. En 1992, Les mémoires d'une vache relataient la vie d'une vache basque sur fond de guerre civile en 1994, L'homme seul, dont les 20 premiers mille exemplaires ont été épuisés en Espagne une semaine, s'interroge sur l'échec des révolutions dans un style à faire tomber les puristes d'inanition. Ce roman relève les défis lancés par les romans "basques" des Barcelonais Manuel Vasquez Montalban (Galíndez) et Félix de Azua (Hautes trahisons), évocations du nationalisme basque d'un intérêt littéraire inégal (le second forçant tous les stéréotypes esquissés dans le premier qui est un grand roman), et constitue le premier travail d'anamnèse de la société basque sur son passé le plus récent en la scrutant de l'intérieur.
La Ville (Poème de la rouille)
La ville revêt les guenilles de l'automne
La bruine et la tristesse de la rouille
sont ses voiles et ses rubans,
et la lune meurt
en fuyant dans le brouillard rampant comme un merle
à tête vermeil parmi les tourbillons de la neige
Et du vieux pont (où débarquaient,
jadis, les ambassadeurs flamands),
la marchande de journaux regarde le fleuve
tel un dictionnaire aux mots inconnus
Et la lumière des cuisines des prolétaires ouvre des brèches
dans la grande muraille, les mendiants entassent des cartons
où les mouettes auraient aimé faire leur nid
face à la fatalité des rails, les trains perdent
la mémoire et partent comme des apatrides.
Et un peu plus loin, les foyers de la gare,
les poivrots, le cri jaune et perçant des balayeurs,
un autre pont, des prostituées, et c'est fini.
Près du parc, les chauffeurs de taxi parlent du boxeur mort
qui mourut comme meurent le rebec et les chanteurs
de rue.
Le temps est un fragile brocart,
fait de crépuscules toujours sombres.
La poésie n'est plus en terrain basque l'apanage de revues aussi confidentielles que rébarbatives, elle se dit aussi bien désormais dans les improvisations de Benat Achiary, les cris du groupe de rock radical Negu Gorriak, les aphorismes paradoxaux de Jorge Oteiza ou les titres qui font rêver du sculpteur Eduardo Chillida, sur les quais délabrés de Bilbao et dans les brumes du goulet de Pasajes. Démocratique, elle chante pour tous entre le granit, les nuages et le vent.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter