Salman Rushdie
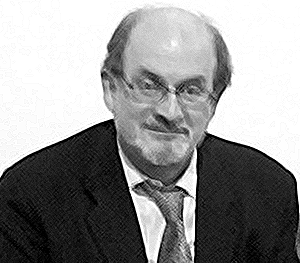
Le grand problème avec Salman Rushdie est qu'il a simplement trop de talent. Et aucun écrivain actuel n'est aussi captif de ses dons: ses facultés d'invention et d'imagination sont si prodigues et si singulières qu'il donne souvent l'impression de ne pas savoir s'arrêter. Voilà un homme qui a dévoré films, stars de foot, chansons pop et télévision en Inde, en Angleterre et dans beaucoup de lieux entre les deux, au point que jeux de mots, références culturelles et images comparatives se multiplient jusqu'à atteindre une sorte de point de rupture. Rushdie apparaît comme un homme orchestre, résumant l'humanité à lui tout seul, avec une centaine d'instrumentalistes virtuoses jouant tous en même temps. Mais, parfois, l'on peut avoir envie de simplicité, de clarté, de tranquillité, d'une pause.
Ainsi le premier grand plaisir de son nouveau et réjouissant recueil de nouvelles est qu'elles ne sont pas "rushdiennes": elles sont légères, franches, un peu coq à l'âne. En effet, les deux premières du livre, se déroulant dans une Inde caricaturalement folklorique, sonnent comme si Rushdie réécrivait Narayan, tout en le faisant tourner sur lui-même. Leurs mises en scène révèlent certes sombres escroqueries, mariages arrangés et stérilisations, mais les ironies transparaissent, les cadences sont vives, et il y a de la tendresse dans les deux. Dans ces pages, Est, Ouest est presque écrit d'un point de vue de vieil homme, éclairé par la perplexité tolérante de la vieillesse. A mesure que le recueil progresse, Rushdie retourne toutefois à un mode plus bagarreur, et dans les contes qui ont un tranchant satirique, il y a un arrière-goût de sombre polémique.
Une des tristes ironies du destin actuel de l'auteur est, bien sûr, qu'il devient à peu près impossible de le lire innocemment. Chaque chose, qu'on le veuille ou non, est prise pour reflet de sa tragique situation. Toujours provocateur, Rushdie n'essaye d'ailleurs pas de décourager de telles lectures, et ses paraboles sur les média et le prix de la renommée envoient des échos bien au-delà de ses phrases ("que vaut la tolérance si les intolérants ne sont pas aussi tolérés ?"). Dans ce qui est sans doute la plus controversée des histoires, Le cheveu du Prophète, un usurier trouve un cheveu de Mohamed et, le conservant par avidité du gain, se transforme en fanatique et voit sa maison devenir un charnier. Encore que la force de cette histoire, et de celles, plus serpentines, qui l'entourent, est qu'elle renonce à la morale facile, et empile ironie sur ironie, jusqu'à ce que les jugements se disolvent tous. Ailleurs, un voleur donne à ses fils une source de subsistance pour la vie en les estropiant. Et eux d'être outragés lorsqu'ils relèvent un jour de leur affliction grâce à un miracle. Dans les contes de fées pour adultes de Rushdie, les horreurs deviennent des bénédictions alors que les bénédictions sont des malédictions déguisées. Et tous ces tours pervers ont une certaine autorité venant d'un homme qui a vu apportées par un même vent la richesse et une sentence de mort, qui a acquis la renommée précisément au moment où il ne pouvait plus en jouir.
La partie des nouvelles se déroulant en Occident est incontestablement plus faible. Un conte sur Yorick autorise l'écrivain à mettre en valeur ses techniques linguistiques dans des phrases qui racontent comment Tristram "n'est ni triste ni bélier (ram), mais le plus écumant, le plus capiteux des panachés (Ghandir)". Il y a quelque chose de très sympathique chez un écrivain de la stature de Rushdie lorsqu'il se montre incapable de résister aux simples jeux de mots. C'est certainement le plus plaisantin et le plus exubérant de nos grands romanciers. Il y a aussi quelque chose de vivifiant dans la vision d'une Inde post-1952 en tant que nouvel âge élisabéthain, surabondant en personnages secondaires, en princes déposés et en énergies urbaines. Le problème toutefois, avec ces brillantes nouvelles contemporaines, est qu'elles abdiquent les mondes que l'auteur avait fait siens en faveur de procédés d'avant-garde à la revue Granta. Lorsqu'il commence à composer des listes d'accessoires branchés ("culottes consommables en papier de riz au parfum menthe poivrée"), il commence à ressembler un peu à Martin Amis; et lorsqu'il descend dans des dystopies de réalité virtuelle ("Elle était à la lointaine extrémité d'une longue, sombre et souterraine salle de bar gardée par des commandos mercenaires de guerre nucléaire. Il y avait des casse-croûtes polynésiens sur le comptoir et des bières du pacifique à la pression : kirin, Tsingtao, Swan"), cela nous rappelle Don DeLillo. Rushdie, plus que tout autre écrivain, est meilleur lorsqu'il ne ressemble à personne à part lui-même ("pourquoi me téléphoner alors qu'il est probablement en train de jouir ?").
Ce que démontre Est, Ouest est que ce plus au fait des écrivains actuels a, même dans son style le plus désinvolte, un génie pour toutes les compétences démodées : langue, récit et imagination et que c'est le produit d'un homme qui se sent suffisament bien chez lui dans n'importe quelle culture pour donner une égalité de chances à l'affection et à l'irrévérence dans toutes. En ce sens, les histoires du recueil soulignent bien ce qui est implicite depuis longtemps : Rushdie est le plus grand écrivain indien post-impérial. Il sait apporter l'ambiance sonore de l'Inde dans un Occident qui a souvent entretenu une conception bêtement pittoresque et domestique du Sub-continent. Bien qu'éduqué en Angleterre il est vraiment la voix d'une nation indépendante et d'une culture polyglotte. Il y a chez lui un monde où des garçons indiens de Kensington chantent les chansons de Neil Sedaka à des petites filles appelées Shéhérazade, où des diplomates asiatiques entretiennent des fantasmes de Star Trek qu'ils ont conçu à Dehra Dun, où des Indiens de Cambridge apprennent l'existence d'un gourou par l'intermédiaire d'Anglais fous. Et quand, en passant, il note que "chez soi, comme l'Enfer, se révèle être les autres", ce n'est pas seulement un bon mot, mais le cri touchant d'un besoin. Rushdie, en fait, est toujours le plus fort quand il écrit avec son coeur. Il peut paraître écrivain plus impressionnat que Gabriel Garcia-Marquez, par exemple, parce que la magie de son style est plus réaliste, et ses symboles plus loin de l'arbitraire, mais aussi par là même paraître moins enchanteur que lui. Ses nouvelles sonnent parfois comme si elles étaient destinées à des éditoriaux, et son imagination est souvent en danger d'être perdue par son intellect. Plus qu'aucun autre, Rushdie est à son meilleur quand il écrit d'ailleurs que son esprit, aussi rapide et multiple que cet esprit puisse être. Critiquant L'énigme de l'arrivée de V. S. Naipaul, il a relevé l'absence totale du mot "amour". Cela peut être aussi parfois le problème de ses propres écrits.
Dans Est, Ouest cependant, nombre de ces problèmes sont résolus. Le recueil capture le monde qui lui appartient le plus en propre. Sous toutes ses images élaborées, ses arabesques ornées et ses culbutes imaginatives, on peut voir un écrivain qui vit et sent, avec acuité, la foire d'empoigne qu'il décrit. Et, plutôt que de dessiner un large canevas qui pourrait paraître aussi bruyant, fatigant et surchargé que les rues d'une cité indienne, il nous conduit ici dans un chemin de campagne débouchant sur quelque chose de vulnérable et de vrai.
-----
Salman Rushdie, Est, Ouest (Éditions Plon).
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter