Saint Augustin
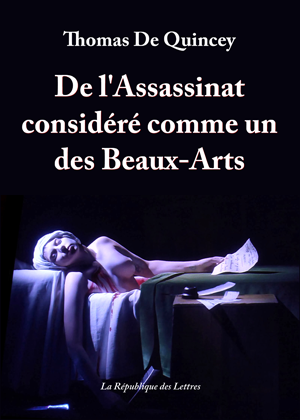
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
Théologien latin et plus illustre des Pères de l'Église latine, Aurelius Augustinus -- Saint Augustin -- est né à Thagaste (aujourd'hui Souk-Ahras, en Algérie), petite ville de Numidie, le 13 novembre 354. Il est mort à Hippone (aujourd'hui Annaba, en Algérie) le 14 août 430.
Il était fils d'un païen, Patricius, et d'une chrétienne, Monique. Il fit ses premières classes dans sa ville natale, puis alla étudier la rhétorique dans la cité de Madaure. Il se passionna pour le latin et la littérature latine, mais il n'aimait pas le grec, dont il semble qu'il n'ait assimilé que les quelques rudiments nécessaires pour comparer une traduction avec le texte original.
Sa mère, quoique fort pieuse, ne le fit pas baptiser, aussi resta-t-il catéchumène. Rentré à Thagaste, il y mena pendant une année (369-370) une vie dissipée, dont il se repentira amèrement, comme en témoignent Les Confessions. Il put poursuivre ses études, comblant ainsi le voeu de son père, grâce à la libéralité du mécène Romanianus, ami et lointain parent de la famille.
C'est ainsi qu'il partit pour Carthage, où il fréquenta l'école d'éloquence, sans oublier les plaisirs du théâtre et les jeux du cirque, dont il était avide. Il connut une jeune fille de très humble condition, qui fut sa compagne pendant douze ans, et à laquelle il fut fidèle "comme à une épouse légitime". De leur union, naquit un fils, Adeodat (A Deo datus, donné par Dieu, Dieudonné), chéri sinon désiré, et à l'éducation duquel ils consacrèrent tous leurs soins.
Entre-temps, Augustin continuait à travailler avec acharnement, à la fois par goût, par ambition, par nécessité, et par reconnaissance à l'égard de son bienfaiteur. À dix-huit ans, la lecture de l'Hortensius de Cicéron l'éveilla à la philosophie. Dès lors, il se mit en quête de la vérité qui l'expliquerair lui-même à lui-même. L'étude de la sagesse païenne l'amena à prendre connaissance de la doctrine chrétienne: il lut les Écritures. Elles le déçurent et il ne les comprit pas. Hésitant, il adhéra en tant que simple "auditeur" au manichéisme, une des innombrables sectes chrétiennes de l'époque. Deux raisons surtout guidèrent son choix: l'impossibilité d'accepter une foi imposée, non fondée sur la raison, et le problème du mal qui le préoccupera toute sa vie.
Ses études terminées, il rentra avec sa femme et son fils à Thagaste où, s'étant consacré à l'enseignement de la rhétorique et à la diffusion du manichéisme, il s'attacha des disciples -- dont Licentius, fils de Romanianus, Euloge, Nebridius, etc. -- qui le suivirent à Carthage. Son père mourut en 379. Entre 380 et 381, il écrivit son premier ouvrage, un traité en deux ou trois volumes, De pulchro et apto (Sur la beauté et la convenance).
Lorsqu'arriva de Rome à Carthage l'évêque Faustus, célèbre docteur manichéen, Augustin l'accueillit comme l'homme qui devait lever tous ses doutes. Il fut déçu: Faustus lui apparut comme un habile orateur, mais ignorant, et incapable de faire la lumière sur le moindre problème. Son ardeur manichéenne s'en trouva refroidie. Peu après, il décida de se rendre à Rome, dans l'espoir d'y conquérir des lauriers et quelque aisance. Sa mère ne voulait pas le laisser partir ou du moins désirait qu'il l'emmenât. Elle le suivit en pleurant jusqu'à la mer.
Rome ne remplit pas son attente. Il tomba gravement malade, et l'enseignement de la rhétorique s'avéra peu lucratif. Un poste de professeur de rhétorique s'étant trouvé libre à Milan, il se présenta et fut agréé grâce à l'intervention de ses amis manichéens aupès de Symmaque, préfet de Rome. Il avait alors trente ans. L'amélioration de sa situation lui permit de faire venir sa femme et son fils. L'année suivante arrivèrent sa mère, puis ses disciples.
Bien qu'il fût désormais assuré de son avenir immédiat, l'inquiétude subsistait en Augustin mais elle était de nature spirituelle. À Rome il avait été attiré pendant un temps par le scepticisme des académiciens, d'Arcésilas plutôt que de Carnéade. Il écoutait maintenant les prédications de saint Ambroise, le grand évêque de Milan. Mais trois choses retenaient encore Augustin loin de la foi et de la discipline de l'École catholique: l'impossibilité de concevoir une substance absolument immatérielle, l'impossibilité d'expliquer l'origine du mal, l'impossibilité de se passer des femmes.
Les deux premiers obstacles furent les plus facilement franchis: il lut les platoniciens (ou plutôt les néoplatoniciens, très probablement Plotin) et il y trouva sur l'essence divine et la nature du mal des notions qui lui ouvrirent des voies nouvelles. Il comprit que Dieu est lumière, substance spirituelle dont tout dépend et qui ne dépend de rien. Quant au problème du mal, la solution lui en apparut dans le fait que, les choses étant subordonnées à Dieu, elles ne possèdent ni l'être ni le non-être absolu: elles sont puisqu'elles tiennent leur existence de Dieu, elles ne sont pas absolument puisqu'elles ne sont pas Dieu. Aussi ne sont-elles corruptibles que dans la mesure où elles participent de la bonté divine; si elles étaient dépourvues de bonté, elles ne pourraient même se corrompre. La corruption n'est donc que la perte d'un bien; tout ce qui est est bon; le mal n'est pas substance mais absence de bien, non-être.
Dès lors Augustin était dans l'état d'un homme convaincu de la vérité, mais cela ne put l'empêcher de vivre encore dans le pêché. Sur les instannces de sa mère qui voulait le marier à une jeune fille de bonne famille, il avait renvoyé sa compagne, mais ce fut pour reprendre une autre concubine. C'est alors qu'eut lieu la crise décisive: un jour qu'il était allé chercher la solitude et le calme sous un bosquet de son jardin, il crut entendre une voix qui lui disait: "Tolle, lege" (Prends, lis). Pleurant, il y vit un ordre divin. Il courut vers son ami Alypius près de qui il avait laissé les Épîtres de saint Paul. Il les ouvrit au hasard et tomba sur ce passage: "Ne passez pas votre vie dans les festins et les soûleries ni dans la débauche et les coucheries, ni dans la compétition et la rivalité, mais revêtez-vous de Notre-Seigneur-Jésus-Christ et gardez-vous de satisfaire les désirs déréglés de la chair."
Touché par la grâce, Augustin décida de se retirer dans la maison de son ami Verecundus en Lombardie avec ses amis et disciples, sa mère et son fils. Là, ils passaient leur temps en prières, études et discussions. C'est là que virent le jour ses fameux dialogues philosophiques: Contre les philosophes de l'Académie, De la vie heureuse, De l'ordre, Les Soliloques, les trois premiers en 386 et le dernier au début de 387. Après les vacances, il donna sa démission de professeur de rhétorique et, dans la nuit du 24 au 25 avril 387, il reçut de saint Ambroise le baptême.
Entièrement consacré désormais au service de Dieu, il écrivit à Milan De immortalitate animae. L'été suivant, il partit pour Rome. Il connut à Ostie une extase partagée avec sa mère, regagna Rome après la mort de celle-ci quinze jours plus tard. Il resta encore à Rome jusqu'à l'été 388. À l'automne il revint pour toujours en Afrique. Au cours de ce séjour, il soutint le pape Sirice dans sa lutte contre les manichéens, en écrivant De moribus Ecclesiae catholicae, qui marquent le début de son oeuvre apologétique. C'est à Rome encore qu'il écrivit de la grandeur de l'âme, oeuvre mystique où éclatent ses dons de psychologue, et le premier livre, Du libre arbitre, où il aborde le problème du mal.
Après un très court séjour à Carthage, l'automne 388 le trouve de nouveau à Thagaste. Il y vendit le peu de biens qu'il possédait et en distribua le produit aux pauvres. Et, comme il le raconte lui-même, il exigea de ceux qui désiraient le suivre qu'ils en fissent autant. Au cours de ces deux années environ de retraite à Thagaste, Augustin termina Contre les manichéens et écrivit Le Maître, De la musique, et en 390 De la vraie religion. À la veille de son ordination à Hippone, en 391, il reprit et développa les arguments du Contre les philosophes de l'Académie.
À Carthage, puis à Thagaste, il vécut dans un petit groupe, les "Serviteurs de Dieu" (Servi Dei), pour qui il rédigea la Regula ad servos Dei. Nommé coadjuteur de Valerius, le vieux et pieux évêque d'Hippone, il se vit confier la mission de prêcher qu'il remplit avec ardeur et succès presque jusqu'à sa mort. Les hérétiques, donatistes à la tête desquels se trouvait l'énergique Proculeianus, et manichéens, dont un certain Fortunatus, étaient nombreux dans la ville. Ayant eu le dessous dans une controverse publique (28-29 août 392) avec les catholiques, Fortunatus quitta Hippone. Le récit de la controverse fait l'objet du Contra Fortunatum manichaeum liber unus.
Ce n'est là qu'un des épisodes du combat acharné qu'Augustin mena sur tous les fronts contre les hérésies et les schismes qui menaçaient l'orthodoxie catholique. Les manichéens qui niaient l'unité et la mission de l'Église; les pélagiens qui niaient la nécessité de la grâce et le péché originel; les païens qui blasphémaient encore contre le Christ. Il écrivit De l'utilité de croire, suivi des deux volumes De duabus animabus (392-393), De genesi ad litteram liber imperfectus (393), Contra Adimantum (394) et l'admirable De sermone Domini in monte (394).
Au concile des évêques catholiques d'Afrique, à Hippone, convoqué par Aurelius, évêque de Carthage, il prononça contre les donatistes le sermon De fide et symbolo, et tout de suite après écrivit Contra epistolam Donati haeritici, qui a été perdu. Vers la fin de l'année 395 ou le début de 396, après la mort de Valerius, il fut acclamé évêque d'Hippone. Il s'acquitta de tous les devoirs de sa charge avec un zèle exemplaire: il fut à la fois pasteur, administrateur, orateur sacré et juge. Les quelque trois cents sermons qui sont parvenus jusqu'à nous ne représentent qu'une faible partie de ceux qu'il a prononcés. Certains d'entre eux sont parmi les plus belles exégèses que possède l'Église, comme les Enarrationes in psalmos et les deux traités de 416, In Johannis evangelium et In epistolam Johannis. La masse de Lettres adressées à des adversaires, à des amis, à des étrangers, à des religieux, à des laïcs, n'est pas moins imposante. En 396, il compléta le recueil De diversis quaestionibus, et dès son accession à l'épiscopat il écrivit de agone christiano. Il poursuivit la polémique antimanichéenne avec le Contra espistulam fundamenti (inachevé) où il réfutait un traité de Manès, et rédigea une partie de la Doctrine chrétienne; en 401, les treize livres de ses Confessions.
Quelques années auparavant, avaient paru les trente-trois livres du Contra Faustum manichaeum (inspiré par un écrit de Faustus contre l'Ancien Testament) et le De fide rerum quae non videntur. En 404, après la controverse avec le manichéen Félix qui s'était terminée par l'abjuration de ce dernier (De actibus cum Felice manichaeo), il dirigea ses derniers traits contre cette secte dans deux ouvrages: De natura boni et Contra secundinum manichaeum. Vers 400, il avait entrepris la rédaction de son grand traité philosophique et théologique Sur la Trinité, auquel il travailla quinze années durant.
Une fois le danger manichéen écarté, Augustin se jeta plus ardemment dans la lutte contre le péril plus menaçant encore que constituaient pour l'unité de l'Église les donatistes. Il participa aux conciles antidonatistes de Carthage en 403 et 411, où il soutint presque à lui seul le poids de la discussion. À cette lutte, qui s'achèvera par la défaite des hérétiques, il consacra un grand nombre d'écrits, dont les plus importants parmi ceux qui nous restent sont: De baptismo contra donatistas (401); Contra litteras Petiliani donatistae (401-405); Contra donatistas epistola (405) et Liber contra donatistas post collationem (413).
Entre-temps, le 2 août 410, les Goths d'Alaric étaient entrés à Rome, où pendant trois jours ils s'adonnèrent au pillage. Les réfugiés affluèrent en masse en Afrique, semant la panique et colportant des bruits qui rendaient le christianisme responsable des malheurs de Rome. C'est contre ces accusations que s'insurge Augustin dans La Cité de Dieu. Mais cette oeuvre, qui reste la plus vaste conception de l'histoire humaine vue par un chrétien, déborde largement les limites de l'évènement qui l'a fait naître. Parmi les réfugiés se trouvait Pélage, un moine de Grande-Bretagne qui répandait sa doctrine favorable à la liberté humaine et réduisant le rôle de la grâce divine. Il devait passer peu après en Orient, mais il laissa à Carthage son compagnon et disciple Celestius qu'Augustin, déjà vieux, combatit avec acharnement par la prédication, dans des conciles (Cathage et Milevis en 416, Carthage en 418) et par la plume.
De ces circonstances naquirent les grands ouvrages antipélagiens: De natura et gratia contra Pelagium (413-415); Liber de perfectione justitiae hominis contra Celesti definitiones seu ratiocinationes (415-416); De gestis Pelagii (417); Contra Julianum haeresis pelagianae defensorem (423); Opus imperfectum contra Julianum (429-430), que la mort empêcha Augustin d'achever. Il écrivit aussi dans un esprit plus théorique et moins polémique le De gratia et de libero arbitrio et le de corruptione et gratia (426). Contre les semi-pélagiens de la Gaule, il lança le De praedestinatione sanctorum et le De dono perseverantiae (429).
Les ariens n'échappèrent pas non plus à ses critiques. En 419, il écrivit Contra sermonem quemdam arianorum liber, et, dix ans plus tard, il soutint avec l'évêque arien Maximin une controverse publique dans le Contra Maximinum arianorum episcopum. En 429, il composa encore les deux livres De haeresibus et entreprit une vaste révision de tous ses écrits, révision dont les Rétractations nous apportent le témoignage malheureusement incomplet.
Les invasions barbares n'épargnèrent pas l'Afrique romaine chrétienne. En 429, les Vandales de Genséric franchirent le détroit de Gibraltar. Bientôt les églises de Carthage, de Cirta et d'Hippone restèrent seules debout au milieu des ruines. Au cours du troisième mois du siège de sa ville épiscopale, Augustin tomba malade et mourut le 14 août 430.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter