Tristan Tzara
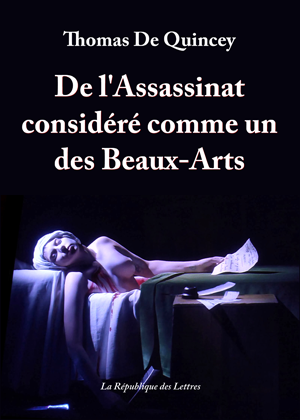
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques

Tristan Tzara, pseudonyme de Samuel Rosenstock, est né le 16 avril 1896 à Moinesti (Roumanie).
Au sortir du lycée, il y fonde une première revue avec Ion Vinea et Marcel Janco, Le Symbole. Renonçant en 1915 à ses études de mathématiques et de philosophie, il quitte son pays pour Zurich, où il retrouve pacifistes et révolutionnaires de toute l'Europe.
Aux côtés de Hugo Ball, Tristan Tzara crée en 1916 le Cabaret Voltaire, auquel succède bientôt la revue Dada. L'invention du mot Dada, choisi parce qu'il "ne signifie rien", cristallise le nihilisme ambiant et attire entre autres Hans Arp, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, et en 1918 Francis Picabia, dont la revue 391 permet à Tzara de mesurer l'importance potentielle de ce qui n'aurait pu être qu'un canular, ou l'expression du désarroi produit par la guerre: Dada correspond bien à un état d'esprit international et cette constatation lui permet de surmonter momentanément les tensions entre dadaïstes "purs" et artistes révolutionnaires, allemands pour la plupart, soucieux d'efficacité idéologique.
Lorsque ceux-ci l'emportent, Tristan Tzara rejoint Picabia à Paris et y rencontre des jeunes gens impatients de le connaître: Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault, Paul Eluard, Georges Ribemont-Dessaignes, Pierre de Massot et quelques autres se lancent avec lui dans les provocations dadaïstes. Tzara montre son talent d'animateur en organisant des scandales qui contribuent à la désorganisation radicale que les manifestes annoncent et mettent en oeuvre dans une langue poétique survoltée.
Les revues Dada, 391 et Littérature publient ces manifestes (recueillis en volume en 1924), et des poèmes où s'annulent les distinctions entre genres littéraires. La Première Aventure céleste de M. Antipyrine (1916) est suivie d'une Deuxièmes Aventure céleste de M. Antipyrine, jouée en 1920 lors d'une représentation Dada. Le poème-sketch apparaît comme une forme clé de l'expression dadaïste: la poésie s'y fait manifeste et s'exhibe dans la cacophonie et la dérision.
Dans les recueils de cette époque, Vingt-cinq poèmes, puis Vingt-cinq et un poèmes (1918), Cinéma, Calendrier du coeur abstrait (1920), De nos oiseaux (1923), Le Coeur à gaz (représenté en 1923), les mots s'émancipent, denses et résistants, faisant éclater la phrase. Tristan Tzara reste fidèle au tressage de styles et de registres dans Mouchoirs de nuages (pièce écrite en 1924, jouée en 1926).
Cependant, son nihilisme radical l'isole peu à peu du groupe qui se forme autour d'André Breton et les conflits s'exacerbent à partir du Congrès de Paris en 1922: la volonté d'élaboration théorique de Breton, attiré par l'exploration des mondes occultes, se heurte au génie du sabotage de Tzara, qui ne s'accomode d'aucune morale de groupe ni d'aucune référence à la tradition littéraire. Il ne se réconciliera avec Breton qu'entre 1930 et 1935, le Surréalisme se rapprochant du Communisme vers lequel Tzara a lui-même évolué.
C'est ainsi qu'il participe à la seconde revue surréaliste, Le Surréalisme au service de la révolution, notamment en 1931 avec un Essai sur la situation de la poésie dans lequel il oppose la poésie comme simple "moyen d'expression", création maîtrisée, à la poésie comme "activité de l'esprit" sollicitant les ressources de l'inconscient. Celle-ci requiert une révolution politique et sociale qui oriente toute son oeuvre ultérieure. Depuis Dada, en effet, la poésie de Tristan Tzara est passée d'une langue explosive à des textes plus lyriques (L'indicateur des chemins de coeur, 1928; Où boivent les loups, 1932), amples jusqu'à l'épopée (L'Homme approximatif, 1931).
Dans Grains et issues (1935), il mêle prose et vers, récits de rêves et notes critiques, poème et théorie, pour créer un substitut de l'écriture automatique: la passivité de l'écoute dans l'automatisme est en effet mise en cause par la méthode paranoïaque-critique de Salvador Dali. Grains et issues tente de mettre à jour d'autres relations possibles entre le "donné" (délirant ou automatique) et le travail de l'interprétation.
L'engagement politqiue de plus en plus marqué qui rallie Tristan Tzara à l'Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, en 1935, induit une écriture poétique qui, sans renoncer aux pouvoirs de l'image, médite sur la requalification de l'homme et la transformation des conditions sociales, indispensable à la levée des censures individuelles. Les textes de Tzara récusent l'idée de poésie de circonstance, mais se doublent d'un engagement personnel constant contre le fascisme et contre l'art bourgeois conçu comme une fin en soi. Il constate que si la révolution sociale est nécessaire à la poésie dont il veut voir le règne, en revanche "la révolution n'a pas besoin de la poésie": il s'éloigne donc par là des surréalistes et rompt avec eux dans une lettre ouverte de mars 1935, publiée dans Les Cahiers du Sud.
Fidèle à ses conceptions, il organise clandestinement pendant la guerre le Comité national des écrivains dans le Sud-Ouest, et reproche aux surréalistes en mars 1947 d'avoir trahi leurs ambitions révolutionnaires, dans une conférence houleuse à la Sorbonne, reprise en brochure (Le Surréalisme et l'après-guerre). Pourtant, sa position avant tout humaniste ne s'accomode d'aucun compromis avec l'orthodoxie du parti et le conduit à dénoncer l'invasion de la Hongrie en 1956, à refuser l'art réaliste-socialiste, même au plus fort de son engagement marxiste, à défendre envers et contre tous une certaine conception de la poésie, moyen de connaissance, parole de déblaiement fidèle aux seules exigences de la liberté.
En marge d'une oeuvre poétique importante, Tristan Tzara est l'auteur d'essais, dans lesquels il interroge les pouvoirs et les secrets de la poésie, sur Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, François Villon et François Rabelais dont il explore les anagrammes. "Les écluses de la poésie" ou "Le pouvoir des images" manifestent la cohérence profonde de son parcours, depuis l'époque où le dadaïste voulait faire table rase d'illusions lucratives qui transforment l'art en marchandise jusqu'à sa postulation d'une révolution socio-politique comme condition préalable à l'affranchissement de la poésie.
Tristan Tzara est mort à Paris le 24 décembre 1963, à l'âge de 67 ans.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter