Alexandre Dumas
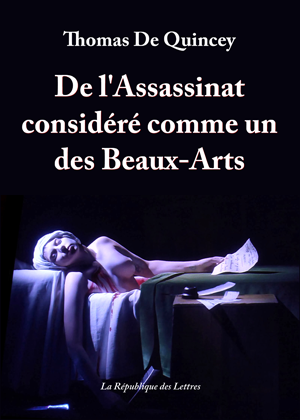
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
Alexandre Dumas m'oblige à un certain nombre d'aveux: je l'aime, je l'admire, je l'envie.
Comme sans doute tous ceux qui le lisent, je l'ai découvert dans Les Trois Mousquetaires, à un âge privilégié: j'avais alors dix ans, âge où tout est terriblement sérieux et, notamment, les bons sentiments. Quand j'ouvre aujourd'hui un roman de Dumas, ce n'est pas que je veuille retrouver un enthousiasme qui appartient au passé: mais les mouvements qui m'agitaient alors, même à travers la forme que ma vie et la vie leur ont donnés, je les retrouve. Il me semble que, par Alexandre Dumas, certaines valeurs humaines ont été pour moi nommées, éclairées, exaltées. Et l'ensemble de ces valeurs m'apparaît toujours comme essentiel. Il appartiendrait à un moraliste de les définir. Quant à moi, elles sont chaleur et force et joie, qu'il s'agisse de l'amitié, d'un certain sens du courage, du goût de l'aventure (et qu'elle soit empanachée ne gâte rien), de la vertu de la parole donnée, de la générosité enfin, de celle du coeur qui ouvre la porte à toutes les autres.
Ma seconde rencontre avec Dumas eu lieu quelques années plus tard: je venais de faire, en 1915, une entrée modeste au Journal des Débats. La curiosité et l'orgueil me poussaient à connaître les noms de mes prédécesseurs illustres: ce fut à cette occasion que je trouvai Le Comte de Monte-Cristo, publié en feuilleton quelques décades auparavant. Mais comme cela me semblait proche ! Et depuis lors, combien de fois ne m'est-il pas arrivé de me laisser reprendre par ce roman ou par d'autres du même enchanteur. Et toujours malgré moi. Je feuilletais un volume... "Seulement une page ou deux", me disais-je... Et allais jusqu'au bout. Aujourd'hui encore le jeu m'entraîne, tellement il est bien mené. Et savoir par avance tout de l'histoire m'importe peu; le mouvement demeure irrésistible.
Si l'oeuvre de Dumas reste toujours aussi présente (on trouve toujours de ses livres dans quelque librairie que ce soit, et pas seulement en France), sa technique et sa virtuosité y sont assurément pour beaucoup, mais son pouvoir essentiel vient de ce qu'il éprouvait avec force les sentiments qu'il a décrits, et cette force, ce bonheur de vivre l'ont gardé du temps.
A son terme, la vie d'un homme paraît avoir été faite de mille rencontres, de mille hasards, heureux ou malheureux. Mais, en vérité, le hasard ne joue pas de la même façon pour tous les êtres. De la rencontre d'un tempérament et d'une époque, par une alchimie dont tant d'éléments nous échappent, sort parfois le miracle. Il y a un miracle Dumas.
Pour tout bagage, alors que le temps est venu pour lui de gagner sa vie, Alexandre Dumas n'a que sa belle écriture. Il débute donc à Paris, dans ce Paris qu'il a décidé de conquérir, tel un personnage de Balzac -- mais les héros de Balzac étaient alors bien en vie, comme employé aux écritures. On imagine mal ce géant débordant de santé, de vie, d'ambition, de toutes ses passions et de toutes celles de son temps -- la bataille romantique allait s'engager, courbé, appliqué à ces tâches mornes. Le carcan, au lieu de l'étouffer, va le galvaniser. Et puis, il ne doute de rien: il sait par avance que tout lui est dû. Le moyen de parvenir, il l'a déjà choisi: le Théâtre. C'est au bout de sa plume qu'il va emporter Paris.
1829: Dumas est âgé de vingt-sept ans. La Comédie Française joue son drame: Henri III et sa cour. En une soirée, c'est la gloire: Hugo et Vigny enthousiastes. Une salle debout pour acclamer le nom de l'auteur. La machine Dumas est en marche, rien ne l'arrêtera plus que la mort.
[ Une représentation de Shakespeare avait fait découvrir à Dumas le théâtre. De la Renaissance au Romantisme, le saut allait être accompli par toute une génération. Et Dumas y figurera comme un grand novateur, autant et plus que ceux qui, depuis, ont franchi la porte étroite des manuels scolaires. Son génie, toujours, fut d'être légèrement en avance sur les goûts de son époque, de les précéder idéalement à cet endroit précis où, encore inexprimée, ils peuvent cependant se reconnaître. Les audaces de son théâtre peuvent nous paraître naïves: elles étaient exaltantes pour un public qui souffrait de milles contraintes. Le Drame, alors, tuait la Tragédie.] Dans un temps où la France ne faisait plus l'Histoire, l'Histoire de la France était un merveilleux moyen de répondre à la sensibilité nationale. [ Elle permettait, aussi, par Rois et Ministres interposés, de fronder librement.]
Walter Scott avait superbement démontré que le roman historique pouvait être un genre noble. Les jeunes écrivains français de l'époque, Victor Hugo, Balzac, Vigny, allaient suivre ses traces. Avec la même fougue et la même ambition qu'eux, Alexandre Dumas se lance à corps perdu dans cette aventure. Et c'est lui qui va la mener à son terme.
La matière était à la mesure de ses forces: l'épopée qu'il ne peut pas vivre, il va la traverser à bride abattue, assis à sa table, aussi enflammé à l'écrire que nous à la découvrir avec ses yeux.
Chance, hasard, la vogue du roman historique coïncide avec une bouleversement dans la presse: la naissance du roman feuilleton. La formule: "A suivre" nous semble tellement évidente qu'on a du mal à imaginer qu'il ait fallu attendre 1829 pour la voir apparaître pour la première fois. Deux journaux, La Presse et Le Siècle, allaient faire une règle d'or de cette découverte destinée à attacher le lecteur. Dumas devait être l'homme de la situation. Un premier essai vaut cinq mille abonnés au Siècle. Le succès du Chevalier d'Hermental, deux ans plus tard, fait comprendre à Dumas que sa fortune est là. Il va récidiver. Ce sont Les Trois Mousquetaires. Dès lors, l'oeuvre de Dumas -- ce qu'il fait lui-même, ce qu'il fait faire, ce qu'il prend et refait, va devenir une gigantesque entreprise. Ce n'est plus Dumas homme de théâtre ou écrivain, c'est Dumas romancier de la France.
L'homme de théâtre a aidé le feuilletoniste: d'un acte à l'autre, il faut faire rebondir l'intérêt. Le souci de bien finir ses actes, Dumas l'applique au découpage de ses livres. S'il n'a pas inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le "suspense", il l'a merveilleusement illustré. Au théâtre, Dumas emprunte aussi son sens et sa facilité du dialogue. Et, pour le feuilleton, le dialogue a un avantage essentiel: un mot peut y compter pour une ligne. Or, c'est à la ligne que l'on est payé.
Dans cet art particulier, j'ai eu la chance admirable qu'Alexandre Dumas en personne -- ou presque, me serve de professeur. C'était en 1919. Démobilisé, je travaillais de nouveau au Journal des Débats. Appartenir à cette maison auguste était, assurément, à vingt et un ans, un grand honneur. Mais l'honneur, à lui seul, nourrit mal. Et les salaires, aux Débats, ne suffisaient pas à de jeunes dents que la guerre et l'aviation avaient aiguisées. Pour m'enrichir un peu, je soumis à un autre journal du soir le plan d'un roman feuilleton fleuve. Il avait pour titre: La Fille au masque Pourpre, et cette fille était pirate dans les mers de Chine. Le projet fut accepté.
Je fis part de la grande nouvelle à mes confrères des Débats. Ils comptaient pour le moins trois fois autant d'années que les miennes. En raison de cela, sans doute, ils me témoignaient une charmante et bienveillante amitié. L'un d'eux, qui employait encore la plume d'oie, me dit alors: "Je veux vous conter une histoire qui vous sera d'un conseil précieux. Je l'ai entendue ici même quand j'avais votre âge, d'un homme qui avait celui que je porte aujourd'hui. Un jour qu'il se trouvait auprès du rédacteur en chef, Alexandre Dumas surgit dans le bureau. Il apportait le texte de son feuilleton du lendemain. Le rédacteur en chef jeta un regard sur les pages et poussa un cri de souffrance:
- Non, non, vraiment, mon cher, c'est excessif. Pas une ligne pleine... Dialogue seulement. Et quel dialogue ! Par interjections !
Dumas leva la main avec superbe:
- Cessez de geindre, dit-il. Sinon je les fais bègues."
Ce récit n'explique pas à lui seul la tendresse que je nourris pour Dumas. Il y tient cependant une place majeure. Dès l'instant où il m'a été fait, Dumas, sans cesser d'être à mes yeux un écrivain égal aux plus grands, est devenu en outre un compagnon de métier, un camarade artisan, un copain merveilleux. Et le sera toujours.
Ce qu'a gagné Dumas, et c'était des fortunes, ne lui a jamais suffi. Il vivait comme il travaillait et dépensait comme il vivait, sans compter. A une époque de son existence, jusqu'à cent cinquante créanciers étaient à ses trousses. Il dut s'exiler à Bruxelles. L'ampleur de ses besoins n'avait pas de limite, ni celle de sa générosité. Il est mort ruiné, à soixante-huit ans.
De cette vie étonnante, qui fut la sienne, il est difficile de limiter son choix à quelques faits. Les Mémoires de Dumas regorgent de rencontres, de mots, de situations que l'on voudrait pouvoir transcrire tels quels, tant l'homme y apparaît extraordinaire dans sa variété, ses appétits, sa résistance à la fatigue, sa capacité de labeur. Il est cependant une anecdote qui me touche plus que les autres par le mouvement d'envie dans l'admiration qu'elle me fait éprouver.
Pour aller de Naples à Paris il fallait à l'époque de Dumas, en train, huit jours de voyage, et l'on imagine dans quelles conditions épuisantes pareille randonnée devait s'accomplir. Alexandre Dumas est alors âgé de soixante ans. Il vient de vivre l'épopée garibaldienne, mais, après la gloire, les honneurs, il a été presque obligé de s'enfuir. Donc, par un soir d'hiver, son fils l'accueille à la gare. Les deux hommes s'étreignent. Pour ce premier soir à Paris, Dumas veut une fête: il a besoin de parler, de raconter.
"Allons chez Théophile Gautier, dit-il."
Le poète dort. Il est près de minuit. Les lumières sont éteintes, peu importe ! Les appels, les clameurs de Dumas, planté sur le trottoir, font apparaître une tête.
"Nous sommes tous couchés, plaide Gautier.
- Paresseux ! Est-ce que je me couche, moi ? crie Dumas."
Force est au poète d'ouvrir sa porte. Alexandre Dumas ne se décide à partir que vers quatre heures. Tout le long du chemin que lui et son fils font à pied pour gagner les Champs-Elysées, Dumas n'arrête pas de discourir. Quand il arrive chez lui, il est six heures du matin. Mais le jour n'est pas encore levé. Dumas demande une lampe.
"Tu peux me laisser, dit-il à son fils qui, lui, tombe de sommeil. Je vais me mettre au travail."
Et il abat une besogne énorme.
Mais voilà que je voudrais encore parler de Dumas parcoureur de pays, de ses impressions de route où il est à la fois journaliste et écrivain, encore plus lui-même par la remarquable faculté qu'il a de se mettre en scène, d'être l'homme à qui il arrive toujours, comme part de le vie, la plus étonnante.
Pour un de ces voyages, toutefois, il dut attendre presque vingt ans. La Russie le fascinait: il pensait y trouver des hommes à sa mesure, grands chasseurs, grands buveurs, grands seigneurs. En outre, après l'histoire de la France, celle de la Russie attisait son imagination et son goût des situations fortes. Mais le refus, par le tsar Nicolas Ier, de lui accorder l'ordre de Saint-Stanislas, le poussa à écrire un roman, Mémoires d'un maître d'armes, qui retraçait fidèlement l'histoire vraie de deux décembristes. Le livre fut interdit en Russie et, jusqu'à la mort du tsar, on déconseilla à Dumas d'entreprendre le voyage. Enfin, Alexandre II succède à Nicolas Ier et Dumas peut partir.
-----
Joseph Kessel (1898-1979), publié dans l'ouvrage collectif Gloires de la France, par les quarante membres de l'Académie française (Librairie Académique Perrin, Paris, 1964).
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter