Droits de l'Homme
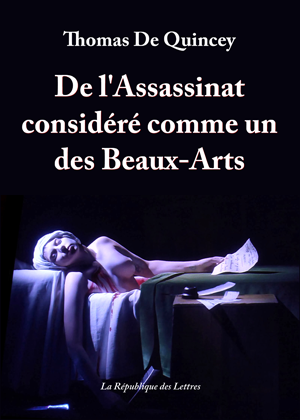
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
Il y a soixante ans, le 10 décembre 1948, l'Organisation des Nations Unies adoptait la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, une liste de trente articles énumérant des droits humains, civils, économiques, sociaux et culturels "inaliénables" et "indivisibles" dont le premier affirme que "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits". De nombreux pays à travers le monde célèbrent en grande pompe ce soixantième anniversaire pour rappeler la nécessité de respecter les droits "universels" inscrits dans la Déclaration mais plusieurs d'entre eux, à commencer par la France de Nicolas Sarkozy et les Etats-Unis de George W. Bush, ont particulièrement régressé ces dernières années et se classent désormais parmi les plus mauvais élèves en la matière. Au vu de la façon dont les dirigeants occidentaux exploitent la charte à des fins idéologiques et partisanes, notamment pour servir leurs seuls intérêts économiques et géostratégiques, de nombreux pays contestent également l'idéologie sous-jacente de cette Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à géométrie variable, remettant en cause son "universalisme". L'économiste indien Amartya Sen, Prix Nobel d'économie 1998, analyse ici cette vision occidentale des Droits de l'Homme.
Le concept d'universalité des Droits de l'Homme est une idée nouvelle.
On se demande souvent s'il est vrai que les sociétés non-occidentales devraient être encouragées, voire poussées à se conformer aux "valeurs occidentales de libération et de liberté". N'est ce pas là de l'impérialisme culturel ? La réponse, bien sûr, est que la notion de Droits de l'Homme repose sur l'idée d'une humanité commune. Ces droits ne dérivent pas de la citoyenneté propre à un pays quelconque, ou de l'appartenance à une nation, mais sont octroyés à chaque être humain. En ce sens, le concept d'universalité des Droits de l'Homme est une idée unificatrice. Toutefois, le sujet des Droits de l'Homme a fini par être un véritable lieu d'affrontement dans les débats politiques et les disputes éthiques, particulièrement en ce qui concerne leur application dans les pays non-occidentaux. Pourquoi en est-il ainsi ? L'explication est parfois recherchée dans les différences culturelles qui diviseraient le monde, une théorie qui se réfère aux théories du "choc des civilisations" ou de "l'affrontement entre les cultures". On prétend souvent que les pays occidentaux reconnaissent de nombreux droits humains, relatifs par exemple à la liberté politique, qui n'ont pas de résonance dans les pays asiatiques. De nombreuses personnes y voient un fossé de division important. La tentation de penser en ces termes culturalistes ou régionalistes est extrêmement forte à notre époque. Y a t il réellement des différences aussi strictes au sujet des Droits de l'Homme entre les traditions et les cultures du monde ? Il est sans doute vrai que les porte-parole gouvernementaux de nombreux pays asiatiques n'ont pas seulement contesté la pertinence et la force obligatoire de droits universels de l'homme, ils ont fréquemment émis cette opposition au nom de "valeurs asiatiques", en les opposant aux valeurs occidentales. La revendication porte sur le fait que dans le système de valeurs dites asiatiques, par exemple dans le modèle confucéen, on insiste davantage sur l'ordre et la discipline, et moins sur les droits et les libertés.
Les Droits de l'Homme, "Valeur occidentale" ?.
De nombreux représentants politiques ont argumenté que faire appel à une acceptation universelle des Droits de l'Homme illustre l'imposition de valeurs occidentales à d'autres cultures. Par exemple, la censure de la presse est plus acceptable, selon eux, dans la société asiatique à cause de cette prégnance de l'ordre et de la discipline. Cette position a été puissamment développée par de nombreux porte-parole asiatiques à la Conférence de Vienne sur les Droits de l'Homme de 1993. Certains développements positifs ont découlé de cette conférence, parmi lesquels l'accord général sur l'importance d'une élimination de la détresse économique et de la reconnaissance d'une responsabilité de la société dans ce domaine. Mais en ce qui concerne les droits politiques et civiques, une ligne de fracture a divisé en deux la conférence, et cela sur des bases régionales principalement, plusieurs gouvernements asiatiques rejetant la reconnaissance des droits civils et politiques fondamentaux. Si une des influences plaidant pour la réfutation des Droits de l'Homme en tant que spécifiquement occidentaux vient des porte-parole gouvernementaux asiatiques, une autre s'articule autour de la façon dont le problème est perçu en Occident même. Il y a une tendance en Europe et aux États-unis à admettre, au moins de manière implicite, que c'est en Occident -- et seulement en Occident -- que les Droits de l'Homme ont acquis leur valeur, et cela dès l'Antiquité. Cette caractéristique prétendument propre à la civilisation occidentale relèverait d'un concept étranger aux autres civilisations. Parce qu'elles insistent sur des spécificités régionales et culturelles, ces théories occidentales sur l'origine des Droits de l'Homme tendent à renforcer, plutôt involontairement, la mise en question de l'universalité des Droits de l'Homme dans les sociétés non-occidentales. En argumentant que les valeurs de tolérance, de liberté individuelle et de droits civiques sont une contribution unique de leur civilisation, les défenseurs occidentaux de ces droits fournissent souvent des munitions aux critiques non-occidentales des Droits de l'Homme. Ainsi, la défense d'une idée qui serait étrangère aux sociétés non-occidentales peut ressembler à un impérialisme culturel sponsorisé par l'Ouest. Quelle est la part de vérité de cette grande dichotomie culturelle entre civilisations occidentale et non-occidentale au sujet des libertés et des droits ? Je crois, quant à moi, que cette si grande opposition a en fait très peu de sens. Ni les revendications des porte-parole asiatiques en faveur de "valeurs asiatiques spécifiques", ni celles des représentants européens et américains pour le caractère unique des "valeurs occidentales" ne survivent bien longtemps à l'examen historique et critique. En considérant la civilisation occidentale comme le lieu naturel de la liberté individuelle et de la démocratie politique, il y a déjà une tendance à déduire le passé à partir du présent. Les valeurs que les philosophes européens des Lumières ainsi que d'autres théories plus récentes depuis le 18e siècle ont rendu communes et largement répandues, sont souvent considérées, de façon totalement arbitraire, comme partie de l'héritage ancestral, expérimenté en Occident depuis des millénaires. En réalité, le concept de l'universalité des Droits de l'Homme est une idée relativement neuve que l'on ne retrouve pas plus dans l'Antiquité occidentale que dans les autres civilisations anciennes.
La tradition intellectuelle asiatique est d'une grande variété.
Toutefois, d'autres idées, telle que la valeur de la tolérance et l'importance de la liberté individuelle y ont été pensées et défendues depuis longtemps, et à de nombreuses reprises pour certaines. Par exemple, les écrits d'Aristote sur la liberté et la prospérité de l'espèce humaine représentent un important fondement pour les théories contemporaines des Droits de l'Homme. Néanmoins pour d'autres philosophes occidentaux (Platon et Saint Augustin par exemple) la prédominance de l'ordre et de la discipline sur la liberté n'était pas moins une priorité que pour Confucius lui-même. De plus, il est intéressant de constater que même ceux qui, en Occident, insistaient sur la liberté, ne la considéraient pas nécessairement comme une revendication propre à tous les êtres humains. La mise à l'écart des femmes et des esclaves chez Aristote est une bonne illustration de cette non universalité. Existe-t-il des déclarations similaires en faveur de la liberté individuelle au sein des traditions non-occidentales et particulièrement en Asie ? La réponse est catégoriquement positive. Confucius n'est pas le seul philosophe en Asie, ni même en Chine. Il y a beaucoup de variété dans les traditions intellectuelles asiatiques. Ainsi, de nombreux écrivains ont souligné l'importance de la liberté et de la tolérance, quelques uns les considérant comme ce qui revient de droit à chaque être humain. Par exemple, la thématique de la liberté est très importante dans le bouddhisme qui est né et s'est d'abord développé en Asie du Sud puis s'est diffusé vers l'Asie du Sud Est et de l'Est, y compris en Chine, au Japon, en Corée et en Thaïlande. Dans ce contexte, il est important de reconnaître que la philosophie bouddhiste n'insiste pas seulement sur la liberté comme mode de vie, mais qu'elle lui donne aussi un contenu politique. Pour donner un seul exemple, l'empereur indien Açoka, au 3e siècle avant Jésus-Christ, réalisa de nombreuses inscriptions politiques en faveur de la tolérance et de la liberté individuelle, à la fois comme élément de la politique étatique mais également dans les relations entre personnes présentant des différences. La tolérance, selon les arguments d'Açoka, devait inclure tout le monde sans exception.
Confucius and co.
Même le portrait habituel de Confucius, le décrivant comme un homme intransigeant et autoritaire, est loin d'être convainquant. Confucius croyait en effet en l'ordre mais il ne recommandait pas une allégeance aveugle à l'État. Quand Zilu lui demande comment servir un Prince, Confucius répond: "Dis-lui la vérité, même si cela doit l'offenser", une recommandation qui pourrait être difficile à appliquer à Singapour ou à Pékin de nos jours. Bien sûr, Confucius était un homme pragmatique et il ne recommandait pas une opposition imprudente au pouvoir établi. Il préconisait des précautions et un tact réalistes, mais il soulignait néanmoins l'importance de la résistance. "Quand l'État suit le bon chemin, parlez hardiment et agissez de même. Quand l'État a perdu ce chemin, agissez hardiment, mais parlez prudemment", recommandait-il. L'idée principale à retenir est que les deux traditions occidentale et non-occidentale présentent chacune une grande variété. Aussi bien en Asie qu'en Occident, certains ont préconisé l'ordre et la discipline tandis que d'autres ont privilégié la liberté et la tolérance. L'idée que les Droits de l'Homme sont des droits inhérents à chaque être humain, ayant une portée universelle et une structure très développée est un développement vraiment récent. Mais certaines défenses limitées et modérées de la liberté et de la tolérance ainsi que des argumentations générales contre la censure peuvent être trouvées à la fois dans les anciennes traditions d'Occident et dans les cultures des sociétés non-occidentales.
L'Islam et la tolérance.
Des questions spécifiques se posent souvent à propos de la tradition islamique. Du fait des luttes politiques contemporaines, particulièrement au Moyen Orient, la civilisation musulmane est souvent dépeinte comme étant fondamentalement intolérante et hostile à la liberté individuelle. Mais autant pour l'Islam que pour les autres traditions, la diversité et la variété qui existent à l'intérieur d'un mode de pensée sont à prendre en considération. Les empereurs turcs étaient souvent plus tolérants que leurs contemporains européens. Les empereurs mongols en Inde, à une exception près, n'étaient pas seulement extrêmement tolérants en pratique, mais certains ont même théorisé la nécessité de tolérer la diversité. En Inde, les déclarations d'Akbar, le grand empereur mongol du 16e siècle au sujet de la tolérance pourraient compter parmi les grandes déclarations politiques classiques et auraient dû recevoir davantage d'attention en Occident, si seulement les historiens occidentaux de la politique avaient conçu autant d'intérêt pour la pensée orientale que pour leur propre héritage intellectuel. A titre de comparaison, il est à remarquer que l'Inquisition faisait encore des ravages en Europe lorsque Akbar en faisait une politique d'Etat que de protéger tous les groupes religieux. Un érudit juif tel que Maïmonide a dû fuir l'Europe intolérante du 12e siècle et les persécutions contre les juifs pour la sécurité offerte au Caire sous la protection du sultan Saladin. Alberuni, mathématicien iranien qui a écrit le premier livre de savoir général sur l'Inde au début du 11e siècle, en plus d'avoir traduit des traités mathématiques indiens en arabe, fut l'un des premiers anthropologues du monde. Il remarqua et s'indigna du fait que "la dépréciation de l'étranger est un trait commun à toutes les nations".
Autorité et dissidence.
Reconnaître la diversité au sein de différentes cultures est extrêmement important dans le monde contemporain, alors même que nous sommes bombardés de généralisations simplificatrices concernant la "civilisation occidentale", les "valeurs asiatiques", les "cultures africaines" et ainsi de suite... Ces lectures impropres de l'histoire et des civilisations ne sont pas seulement des constructions intellectuelles grossières, elles contribuent, de plus, à diviser le monde dans lequel nous vivons. Le manque de finesse dans l'analyse engendre la violence. Le fait est que dans toutes les cultures, les gens aiment se disputer les uns avec les autres, et qu'ils le font souvent. Je me souviens avoir été amusé, dans mon enfance, par un célèbre poème de Calcutta datant du 19e siècle. Le poète décrit l'horreur de la mort, le dard de la mortalité. "Imaginez un seul instant", dit le poème, "combien cela sera terrible le jour où vous mourrez / les autres continueront de parler et vous ne pourrez pas leur répondre". Le pire fléau de la mort semble être, de ce point de vue, l'incapacité de converser, ce qui prouve combien nous prenons au sérieux nos différences et nos débats. Des dissidents s'élèvent dans toutes les sociétés, souvent aux dépens de leur propre sécurité. Les discussions portant sur l'Occident dans les sociétés non-occidentales sont souvent trop respectueuses de l'autorité -- que ce soit le gouverneur, le Ministre, le chef militaire ou le chef religieux. Ce "détournement autoritaire" est sous-tendu par le fait que les occidentaux eux-mêmes sont souvent représentés dans les conférences internationales par des officiels et des porte-paroles gouvernementaux et que ceux-ci cherchent comme unique réponse l'avis de leurs homologues des autre pays. En effet, l'opinion selon laquelle les valeurs asiatiques sont autoritaires par essence tend à provenir presque exclusivement des porte-paroles de ceux qui détiennent le pouvoir et de leurs avocats. Mais les ministres des affaires étrangères, les officiels gouvernementaux ou les chefs religieux n'ont pas le monopole de l'interprétation des cultures locales et de leurs valeurs. Il est important d'être à l'écoute des voix dissidentes dans toute société.
La diversité nationale et culturelle.
En conclusion, les soi-disant "valeurs occidentales de liberté et de libération", parfois considérées comme le legs exclusif de l'Occident antique, ne sont ni particulièrement anciennes, ni d'origine exclusivement occidentale. Bon nombre de ces valeurs n'ont atteint leur forme définitive qu'au cours des derniers siècles. Bien que l'on puisse en retrouver quelques éléments annonciateurs dans certains aspects de la tradition occidentale, on en trouve également au sein des traditions non-occidentales. En particulier au sujet de la tolérance, Platon et Confucius pourraient être rangés d'un même côté, tandis que Aristote et Açoka se trouveraient de l'autre. La nécessité de reconnaître la diversité surtout s'impose non seulement entre les nations et les cultures, mais aussi au sein même de chaque nation et de chaque culture. Par souci de relever correctement la diversité internationale, les divergences culturelles et les soi-disant différences entre la "civilisation occidentale", les "valeurs asiatiques" et la "culture africaine", on néglige trop gravement l'hétérogénéité qui existe dans chaque pays et culture. Les concepts de "nation" et de "culture" ne sont pas spécialement de bonnes unités de mesure pour comprendre et analyser les différences politiques et intellectuelles. Les lignes de front entre "pour et contre" ne correspondent pas aux frontières nationales; elles s'entrecroisent à différents niveaux. La rhétorique des cultures, où chaque culture est analysée globalement et décrite en termes trop généralistes peut en effet nous égarer gravement aussi bien politiquement qu'intellectuellement.
(Traduction de Géraldine Mattioli)
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter