Frederick Griffith
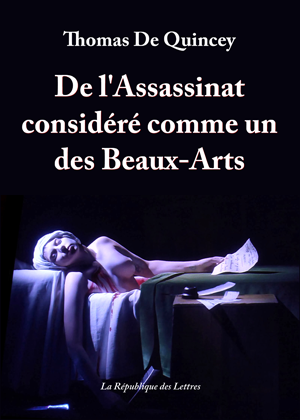
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques

On ne sait presque rien de Frederick Griffith, biologiste de la première moitié du XXe siècle: il n'a obtenu ni prix Nobel, ni médaille; il n'a pas même de biographie officielle. Il fait pour tout dire l'objet d'un oubli quasi-complet.
On peut certainement gager que s'il appartenait à l'Université d'aujourd'hui, ou plutôt à celle de demain, celle réformée par les bons soins de Valérie Pécresse, il hériterait d'un nombre conséquent d'heures d'enseignement, au détriment de ses possibilités de recherche: car cet homme ne satisferait pas aux critères évaluatifs. Il ne serait pas considéré comme un chercheur émérite, ni, surtout, efficace; il serait au contraire victime d'une certaine condescendance -- justifiée, certainement, puisqu'on l'a oublié. Et pourtant, Frederick Griffith est l'un des pères de la découverte de l'ADN.
Cette condescendance n'est pas seulement due à l'insolence ou à l'ingratitude de ses successeurs qui, s'étant emparé de ses travaux et les ayant dépassés, auraient considéré ces prémisses comme des balbutiements sans intérêt eu égard aux progrès accomplis depuis. Non, ce n'est pas la marche du progrès qui explique le manque de reconnaissance envers Frederick Griffith, qui expliquerait que s'il vivait aujourd'hui, il serait enseignant plus que chercheur: c'est la nature même de ce personnage et de ses recherches.
C'est la nature même de la recherche, dans sa nudité -- à l'opposé des circuits de concurrences actuels avec lesquels on la confond -- qui l'empêcherait paradoxalement d'être chercheur.
Nous sommes en 1928, en Angleterre. Griffith est biologiste, au service du gouvernement anglais; il effectue des expériences sur les pneumocoques. Il a isolé deux types de bactéries: deux souches de pneumocoques. Les premières, nommées "S", comme sweet, sont recouvertes d'une capsule qui les rend lisses. Les secondes, "R" (de rough, en anglais, rugueuses), se présentent sous une forme non capsulée. Une fois cette différence observée, Griffith mène dans son laboratoire des expériences que l'on pourrait qualifier de prévisibles: il injecte à des souris saines, d'une part, les souches "R", d'autre part les souches "S". Le résultat a le mérite de la simplicité: seules les bactéries encapsulées sont mortelles pour les souris. Seules, elles pénètrent l'organisme et transmettent la maladie. Les cellules "R", au contraire, sont inoffensives.
Il faut donc, pour mieux comprendre le phénomène, étudier les souches "S". Et d'abord vérifier leur rôle. Pour cela, Griffith imagine de tuer les cellules "S" avant de les inoculer aux souris: ces bactéries, une fois mortes (sous l'action de la chaleur), n'affectent plus les souris. La vérification valide les premières observations. La suite "logique" consisterait, semble-t-il, à ouvrir les souches "S" vivantes, à approfondir la connaissance de ces bactéries virulentes en essayant de comprendre comment elles contaminent les cellules dans lesquelles elles sont injectées.
C'est à ce moment que Frederick Griffith perd toute sa crédibilité. A ce moment qu'il entre et sort de l'Histoire des sciences, d'un même mouvement. Au lieu de s'engager dans ce type de recherches, il s'en écarte au contraire résolument -- et de façon absolument incompréhensible. Les articles scientifiques qui évoquent cette étape du cheminement biologique de Griffith marquent tous leur étonnement, affirment "l'aberration" constituée par l'expérience suivante. Et cette expérience s'étant finalement révélée décisive, à l'aberration se superpose la notion de "heureux hasard".
Aberration: Griffith décide d'inoculer aux souris, comme dans l'expérience précédente, des souches "S" désactivées par la chaleur -- mais auxquelles il ajoute des souches "R". Autrement dit, il injecte deux souches dont il sait déjà que chacune est inoffensive pour la souris: les "R" parce qu'elles sont sans capsules, les "S" parce qu'elles ont été chauffées. Quelle justification donner à cette déviation, ce temps perdu, cette opération qui ne peut pas même servir de vérification ? Pourquoi observer la réaction produite par l'addition de deux éléments dont l'innocuité est reconnue ? Cela ne peut mener à rien.
Or, le fait est que le résultat est à la mesure de cette aberration: contre toute attente, les souris meurent. Heureux hasard. A partir de là, si ce n'est Griffith, ce sont ses pairs qui vont creuser, imaginer comment le principe mortel désactivé aura pu, au contact d'une souche inoffensive, reprendre son offensive. Découvrir quinze ans plus tard, en 1944, que le facteur transformant est un fragment d'ADN passé de la souche "S" à la souche "R", et s'intégrant au chromosome "R". Attendre que cet ADN soit mieux connu afin qu'on puisse se convaincre de sa capacité à transporter des informations. Entre temps, Frederick Griffith sera mort -- en 1941, lors du bombardement de son laboratoire.
Reste l'énigme irradiante de cette expérience hétérodoxe, énigme d'autant plus gênante qu'on ne réussit pas à lui imprimer, malgré nos efforts rétrospectifs, le statut d'intuition géniale ou celui de l'erreur féconde. Frederick Griffith n'agit ni selon une vue fulgurante, ni selon une bévue. Mais bien plutôt selon une proximité avec la nature profonde de la démarche expérimentale: celle qui consiste à apprendre à connaître en se défiant de ses connaissances.
Ce que fait en effet Frederick Griffith ici, c'est refuser sa confiance à un modèle logique. Il prend le large; il se rend compte, confusément peut-être (sa discrétion nous laissera dans l'incertitude), que l'addition de deux vérités liées à la vie ne se ramène pas à l'addition de deux vérités mathématiques. Il établit ainsi que ce que l'on sait de l'organisme vivant ne peut laisser présager de façon mathématique de son fonctionnement. Comme un souvenir du "doute" de Claude Bernard: "il n'y a, affirme le médecin dans son Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, de vérité absolue que pour les principes mathématiques; pour tous les phénomènes naturels, les principes desquels nous partons, de même que les conclusions auxquelles nous arrivons, ne représentent que des vérités relatives. (...) L'expérimentateur doute donc toujours, même de son point de départ".
De ce doute jaillit précisément cette expérience, c'est-à-dire la concrétisation d'une manière de se départir des convictions trop apparentes et des certitudes. Pas de hasard, mais au contraire la démarche scientifique dans toute sa vérité: pas d'aberration, si ce n'est au sens étymologique d'éloignement, de déviation. Griffith, inoculant à ses souris deux souches séparément inoffensives, réalise un véritable tour de force, une acrobatie proprement incroyable puisqu'il parvient à douter, non pas de ses expériences précédentes, mais de ce qui les sous-tend -- de la relation univoque entre la souche virulente et le corps atteint. Car injecter les deux souches désactivées, c'est présupposer qu'il peut se passer quelque chose entre elles, et avec le corps receveur: quelque chose de si inimaginable que Griffith ne saura pas même que faire du résultat obtenu.
Voilà pourquoi il entre et sort à la fois, en même temps, de l'histoire des sciences: il y entre, parce que sans lui, ni Avery ni ses confrères n'auraient pu en 1944 entreprendre la recherche du facteur transformant les bactéries désactivées en bactéries virulentes -- à savoir l'ADN. Il en sort, parce que son travail ayant partie liée à la nature profonde de la recherche, il ne présente pas les marques d'un plan d'expérimentation concerté et ne peut même se donner les moyens d'aboutir.
C'est justement en cela qu'il peut aujourd'hui nous aider. Dans une période qui énonce comme "de bon sens" le fait d'évaluer les chercheurs selon le nombre de leurs publications et les résultats obtenus, dans un temps qui se veut "pragmatique" et prône l'efficacité, le parcours de Frederick Griffith résonne comme un avertissement. L'excellence ne se confond pas avec un prix Nobel ni avec la programmation d'expériences parfaitement cohérentes avec la cible visée, se succédant dans un plan logique imparable. Les chercheurs se doivent au contraire de prendre des chemins de traverse, de toujours prendre le temps de douter pour, peut-être, trouver -- encore faut-il qu'on leur en laisse le temps, la latitude.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter