Google | Twitter | Facebook | Blog | Lettre d'information | Fnac | Kobo | iTunes | Amazon
La République des Lettres

Rainer Maria Rilke
Lettres à un jeune poète
La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0207-4
Livre numérique (format ePub)
Prix : 5 euros
Disponible chez • Fnac • Amazon • Kobo • iTunes
Histoire de La Commune de Paris
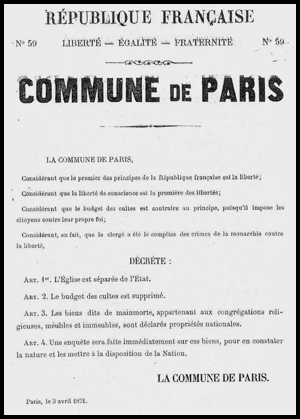
Il me paraît à y bien réfléchir qu'écrire sur l'événement survenu à Paris dans les premiers mois de 1871 est extrêmement difficile. Il semble exister un accord général sur ce constat, si je m'en réfère à tous les auteurs qui s'y sont essayés. Là s'arrête d'ailleurs le constat: car, une fois celui-ci posé, les divergences sont extrêmes. La difficulté tient à deux facteurs distincts, quoique évidemment liés. D'une part, il est impossible en pratique de donner une interprétation (une lecture) qui rende compte de la complexité de l'objet étudié. D'autre part, les auteurs qui se sont appliqués à cette étude ont pris parti. Prendre parti, c'est définir l'objet. On peut dire que le premier parti est d'accorder à une addition de faits survenus de façon concomitante une valeur conceptuelle globale: la Commune, insurrection des travailleurs, ébauche de gouvernement des travailleurs (4). Le même parti, quoique de signe opposé, parle de guerre civile, de soulèvement de la barbarie contre la civilisation. Cette seconde lecture, négative, a eu sa période: celle-ci tend à refaire surface dans le sillage soulevé par la dénonciation des crimes collectifs, globalement attribués à toute forme révolutionnaire, fascisme, nazisme, stalinisme: plus généralement tout mouvement contre l'ordre spontané (le seul naturel) et les hiérarchies instituées (par la tradition).
Le second parti paraît bénin: il consiste à reconnaître le caractère illisible de l'événement. On trouve là les amateurs de listes non exhaustives: la pluralité des causes tend vers l'infini: sursaut patriotique après la défaite face à la Prusse, nationalisme de gauche, surgissement soudain de tous les mouvements d'opposition jugulés sous l'Empire, tentative des blanquistes, de l'Internationale ouvrière, des proudhoniens, des anciens de 1848 (les Vieilles barbes), etc. Nous retrouvons ici sans surprise les balbutiements de la sociologie empiriste, déjà à l'oeuvre pour analyser mai 68, les loisirs des Français, les mutations de la famille et autres sujets ouverts à toutes les curiosités: il n'y a qu'à se servir.
Pour qui souhaite comprendre, c'est-à-dire voir ce que voyaient les acteurs, savoir ce qu'ils savaient, mais évidemment ne pas croire ce qu'ils croyaient (deuxième commandement de Max Weber), il est très gênant de procéder à une étude approfondie: aucune version ne concorde, des témoins qui ont laissé une trace. L'Idealtype qui vient dès lors à l'esprit du chercheur digne de ce nom est donc celui d'un désordre. Essayons une analogie pour mieux saisir la nature du problème: une étude de la première guerre mondiale semble aisée. Des États liés par des engagements pris d'avance: l'union sacrée réalisée en dépit des promesses de fraternité internationale: une montée aux extrêmes des moyens militaires accompagnée d'une idéalisation de la guerre comme civilisatrice (rien à voir avec les jeux d'alliance, les provinces perdues, etc.): une simplification du sens perçu par les acteurs: tenir !
L'inconvénient est que rien de tout cela n'est vrai. La lecture que je viens de résumer est erronée, et à plus d'un titre. Les alliances anciennes ne tinrent pas toujours: des alliances nouvelles se nouèrent: des défections apparurent, non seulement au sein des nations combattantes (tentatives de négociations, insoumissions, révoltes), mais encore défection d'un allié qu'on croyait invincible (la Russie). Des stratégies divergentes furent essayées: ouverture de fronts secondaires (les Dardanelles, la Grèce), guerre des approvisionnements maritimes aboutissant à des effets inattendus (entrée en guerre des États-Unis). L'effondrement des régimes politiques des Empires centraux, qui provoqua l'arrêt des opérations militaires bien avant que le territoire des vaincus ne fût envahi ou leurs armées militairement battues. Bref, l'ordre n'est qu'apparent: il tient à la définition préalable (le cadre conceptuel) de guerre entre États.
Lorsque "la Commune" est l'objet de l'étude, quel est le cadre conceptuel adéquat ? On ne voit guère que celui de guerre civile. C'est ainsi que Marx avait intitulé l'ouvrage écrit pour la circonstance. Hélas ! c'était un écrit de circonstance. Et que n'a-t-on dit ou imprimé à son sujet ! Que Marx aurait donné un sens idéologique à des faits qui n'en avaient pas: qu'il manquait des informations factuelles pour apprécier le déroulement, et donc la signification des faits: que ce texte avait après coup contribué à la légende, si tant est qu'il ne l'avait pas forgée. Qu'est-ce qu'une "guerre civile" ? Un combat d'une partie de la société contre une autre partie. Sans doute, mais de quelles parties s'agit-il ? À l'évidence une alternative: travailleurs contre capitalistes ou patrons (l'appellation peut varier), ou progressistes contre réactionnaires. Ce qui n'est pas du tout pareil. Nous le verrons sous peu.
Mais n'avons-nous pas encore d'autres lectures au choix ? La thèse selon laquelle les bellicistes se seraient opposés aux pacifistes a été soutenue. Cette thèse souffre d'un grave défaut: elle est stupide. D'abord parce que avant la guerre, les bellicistes étaient les partisans de l'empereur Napoléon III, les pacifistes ceux qui prônaient l'Internationale des travailleurs. Monsieur Thiers est peut-être le seul à avoir eu toujours raison: d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il était opposé à la guerre: il voulut la paix. Cela dit, il la voulait pour des questions d'opportunité. Nous voici au second argument contre la thèse: que peut bien vouloir dire "pacifistes" lorsqu'on veut désigner par ce mot ceux qui, craignant la guerre populaire, le retour de 1793 et de la Terreur, voulurent à tout prix la capitulation face à l'Allemagne victorieuse (la Prusse était devenue l'Allemagne par l'opération du saint-Esprit) ? Il faudrait être bien ignorant des faits pour parler ainsi: Bazaine capitulant à Metz était-il pacifiste ? D'Aurelle de Paladines, le "général jésuite" opérant en dépit du bon sens à la tête des troupes inexpérimentées "républicaines" (armée de la Loire) qu'il ne tenta jamais de faire marcher sur Paris, était-il pacifiste ? Jules Favre pleurnichant pour obtenir la paix contre l'Alsace et la Lorraine, oubliant dans son émoi de prévenir les intéressés que les armées de l'Est étaient exclues du cessez-le-feu, était-il pacifiste ? J'en passe (5).
Et les bellicistes ? Républicains, patriotes, opposants "de gauche" à l'Empire, que voulaient-ils donc ? Arrêter l'humiliation qu'on avait infligé à la nation ? Conquérir le pouvoir par le biais de la "guerre révolutionnaire" (On verra l'importance, au moins symbolique, de Garibaldi et de Blanqui, dans cet épisode tragique) ? Renverser l'oppression capitaliste et abolir le salariat: édifier le gouvernement fédéré des travailleurs, façon Proudhon: fonder la dictature du prolétariat, façon Marx ? Tout bonnement, ceux qui avaient souscrit avec leurs économies pour des canons, les considérant comme leur propriété (leur capital ?), refusèrent-ils de les rendre et de perdre leur argent et la considération sociale que ces canons leur conféraient en tant que défenseurs de la patrie, leur seule dignité ? Et, supposé-je, par effet de composition, ils en vinrent, au passage, à fusiller les généraux Lecomte et Thomas qui voulaient ravir leur dignité (et leurs sous). De là un front unique, possédants contre prolétaires, ceux qui ont le droit de défendre la patrie et ceux qui peuvent mourir pour elle quand on leur ordonne de le faire, une double méprise entretenue et rendue affreux malentendu par suite du face-à-face: les gens de bien (de biens) quittant Paris (tant pis pour les canons !) en se promettant de revenir mater la canaille quand Guillaume (le nouvel empereur) voudrait bien restituer les armées confisquées à l'ancien Empereur mais non point anéanties et quasiment prêtes à l'emploi.
On voit par là toute la difficulté à traiter sérieusement de questions qu'on cherche à rendre intelligibles. Remarquons bien ceci: pour les acteurs, jamais l'événement ne fut intelligible. Certains y virent une occasion de s'emparer d'un pouvoir, grand ou petit: Raoul Rigault, opposant exalté à l'Empire au nom de la liberté n'eut de cesse qu'il n'obtînt le poste de préfet de police de la Commune. Il en usa pour faire fusiller des gens qu'il n'aimait pas. Un grand nombre, ceux qu'on peut voir sur les photos d'époque par exemple posèrent pour une gloire inattendue: c'étaient comme de grandes vacances, mais qui donnaient l'occasion de jouer un rôle: le sien, mais en homme libre, armé, jouissant de son temps, payé et débarrassé des sergents de ville, des patrons et des huissiers, des concierges chargés d'encaisser les loyers aussi. (D'où nombre de dénonciations subséquentes lorsque l'ordre moral fut rétabli par l'armée française.) Des gens admirables, des dévouements incroyables aussi: femmes organisant des réunions pour l'instruction et l'émancipation d'autres femmes: combattants ouvriers s'efforçant de faire aboutir ce qui n'était jusque-là que revendications. Louise Michel, Eugène Varlin, pour citer les plus connus et les plus exemplaires des insurgés, loin de constituer une avant-garde pour l'avenir, tentèrent dans la cohue de donner l'impulsion, de montrer par l'exemple ce qui pratiquement était faisable. D'impénitents bavards, hommes d'importance, sots à panache et habiles négociateurs (le négoce porte sur toute marchandise échangeable), Delescluze, vieux Jacobin, Félix Pyat, opposant républicain, tant d'autres, virent là l'opportunité tellement attendue de se faire valoir, de récompenser toute une vie d'échecs. Delescluze, vieille barbe de 1848, comme on nommait ses pareils, ne voulut pas survivre à ce dernier et lamentable essai de prendre le pouvoir. Il avait connu le bagne de Cayenne: il était profondément amer d'avoir partout échoué, là où il aurait voulu de la grandeur, la noble simplicité jacobine: il marcha, on le sait, au-devant d'une barricade et fut abattu par les soldats, lors de la reprise de Paris par les Versaillais. Il rêvait d'une grande République et des "États-Unis d'Europe", comme il l'écrivit de Bordeaux, juste avant la Commune, le 24 février 1871.
Ce qui complique encore la tâche du chercheur, c'est l'extraordinaire aversion que les uns conçurent pour les autres, à l'intérieur de ce qui devint un camp retranché, et qui avait été un camp retranché déjà auparavant, lors du siège mené par les Prussiens. Pour qui lit les papiers posthumes de Rossel, Cluseret, qui l'avait précédé comme délégué à la guerre, était un imbécile: les comités, innombrables à vrai dire, autant de groupes d'incapables brouillons et jaloux les uns des autres. Cluseret (6), qui passa pour traître, juge de son côté qu'on l'a empêché d'agir: qu'il fut arrêté au moment où il parvenait enfin à mettre sur pied une organisation militaire alors inexistante. La minorité fut incapable de se faire entendre d'une assemblée hétéroclite, élue comme assemblée municipale et mise au défi par sa propre jactance d'agir comme gouvernement, sous la surveillance des comités résultant de la fédération de la garde nationale. Encore celle-ci, qui avait renié son origine bourgeoise, ne fut-elle jamais entièrement acquise à la Commune, c'est-à-dire au "gouvernement" qui résultait des élections parisiennes face au "gouvernement" issu des élections en province. Les bataillons fédérés, ou plus exactement les comités issus de cette fédération (et il y avait même un comité d'artillerie, outre les vingt comités d'arrondissements), gardaient les armes sans vouloir se dessaisir des fusils, des canons, des munitions et surtout des hommes nécessaires à une organisation militaire efficace contre Versailles.
Il y eut une question, posée par les historiens, nécessairement pourrait-on dire: y avait-il un "mouvement ouvrier", et si oui, s'était-il doté d'un but, d'un objectif final, édification du socialisme, éradication de l'État bourgeois ? Que répondre ? L'influence exercée par Marx, et surtout ensuite par les marxistes, pour parler d'un sens de l'Histoire, n'a pas peu contribué à orienter la pensée. D'où l'idée d'échec ou de réussite du mouvement ouvrier, de place de la Commune dans son histoire: nous verrons comment la Commune ne fut pas un gouvernement ouvrier: elle n'en fut ni une ébauche, ni le préambule nécessaire à une prise du pouvoir par le prolétariat. C'est ce "camp républicain", aussi disparate que celui de la guerre d'Espagne entre 1936 et 1938, qui dut faire face, sans que ses partisans ne parviennent à croire au massacre qui se préparait, à une armée résolue et commandée de façon impitoyable par des hommes qu'on croyait vaincus, dispersés par le vent de l'histoire, et qui se firent les champions de la vraie France.
L'empire devenu "libéral" favorise l'industrie. L'Empereur écrit, le 15 janvier 1860:
Le moment est donc venu de nous occuper d'imprimer un grand essor aux diverses branches de la richesse nationale [...] Depuis longtemps on proclame cette vérité qu'il faut multiplier les moyens d'échange pour rendre le commerce florissant ; que sans concurrence l'industrie reste stationnaire et conserve des prix élevés qui s'opposent aux progrès de la consommation ; que sans une industrie prospère qui développe les capitaux, l'agriculture elle-même demeure dans l'enfance [...] Ainsi, avant de développer notre commerce étranger par l'échange des produits, il faut améliorer notre agriculture et affranchir notre industrie de toutes les entraves intérieures qui la placent dans des conditions d'infériorité.
Des grèves ouvrières paraissent être l'effet le plus sensible de cet essor. Les peurs de la "classe moyenne" reviennent: non seulement la peur des "prolétaires", mais celle que les propriétaires fonciers, les paysans ressentent au souvenir des bouleversements qu'a connus la Grande-Bretagne après l'abolition des Corn Laws et l'instauration du libre-échange. D'ailleurs, le traité commercial passé avec l'Angleterre, suscite des remous immenses parmi les industriels aussi bien. Quant aux travailleurs, ils nouent des contacts internationaux, en Angleterre principalement. Il en naît l'Internationale ouvrière, qui, malgré les procès qui lui sont faits à partir de 1867, diffuse rapidement. Au mutuelliste (proudhonien) Tolain a succédé Eugène Varlin (collectiviste antiétatique). Notons que le cinquième congrès de l'Internationale, divisée déjà entre Bakounine et Marx, devait se tenir à Paris en septembre 1870. Car, loin d'avoir éteint le paupérisme, le régime a permis au patronat d'empêcher toute organisation ouvrière, même lorsque le droit de grève est concédé sur le tard. Si, en 1864, le gouvernement a aboli l'interdiction des coalitions ouvrières, il interdit leurs organisations permanentes. Au proudhonisme, bénin en dépit de la parution du sulfureux De la capacité politique des classes ouvrières, s'oppose de plus en plus un mouvement ouvrier qui refuse toute conciliation avec le régime, quelque démagogique qu'il ait cherché à paraître. Des ouvriers s'organisent: Eugène Varlin fonde La Société des relieurs (il était ouvrier relieur); Benoît Malon, La Revendication de Puteaux. Paule Minck, qui, en 1868, "débutait alors à la tribune avec son genre sarcastique", crée L'Ouvrière, un syndicat féminin. Ranvier, le 30 janvier 1869 à Belleville, dénonce la "liberté", façon Empire: "C'est avec la liberté qu'on prostitue les femmes du peuple. C'est la liberté qui fait qu'on gâche le droit." Emmanuel Chauvière, qui sera député blanquiste de Paris, déclare les 24 et 30 janvier 1869 à la Rotonde et à Belleville:
Dans l'organisation actuelle du travail, il y a deux sortes d'individus: les uns qui prélèvent les neuf-dixièmes sur le travail, les autres qui prélèvent un dixième, les uns qui consomment sans travailler, les autres qui travaillent sans consommer. Ceux-ci ne possèdent rien, ceux-là possèdent la source de toutes les productions... la terre ! Nous naissons et déjà nous pouvons nous demander si la terre est faite pour tous ou pour quelques-uns. Nous posons le pied quelque part. À qui appartient ceci ? À un propriétaire. Nous grandissons. Et parce que nous n'avons pas de propriété, il nous faut travailler pour le propriétaire. Nous grandissons encore et nous prenons un fusil. Et il faut aller nous faire tuer pour défendre la propriété d'un propriétaire.
Pour ces propos, et l'appel au drapeau rouge, il bénéficiera de six mois de prison pour "excitation à la haine des citoyens les uns contre les autres". Allons, Babeuf n'était pas encore vraiment mort !
Émile Duval, ouvrier, internationaliste, l'une des plus belles figures de l'insurrection, dont il a été question, déjà, et dont on reparlera, encore, déclare lors d'une réunion publique à la barrière Montparnasse:
Il faut supprimer ce reste de féodalité qui ne s'appelle plus noblesse mais bourgeoisie... Nous voulons l'égalité des salaires, que la valeur de chaque chose soit basée sur le temps qu'on a mis à la produire... Nous voulons l'application du droit naturel, l'égalité: nous supprimons l'hérédité, la propriété individuelle et le capital, qui ne peut exister sans travail. En 48, on a proclamé le droit au travail, nous proclamons l'obligation au travail. Que celui qui travaille mange, mais que celui qui ne travaille pas n'ait aucun droit... Par la collectivité plus de paupérisme.
Enfin, une part grandissante de la bourgeoisie se radicalise et aspire aux libertés politiques. La presse muselée s'en fait le porte-parole. Des journalistes: Rochefort, Victor Noir, dont l'assassinat par un cousin de l'empereur donnera lieu à une tentative d'émeute, ainsi qu'on va le voir, représentent une opposition politique républicaine. Les "révolutionnaires", principalement blanquistes, réapparaissent en force. Gustave Flourens, l'un des plus bouillants blanquistes, chevaleresque et intrépide, selon Clarétie, arrêta un soir, le 7 février 1870, un commissaire de police, venu contrôler une réunion en faveur de Rochefort. Flourens sortit son revolver et saisit le commissaire au collet. Celui-ci fut pris de peur de ne pas revoir femme et enfants, Flourens lui dit: "Vous les reverrez, soyez calme. Les républicains n'assassinent pas !"
Flourens ne rêvait que de barricades et de combats. Il écrit alors:
Parler à l'armée par la presse et lui raconter son opprobre, son abjection, lui faire comprendre qu'elle était plus esclave que nous, enlever aussi aux assassins du 2 décembre leur principal soutien [...]: émouvoir, agiter les esprits sans cesse [...] en se battant, en dressant des barricades, même incomplètes, insuffisamment défendues et bientôt prises, en ébauchant chaque jour quelque nouveau complot parmi les citoyens ou parmi les soldats, dût chacun de ces complots avorter successivement [...] telle devait être, telle fut la tactique de tous les hommes d'action.
Flourens, tout comme Blanqui, avait lu et absorbé comme un bréviaire le livre de Philippe Buonarroti La Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf publié en 1828 à Bruxelles. L'enterrement de Victor Noir, ce journaliste assassiné, donna lieu à une immense manifestation. Les blanquistes auraient voulu en faire une émeute. "Notre pauvre Victor Noir tomba, première victime de cette lutte", écrit Flourens, comme si les grévistes tués par les gendarmes et les troupes de ligne ne comptaient pas ! Comme si c'était une lutte d'idées qui se menait là: comme si, subitement l'armée allait pleurer un journaliste tué par un prince ! "Après avoir essuyé une fois le feu de l'armée, si nous avions eu le courage de marcher tous en avant (tous ! qui ? Les républicains ? Les ouvriers ? On voit bien là la confusion des esprits et plus encore l'amalgame de l'"opposition révolutionnaire", titre d'un ouvrage de Gustave Dommanget), portant notre mort dans nos bras, elle aurait fraternisé avec nous". C'est encore Flourens qui rêva une conspiration, qu'il relate lui-même:
S'emparer des Tuileries en une nuit, grâce à quelques intelligences au-dedans, et en y terrassant les bonapartistes, s'ils essayaient de résister, au moyen des formidables engins de destruction mis par la science au service des peuples opprimés: paralyser à force d'audace tous les souteneurs, si terriblement armés, du tyran, et, avec quelques hommes d'une immense énergie, affranchir de ses chaînes un grand peuple énervé: tel était le complot qui devait séduire alors tout coeur généreux et brave.
On note à la fois l'extrême naïveté du projet, sa foi en la science pour "défendre les opprimés", (son actualité également), et, en un mot sa méconnaissance complète des réelles "souffrances" d'un "peuple énervé", c'est-à-dire privé de nerfs. Flourens était biologiste. Raoul Rigault, le futur préfet de police de la Commune, grand fusilleur d'otages, devait prendre la tête de l'action, pousser avec ses affidés la foule contre policiers, gendarmes et troupes de ligne. Rien de tel n'advint. Rochefort, tête creuse des républicains radicaux et grand matamore, tira de cette glorieuse tentative, qui eût été un échec cuisant, un argument électoral.
Déjà en 1851 était parue une brochure intitulée Le spectre rouge de 1852, d'Auguste Romieu, publiciste "réactionnaire", où celui-ci dénonçait le péril: "Vous avez lu le dernier manifeste de M. Blanqui ? "Qui a du fer a du pain". Il a raison, et ce cri, qu'on dit sauvage, est le premier éclat de bon sens qui soit sorti d'une bouche française depuis 60 ans. De nos jours la logique (sic) est dans la mitraille." Et Romieu ajoute: "Les plus sages calculent comme si nous avions vingt ans de calme devant nous." Ce qui n'était pas mal vu ! Et que dire de son assertion: "La nation française n'existe plus. Il y a sur le sol des Gaules des riches inquiets et des pauvres avides: il n'y a que cela [...]. Ce qui les retient, à cette minute où j'écris, c'est l'armée." Des groupes blanquistes, certains armés, étaient régulièrement passés en revue par le chef, prêts à l'action. C'est ce qu'affirme le directeur de la police politique de l'Empire, Lagrange, lors de sa déposition devant la Commission d'enquête parlementaire sur l'"insurrection du 18 mars 1871." Entre fin 1867 et début 1868, "le vieux" avait estimé qu'il était temps de passer à l'organisation armée, au lieu des soulèvements spontanés voués à l'échec. En septembre 1867, un de ses lieutenants assure qu'il existait un groupe de 300 hommes enrégimentés, qu'il avait recrutés rue de Charonne. Blanqui voulut prendre lui-même le commandement de ces groupes, pour rien moins que s'emparer du pouvoir politique. Blanqui, formé à l'école de Buonarroti, et qui pensait être inspiré par la Conjuration de Babeuf, dressait des listes de sympathisants, de "républicains flottants". On le voit, la pluralité des mouvements, mais surtout des objectifs et des moyens envisagés, nuisait considérablement à l'action contre le pouvoir impérial, tout autant qu'à celle menée par les travailleurs contre le patronat. Avant d'aller plus loin, comment juger cet Empire ? Entre-t-il dans la nomenclature des droites de René Rémond ? On peut en douter. Il n'est pas légitimiste, ni orléaniste, encore moins bonapartiste (ou césarien). N'est-ce pas pousser l'esprit de contradiction un peu loin ? Je n'en crois rien. Le second Empire, et c'est cela qui nous intéresse, a échoué à assurer sa légitimité: il n'a pas laissé les affaires se régler selon le bon vouloir des intéressés, il n'a pas obtenu de brillants succès dans des guerres étrangères, qui assurent, et le butin et la paix publique. Saint-simonien mais guère machiavélien, ce régime peut être résumé (selon la bible saint-simonienne) par l'effacement du politique et le développement économique. Seulement, et c'est ce que les saint-simoniens n'envisageaient pas, le débat politique absent s'est transporté dans la clandestinité, ou dans l'exaltation de la détestation. Quant au développement, il eût supposé une classe d'entrepreneurs. N'existait-elle pas en France, et pourquoi en aurait-il été ainsi ?
Dans la nuit du 13 au 14 septembre, un Comité central républicain de Défense nationale des vingt arrondissements de Paris rédige la première Affiche rouge. Cette affiche contient le programme de ce comité, issu de la garde nationale, jusque-là tenue à l'écart des combats. Cette affiche proclame:
Citoyens, le 5 septembre, dès le lendemain de la proclamation de la République, un grand nombre de citoyens proposaient la constitution d'un Comité central républicain émanant des vingt arrondissements de Paris et ayant pour but de pourvoir au salut de la patrie, ainsi qu'à la fondation définitive d'un régime véritablement républicain par le concours permanent de l'initiative individuelle et de la solidarité populaire.
Depuis ce jour, les réunions publiques ont élu leurs comités de défense et de vigilance dans chaque arrondissement. Aussitôt que les arrondissements se sont trouvés représentés en majorité par quatre délégués chacun, le Comité central républicain a commencé ses opérations. Il a successivement présenté au gouvernement de la défense nationale les mesures suivantes, acclamées dans les réunions populaires:
1° MESURES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE:
Supprimer la police telle qu'elle était constituée, sous tous les gouvernements monarchiques, pour asservir les citoyens et non pour les défendre:
La remettre toute entière entre les mains des municipalités élues:
Nommer par quartier, dans les grandes villes, les magistrats chargés de veiller à la sécurité publique sous leur responsabilité personnelle et directe:
Dissoudre tous les corps spéciaux de l'ancienne police centralisée, tels que les sergents de ville, agents dits de la sûreté publique, gardes de Paris:
Confier à la Garde nationale, composée de la totalité des électeurs 80, et en particulier à des vétérans pris dans son sein, la mission d'assister les nouveaux magistrats de la police municipale dans l'exercice de leurs fonctions:
Appliquer aux magistratures de tous ordres les deux principes de l'élection et de la responsabilité:
Abroger toutes les lois restrictives, répressives et fiscales contre le droit d'écrire, de parler, de se réunir et de s'associer.
2° SUBSISTANCES ET LOGEMENTS:
Exproprier pour une cause d'utilité publique, toute denrée alimentaire ou de première nécessité actuellement emmagasinée dans Paris, chez les marchands de gros et de détail, en garantissant à ceux-ci le paiement de ces denrées après la guerre au moyen d'une reconnaissance des marchandises expropriées et cotées au prix de facture.
Ici, une explication s'impose: le commandement militaire désigné par le Gouvernement de défense nationale (Trochu, qui sera remplacé par Vinoy, futur chef massacreur en mai) hésitait déjà à déclarer défendables les fortifications de Paris, remparts et fortins. Pour le comité, c'est de la préparation à la guerre de rues qu'il s'agit. Blanqui a rédigé, peu auparavant, sans doute en 1869 (Gustave Geoffroy, le biographe de Blanqui en situe la rédaction en 1868), une Instruction pour une prise d'armes dont j'aurai à reparler plus loin. Il y décrit les mesures à prendre pour organiser une armée révolutionnaire, destinée à conquérir le pouvoir et à renverser le gouvernement par les armes. Il montre comment associer les travailleurs, selon leurs qualifications, à cette armée formée, si l'on peut dire, en dehors de leur propre mouvement, indépendamment de leurs formes spécifiques de combat. Ce sont les techniques, les méthodes des armées professionnelles d'alors, qu'il analyse. Mais surtout, il donne les instructions les plus détaillées pour dresser les barricades, empêcher qu'elles soient tournées. Il explique comment utiliser les boulevards, les rues latérales, de façon à compenser l'infériorité en artillerie et cavalerie: comment occuper les maisons, les étages, établir des communications d'un bâtiment à un autre en perçant les murs au préalable, de façon à échapper à l'encerclement, l'enfermement dirai-je (lui qui a passé tant d'années dans des cachots, lui l'Enfermé, comme le surnomme Gustave Geoffroy). Il indique le rôle tactique que peuvent jouer les égouts.
4° DÉFENSE DES DÉPARTEMENTS:
Décréter la levée en masse de tous les Français sans exception, et la réquisition générale de tout ce qui peut servir à la défense;
Appuyer toute organisation résultant de l'initiative populaire et ayant pour but de contribuer au salut de la République;
Commissionner des Délégués généraux pour la défense nationale, chargés de se concerter avec les républicains des départements, afin de stimuler le zèle patriotique des populations, combattre les manoeuvres réactionnaires, prévenir la trahison, précipiter la marche des volontaires au secours de Paris et, au besoin, se faire tuer à leur tête.
En présentant ces mesures d'urgence, les soussignés sont convaincus que le Gouvernement de la Défense nationale se hâtera de les transformer en décrets pour le salut de la patrie et de la République. Pour le Comité républicain et par délégation des Comités d'arrondissement.
Voilà. La conclusion suffit pour invalider tout ce qui précède. Le comité ne s'emparera pas du pouvoir. En revanche il entend s'adresser à la France entière. Ce n'est pas une affaire parisienne. Aucune des mesures recommandées ne passa en décret, malgré de vagues promesses de Jules Ferry. Il avait reçu une délégation qui venait protester après l'entrevue de Ferrières, où Jules Favre était allé s'enquérir des conditions d'armistice. Paris renfermait alors trois cent mille gardes nationaux et deux cent quarante mille soldats, gardes mobiles et marins. C'était une force énorme, même si les gardes nationaux (dits sédentaires) n'avaient reçu aucune instruction militaire, qu'on se garda bien de leur prodiguer. Durant tout le siège, les responsables officiels de la défense n'engagèrent que de faibles troupes pour des sorties dénuées de toute signification militaire: encore abandonnèrent-ils le peu de tentatives qui eussent conduit à un succès, comme la reconquête du Bourget. Ce combat, livré le 21 décembre 1870, fut engagé par une première armée dirigée par l'amiral de La Roncière. L'affaire commence par une canonnade: batteries et wagons blindés. D'après le récit de Ducrot, les marins engagés furent autant victimes des obus français que prussiens. Ducrot lui-même, à la tête de la seconde armée, entre en ligne avec des francs tireurs (division de Bellemare), des divisions de ligne: Susbielle, Faron, Berthaut, puis des gardes nationaux en réserve. Il s'apprêtait, dit-il, à poursuivre son mouvement en avant, lorsqu'il reçut de Trochu ce télégramme: "L'attaque du Bourget paraît avoir échoué, nous n'avons plus de point d'appui à gauche: votre mouvement sur Aulnai et Blancmesnil ne peut continuer: arrêtez-vous." Aulnai (en réalité Aunai) et Blanc-Mesnil sont au nord-est de Drancy. Il fallut s'arrêter, écrit Ducrot. Le Bourget, qu'on pouvait tenir, fut évacué.
"Les grands cimetières sous la lune" ou La Commune "innocentée"
Je reproduis ici le récit d'un témoin, mais c'est un morceau d'anthologie, lucide comme Stendhal dans Lucien Leuwen, ironique comme Giono du Roi sans divertissement, digne de Swift ou du Dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce. C'est une lettre, ou plutôt ce sont les fragments d'une lettre qu'en 1884, Alphonse Fromillon, qui a vécu la Commune, écrivit à l'un de ses amis, l'abbé Georges Frémont, pour le détourner des croyances du temps à propos de cet épisode tragique. Ces extraits avaient été publiés dans la revue Europe, en avril-mai 1971, à l'occasion du centenaire de la Commune. Jacques Madaule, historien intègre, écrivit une préface à ce texte, j'en extrais le début:
Ces guillemets dans le titre (La Commune "innocentée") signifient évidemment que, pour nous, il n'y a pas lieu d'innocenter la Commune au moment de fêter son centenaire. Elle ne fut coupable d'aucun des crimes que ses ennemis lui imputèrent, et par quoi ils entendaient justifier leurs propres forfaits. Mais elle ne fut pas non plus coupable d'avoir été la Commune, c'est-à-dire une tentative héroïque et prématurée pour établir un ordre nouveau dans le vide de l'ordre ancien qui s'était évanoui soudain comme un cauchemar. C'est sa gloire. Tel n'était pas l'avis d'Alphonse Fromillon, dont on va lire quelques pages extraites d'un long mémoire que ce témoin avait composé en 1884 pour son ami l'abbé Georges Frémont [...].
Voici les passages en question. Le lecteur comprendra, par tout ce qui précède, le sens qu'il convient d'attribuer à l'apologie de Fromillon. Lui-même, dans une partie de son récit que je ne reproduis pas ici, précise qu'il n'était en rien favorable à la Commune: que d'ailleurs celle-ci n'a jamais été capable d'organiser ou de commander quoi que ce soit. Il affirme qu'il n'y eut pas de combats, ou presque, du 18 mars au 21 mai: que le nombre de communards combattants était "si minime qu'il n'y avait pas de combat possible" (p. 35), et que l'armée se contenta de bombarder Paris "et de faire de temps à autre quelque rafle de fédérés jouant au bouchon". La part faite à l'exagération, c'est à peu près ce qui me semble avoir été la vérité. D'ailleurs, les fédérés ne défendirent pas la moitié Ouest de Paris, on l'a vu, et l'on sait quelles difficultés Rossel, et même des hommes aussi populaires que Dombrowski, rencontrèrent pour faire assurer le service des fortifications.
Il estime que sur les 20.000 fusillés, 19.700 n'avaient pas tiré un coup de fusil, par peur, précisément, assure-t-il, des représailles. On objectera que ce décompte est excessif et peu vraisemblable. Mais ceux qui avaient vraiment combattu étaient presque tous morts aux barricades, on n'avait même pas eu à les fusiller, avec ou sans jugement. On fusilla, comme pétroleuses, dit-il, les ambulancières improvisées, qui avaient recueilli et soigné des blessés. On fouilla les maisons, pièce par pièce, et les officiers, de leur propre initiative, faisaient tuer qui leur plaisait (ou déplaisait), enfin, qui bon leur semblait. La seule erreur de M. Thiers, dit Fromillon, est d'avoir escompté que les fédérés seraient assez barbares pour tuer tant de gens, qu'il serait lui-même quitte devant ses contemporains, et devant l'histoire, des massacres qu'il ordonna. Ce serait alors la seule fois de sa vie, que Monsieur Thiers se trompa. Voici maintenant le texte de Fromillon, que je reproduis tel quel.
Mon cher ami,
Je vous avais annoncé que je vous donnerai mes opinions sur quelques événements d'histoire récente particulièrement sur la Commune. Je vais essayer de m'exécuter. [...]
Au 4 septembre, il n'y avait rien de perdu: l'Empire s'était anéanti et la nation était dans le délire de l'enthousiasme -- avec une telle disposition d'esprit, un peuple est invincible. Il est vrai qu'il y avait plus de 450.000 hommes perdus, compris ceux que Bazaine devait livrer, mais on pouvait en trouver un million pour repousser l'envahisseur: ils furent levés en effet, -- pas assez vite toutefois: -- il aurait fallu pour les réunir un organisateur en chef de premier ordre, -- la France n'en trouva pas un seul, même de 10e ordre, sauf Gambetta, et qui passa son temps à souffler sur des cendres pour en tirer quelque flamme, mais les cendres étaient éteintes: vraiment il méritait un meilleur sort, mais il était seul, il n'a trouvé personne pour le seconder efficacement. Son plan était simple, il devait écraser les Prussiens entre la Province et Paris et, se réunissant ensuite à l'armée de Paris, poursuivre l'ennemi jusqu'à Mayence, sinon l'envelopper. Ce sera l'honneur perpétuel de la Prusse, de son roi, de Moltke, de Bismarck, d'avoir eu l'audace de s'engager dans une telle aventure et d'avoir exécuté cette audace: car c'était vraiment une folie que le succès seul pouvait excuser, d'avoir l'idée de faire avec 2 ou 300.000 hommes le siège de paris contenant deux millions d'âmes, 500.000 hommes valides et ne manquant de rien, en présence d'une armée de secours de 400.000 hommes. On ne m'enlèvera pas de l'idée que Bismarck n'a exécuté cette folie que parce qu'il a aperçu dans son jeu un atout mystérieux qui devait lui donner la voie (je veux parler de Trochu), et il n'a pas triché, car tout le monde pouvait voir cet atout, mais lui seul le vit, dès le 15 septembre. C'est là par contre une faute immense et impardonnable de Gambetta de n'avoir pas deviné Trochu, de ne l'avoir pas renversé avant de partir alors que c'était si facile, car le dernier des généraux eût chassé les Prussiens: il a fallu le génie de Trochu pour contenir Paris, refouler son ardeur et lui infliger la honte d'une capitulation dont l'histoire n'offre aucun exemple, chez aucun peuple, en aucun temps.
[...] Cependant une bonne partie de la population avait enfin deviné le plan à Trochu tout aussi bien que M. de Bismarck, cela prouve en l'honneur de son intelligence et de son courage, car passant de l'idée au fait, elle fit le 31 octobre. Il est vrai que cette partie de la population, c'était le peuple, les radicaux, ceux qu'on devait plus tard appeler communards, mais à ce moment-là tout au moins, ils étaient français et ne demandaient qu'à marcher contre l'ennemi sans arrière-pensée, sous les ordres de qui que ce soit s'engageant à les conduire au feu sans arrière-pensée. Ce jour-là le Gouvernement fut pitoyable: il promit tout: élections et le reste, et le lendemain retira tout: puis usant de ce procédé de l'Empire, prologue de désastres, il fit un plébiscite, après avoir calomnié ceux qui l'avaient deviné, en les traitant de Prussiens, d'ennemis, etc. Mais en obtenant 5.558.000 oui pour 63.000 non (ce qui prouve qu'il y avait à Paris plus de 700.000 hommes), le Gouvernement s'engageait à repousser l'ennemi, c'est là tout ce qu'on lui demandait, et le 31 octobre a eu au moins cet avantage de mettre le Gouvernement au pied du mur.
Ici se place une question: si la Commune eût été nommée le 31 octobre, que serait-il arrivé ? D'après moi, c'est facile de répondre: d'abord il ne pouvait subvenir plus de désastres que Trochu n'en a amené. De plus, c'est le Gouvernement lui-même qui avait autorisé les élections, par conséquent le résultat eût été un résultat de conciliation, -- les maires élus ne pouvant être pires que Ferry, le général en chef qu'on aurait nommé ne pouvait pas ne pas débloquer Paris puisqu'il n'y avait qu'à le vouloir, l'armée l'aurait suivi puisque le peuple la composait pour plus des trois quarts 1/2. Il est vrai que quelques généraux auraient protesté, mais pour ce qu'ils valaient, ce n'eût pas été une grande perte.
Mais le 31 octobre eut un résultat, ce fut de fixer le plan à Trochu. En supposant même que cette émeute fût coupable, un chrétien comme lui devait la pardonner, il fit le contraire, il résolut de s'en venger. Jusqu'alors il comptait sur un armistice. D'une part l'échec de l'armistice, d'autre part le 31 octobre, à partir de ce jour Trochu n'eut plus qu'un objectif: la capitulation. Comment exécuta-t-il ce plan, nous verrons ensuite le pourquoi ?
Il l'exécuta par un semblant d'activité, il employa tout son génie à gagner du temps. D'abord il demanda des volontaires dans la Garde nationale: quand il eut ses listes il n'en fut plus question -- quinze jours après il fit nommer des bataillons de marche, après cela il fallait les équiper, ce qui se fit au fur et à mesure de la confection -- mon bataillon a été équipé le 24 janvier. Pendant qu'à Paris on s'habillait, que l'on flânait sur les remparts par ordre du gouvernement -- ce qui était inepte -- que l'on canonnait dans les forts pour faire du bruit, il fallait occuper l'armée, la mobile, les quelques bataillons de marche équipés, enfin donner de la pâture aux journaux que la population lisait avec avidité: pour cela on faisait quelques attaques pour lesquelles on employait au plus 20.000 hommes dont le quart se battait réellement, on prenait une position, on célébrait la victoire, puis le lendemain on abandonnait la position qui était reconnue inutile. Par exemple le 30 novembre fut le jour du délire: Ducrot avait affiché avant l'attaque: "cette fois ça y est, je ne reculerai pas, j'en fais le serment, je serai mort ou victorieux": or comme il s'agissait de passer la Marne on amena un pont qui se trouva trop court -- ce n'était pas de chance -- toutefois cet incident évita au général d'être mort ou victorieux. Trochu avait trouvé en Ducrot un complice de premier ordre. Mais le plus beau fut le 19 janvier: ce jour-là on avait enfin élevé la Garde nationale à l'honneur d'attaquer l'ennemi. -- Trochu choisit une position, Buzenval, où les Prussiens étaient inexpugnables, seulement il oublia de donner des canons aux gardes nationaux, en sorte que les Prussiens, derrière des murs crénelés en firent proprement une hécatombe: toutefois nos bataillons de marche -- où figuraient Gustave Lambert et Henri Régnault -- y mirent une telle ardeur que Bismarck à Versailles prit peur, fit ses malles et donna des ordres de retraite, se demandant si Trochu l'avait trahi -- ce ne fut qu'une alerte, on se calma, c'était fini.
Reste le pourquoi ? Il est simple: Trochu faisait partie de cette pléiade de bourgeois conservateurs à tous crins pour lesquels le peuple est une bête fauve qui doit être tenue dans une cage comme les lions au jardin des plantes: pour garder cet animal il faut absolument une armée permanente, sans compter les gendarmes, sinon la société est perdue, les bourgeois ne sont plus tranquilles -- Il y a du reste un Gouvernement tout exprès pour avoir l'oeil: si l'animal bouge la consigne est formelle: tirer dessus. Dans l'esprit des classes dirigeantes le peuple ne fait autre chose, comme le prisonnier, que de chercher à ouvrir sa cage pour s'élancer sur la société, mais aussi l'armée a des officiers, des généraux, qui ne font autre chose que de guetter l'animal pour tomber dessus à la première tentative, -- c'est pour cela que la belle loi de 1832, inventée par M. Thiers, le type légendaire du bourgeois ci-dessus spécifié, a imposé sept ans de service aux mauvais numéros, car il faut tout ce temps pour que le militaire n'ait plus rien de commun avec le pékin. C'est une armée ainsi composée qui, après avoir fait merveille sur le boulevard Montmartre le 2 décembre se comporta à Sedan comme des moutons sous la grêle.
On a dit: c'est vrai, avoir déclaré la guerre le 15 juillet 1870, ce fut peut-être une faute, mais si on eût été vainqueur, quelle belle page ! l'Empire était fondé pour l'éternité ! De même, si le peuple de Paris eût battu les Prussiens, fait lever le siège et, donnant la main à Gambetta eût noyé l'ennemi dans le Rhin, quelle belle page ! la République était fondée pour l'éternité !... Oui, c'est beau à dire, mais dans ce cas, la société, que fût-elle devenue... et les bourgeois, y pensez-vous ? Allez-vous tenir un tel langage après avoir vu les Communards mettre tout à feu et à sang ? Mais si l'armée était sortie de Paris pendant le siège, la Garde Nationale pendant ce temps eût pillé et incendié la capitale (textuel, langage tenu en ma présence par des officiers à un mess, au fort de Bicêtre en 1872, auquel mess assistaient les maîtresses de ces messieurs).
Cela faillit arriver au 31 octobre, heureusement Trochu veillait et, aidé de ce bon Gouvernement de la Défaillance nationale qui n'y vit que du feu, aidé surtout de ces magnanimes et héroïques amis, Clément Thomas, Ducrot, Vinoy, de Bellemarre et consorts, il sut contenir le peuple de Paris et ainsi il sauva la société de la France... Aussi, quand, les 13, 14 et 15 juin 1871 Trochu, qui était un orateur de premier ordre, fit à la Chambre un discours de trois jours sur sa propre apologie, il eut un succès prodigieux. M. Thiers lui offrit le bâton de Maréchal de France qu'il eut la modestie de refuser. Ces gens-là s'entendaient comme larrons en foire. Voilà où nous en étions en 1871... En résumé, Trochu n'a pas trahi, il a été de bonne foi. Par sa valeur il a soutenu le siège presque sans armée et par son prestige il a sauvé Paris de la Commune. Tout ce qu'on pourrait lui reprocher serait de ne pas porter le peuple dans son coeur mais que celui qui a vu de près la démagogie lui jette la première pierre.
Pour tout dire, un si beau résultat a bien coûté quelque chose: sans parler des milliards dépensés en pure perte, les 2 millions et demi de Parisiens ou réfugiés qui ont crevé de faim de si belle façon qu'il y avait 5.000 décès par semaine, que tous les enfants conçus ou nés pendant le siège sont morts pendant ou après, les rares survivants n'en valent guère mieux: il est vrai que ces calamités n'ont atteint que le peuple, par conséquent ça a été une purge sociale excellente pour la bourgeoisie à venir...
Nous voici arrivés à l'un des événements les plus extraordinaires et les plus tragiques de l'histoire... Si M. Trochu avait une telle opinion sur le peuple armé qu'il préférait de bonne foi imposer à une population de 2 millions et demi d'âmes cinq mois de misère, de faim et de souffrances inouïes, à Paris et à la France la honte d'une capitulation sans précédent, qui entraînait de soi la fin de la guerre au prix de deux provinces, de cinq milliards, etc. tout cela plutôt que de devoir le salut et la victoire à la garde nationale: si Trochu pensait ainsi, il n'était pas le seul, presque tous les officiers de l'armée et bien d'autres pensaient de même, particulièrement l'homme qui avait alors entre les mains un pouvoir absolu, M. Thiers.
Depuis un mois et demi, la vie de paris était anormale. La capitulation y avait causé une stupeur d'un caractère indéfinissable, il y avait de tout, de la honte, de la stupéfaction, une colère concentrée, chacun se sentait coupable de s'être laissé jouer par la bande Trochu et Cie, d'avoir fait le jeu de la sinistre comédie de ces hommes qu'il était si facile de renverser: comme alors on devait regretter de n'avoir pas secondé le 31 octobre qui les avait mis à terre: et maintenant qu'allait-on devenir ? À cette question, personne ne pouvait répondre. Le Gouvernement était absent et semblait ne pas exister: pour la première fois on sentait le bien-être résultant de cette absence. On n'avait jamais été aussi tranquille et, ma foi, quoiqu'il y avait dans l'air une vague préoccupation, on ne pensait à rien, on était abasourdi. La Garde Nationale continuait à être payée, on ne payait pas de loyer et on vivait avec ses trente sous. Pendant ce temps, comme Paris avait été mis en quarantaine et que le gouvernement semblait l'avoir oublié, il s'était établi un Comité Central inconnu, n'ayant ni considération, ni autorité, ni pouvoir: mais on comprendra qu'après avoir été joué par Trochu de si belle façon quelques hommes aient cherché à se garantir contre tout événement: ce Comité d'ailleurs était fort inoffensif et ne faisait rien que de se réunir et de pérorer.
Pendant le siège, le patriotisme, disait-on, exigeait de faire le mort de peur de déranger les fils du fameux plan, ainsi on s'était habitué à l'inertie, à tout attendre du Gouvernement. Il en fut de même après le coup de massue de la capitulation, on continua à faire les pantins comme auparavant et à attendre les ordres de Bordeaux et bientôt de Versailles. Il vint cependant à Paris un obus précurseur, la nomination d'un certain Valentin (je crois), général de gendarmerie, au commandement supérieur de la Garde nationale, -- c'était une provocation.
Mais si le Gouvernement paraissait dormir, en réalité il s'y trouvait un homme qui ne dormait pas et qui se demandait ce qu'il devait faire de Paris et de ses 250.000 hommes armés. Il était convaincu qu'il était impossible de vivre avec eux. Pensez donc: M. Thiers avait fait sa loi de 1832 pour contenir le peuple et voilà que maintenant il se trouvait en présence de ce peuple qui était son cauchemar, armé jusqu'aux dents, -- c'était l'abîme, forcément la société entière allait s'engloutir dans une anarchie à faire frémir, donc il fallait trouver le salut.
M. Thiers réfléchit, traça son plan dans l'ombre de la nuit et ne souffla mot à personne. S'il eût été plus franc il aurait dit à la Chambre, le 15 mars 1871: "Messieurs, la société va sauter si nous gardons les 250.000 parisiens armés, donc décrétons leur désarmement dans la huitaine" (comme il le fit six mois plus tard), il aurait eu le vote, mais l'exécution eût sans doute été scabreuse, en tout cas on pouvait s'entendre: Paris avait assez prouvé pendant le siège qu'il était de bonne composition: en le prenant par les sentiments, la majorité eût consenti, et le reste, ne pouvant rien, eût remis canons et fusils pourvu qu'on lui conservât les trente sous. La preuve, c'est que vers le 10 mars, le Gouvernement fit demander à Clemenceau s'il se chargeait de faire rendre les canons de la garde nationale, celui-ci répondit "oui", dès qu'on le laisserait faire.
Mais M. Thiers avait une vieille recette: en février 1848, il avait proposé au Maréchal Bugeaud de sortir de paris avec l'armée, de la doubler ensuite et de rentrer à Paris avec 100 ou 150.000 hommes, de la sorte il aurait sur le peuple une victoire certaine et ainsi il eût sauvé la monarchie. Mais le conseil ne fut pas suivi, aussi Bugeaud fut battu. -- Thiers l'avait bien dit. -- Ah ! si alors il avait eu la dictature... Mais vous voyez ce que c'est que la destinée: vingt-trois ans plus tard, il se trouve qu'il est le maître souverain, avec une recette rentrée qui lui était restée sur le coeur: vous pensez bien qu'il ne pouvait manquer d'appliquer son procédé souverain dans une si belle circonstance.
En politique, il existe ce principe qu'il faut toujours donner tort à ses adversaires, c'est ce que fit Napoléon pour l'Espagne en 1807 et pour la Russie en 1812. Quand le taureau ne veut pas se battre, les picadors se chargent de l'affaire, et dans ce cas c'est le taureau qui a tort, bien entendu, sauf s'il était vainqueur, mais pour que le cas ne se produise pas, c'est tout simple, il suffit de décupler le nombre des toréadors.
Oui, mais enfin c'est une grosse affaire: faire sortir l'armée de Paris avec tout ce qui tient au Gouvernement, les bourgeois et foireux, suivant comme les moutons de Panurge, ce sera Paris livré au peuple qui n'a pas les moyens de s'en aller. -- Mais si le peuple se tient tranquille, comme le taureau ? -- bah ! on décuplera les picadors -- Mais alors si à ce traitement il devient furieux et qu'un petit nombre indigné, exaspéré, mette tout à feu et à sang ? -- Précisément, je vous le disais bien, le peuple lâché ne peut que dévorer la société, nous serons bien aise de la démonstration: mais rassurez-vous, quand elle sera faite nous arriverons avec 200.000 soldats ayant sept ans de service, auxquels on fera la leçon en conséquence, et alors nous tomberons sur ce peuple, nous en tuerons un si grand nombre que la Société sera sauvée et Paris délivré... Un tel plan inspirerait quelques scrupules à des simples comme vous et moi, mais à M. Thiers le Transnonain jamais de la vie [...].
Le 17 mars 1871, M. Thiers dit au général de gendarmerie Lecomte: "La majeure partie des canons de la Garde nationale est à Montmartre, vous irez pour les prendre demain matin avec quelques troupes, seulement vous aurez soin d'oublier les chevaux pour que vous ne puissiez pas les emporter. Les canons ne sont pas gardés, cependant il faut bien espérer que vous y trouverez deux ou trois gardes nationaux, ceux-là vous les fusillerez à bout portant, puis vous attendrez avec vos hommes, fusils chargés. Pendant ce temps, l'éveil sera donné, la garde nationale battra la générale: il en viendra un certain nombre qui, outrés du procédé en tapinois, de ce guet-apens de flibustier, voudra s'opposer à la prise des canons, alors vous tirerez dans le tas, puis vous battrez en retraite".
Ce fut ponctuellement exécuté, sauf la fin: quand les gardes nationaux rassemblés, apprenant la tentative de la prise des canons furent en présence des troupes, il souffla dans la masse des deux camps comme un vent d'hilarité générale, alors les parisiens crièrent aux troupes "crosse en l'air", ce qu'elles firent de la meilleure grâce du monde, après quoi elles déguerpirent selon l'ordre préalable qu'elles en avaient reçu.
[...] Toutefois vers le soir il y eut une ombre dans ce beau ciel, on apprit le fusillement des généraux Clément Thomas et Lecomte après jugement. Cela jeta un froid, -- c'était dommage -- sans quoi la journée eût été si heureuse... Mais que voulez-vous, il y aura toujours des faits particuliers. Le 14 juillet 1789 a aussi été un beau jour, néanmoins il y a eu des crimes commis, ce qui n'empêche pas cette date d'avoir été choisie récemment pour la fête nationale française. Pour tout dire, les deux victimes n'étaient guère sympathiques: Clément Thomas avait été le complice de Trochu, s'était moqué pendant cinq mois de la garde nationale, et ils auraient dû l'un et l'autre passer le 28 janvier en Cour martiale pour crime de haute trahison, mais enfin le 18 mars, les hommes de Montmartre n'avaient pas le droit de justice, c'est donc un crime condamnable. Quant à Lecomte qui avait ensuite (ceci tout au moins est certain) commandé à ses hommes de tirer quand ceux-ci ont mis crosse en l'air, on ne saurait beaucoup s'apitoyer sur son sort, mais la peine du talion est défendue, les hommes de Montmartre n'avaient pas le droit de justice, c'est donc un crime condamnable.
Si Thiers eût vraiment voulu les canons, que la garde nationale ne gardait pas, auxquels elle ne tenait pas, dont elle était embarrassée, il lui était facile de les prendre: si Lecomte avait amené des chevaux, il eût emmené les canons. Du reste ce procédé était inqualifiable: les canons appartenaient à la garde nationale qui les avait payés par souscription, alors il convenait au moins de les lui demander et on les aurait donnés. Quand même j'aurais une chose à vous, autant je vous la rendrais de bonne grâce si vous me la réclamiez, autant je me révolterais si vous veniez à l'improviste me coucher en joue pour me la prendre dans ma poche. Clemenceau avait promis de se charger de livrer les canons au gouvernement, mais Thiers ne voulait qu'un prétexte pour retirer l'armée de Paris.
Jamais en aucun temps politique le mensonge appliqué à certains mots n'a joué un si grand rôle et jamais homme n'a su aussi bien que Thiers en tirer parti. Je n'en veux pour preuve que cette simple périphrase qui restera dans l'histoire encore quelque temps: "insurrection du 18 mars." -- Généralement pour qu'il y ait insurrection il faut s'insurger contre quelqu'un, contre un ordre, contre quelque chose: or le 18 mars, il y a eu le matin une petite comédie muette dans un petit coin de Paris, à midi il y a une promenade militaire de presque toute l'armée prenant le chemin des écoliers pour s'en aller à Versailles et faisant ce parcours la crosse en l'air, histoire de s'amuser, car la troupe n'avait reçu aucun ordre que de se promener: la garde nationale n'était pas sur pied: même ajoutez-y les deux crimes de la soirée commis par une dizaine d'individus, où voyez-vous là matière à insurrection ?... Ce mot appliqué au 18 mars m'a toujours fait rêver. Si le gouvernement avait donné un seul ordre il eût été obéi. -- J'ai dit ci-dessus qu'alors Paris était abasourdi, dans l'inertie, dans l'attente d'une décision, d'un ordre à son sujet qui ne venait jamais. -- Mais jamais à aucun moment de l'histoire Paris n'a moins eu envie de s'insurger que le 18 mars -- Je défie qui que ce soit de prouver que Paris pouvait ce jour-là autre chose que ce qu'il a fait, car enfin Montmartre n'est pas Paris: si Montmartre a eu tort de ne pas remplacer les chevaux oubliés par M. Lecomte, Paris n'est pas en cause: la population parisienne n'a fait qu'une chose c'est de voir défiler les troupes quittant Paris sur l'ordre de Thiers et au moment où la plus grande fraternité régnait entre l'armée et le peuple, au moment où celui-ci ne demandait qu'à être gouverné et obéir au gouvernement.
Ce qui m'amuse toujours c'est la quantité de gens et même d'historiens qui recherchent et discutent gravement les causes de l'insurrection du 18 mars, et alors ils trouvent le ressentiment de la capitulation, du vote de Bordeaux de ne pas rentrer à Paris, etc., mais Messieurs, il n'y a pas de cause où il n'y a pas eu d'effet: Paris n'a absolument rien fait ce jour-là, l'insurrection du 18 mars est un mythe, une légende inventée par Thiers pour l'exécution de son idée de faire sortir l'armée de Paris dans le but ci-après. Donc la cause du 18 mars, c'est la volonté de Thiers -- qui a prévu, conçu, exécuté la comédie à l'issue de laquelle l'armée a franc-filé ? c'est Thiers --. Qui a été l'unique cause des désastres qui ont suivi le 18 mars ? C'est Thiers. Pour moi qui était sur les lieux c'est clair comme le jour.
En somme son plan a admirablement réussi: il lui fallait un prétexte pour quitter Paris, il a eu les canons auxquels les gardes nationaux n'ont pas eu l'initiative de s'atteler, il a eu les crosses en l'air auxquelles les officiers se sont si bien prêtés que c'est à croire qu'ils en ont donné l'ordre par dessous main, enfin il a eu, pour comble de bonheur -- il y comptait bien -- deux crimes magnifiques, deux généraux fusillés, quelle aubaine ! comment après cela laisser dans Paris des troupes qui oublient leur raison d'être, leur premier devoir qui est de tirer sur le peuple. Évidemment il fallait les retirer de cet air méphitique, et en cela Thiers a sauvé la France, mais de grâce laissez lui tout le mérite et dites avec moi que la cause du 18 mars et des malheurs qui suivirent, c'est M. Thiers [...]"
"Le quatre septembre devant l'enquête"
On sait qu'une enquête parlementaire fut décidée, pour juger les actes du gouvernement qui s'installa après le 4 septembre, déclarant l'Empire déchu, et proclamant que la guerre continuait, pour le compte de la nation française, cette fois. La commission, dirigée par le comte Daru, suspecta que ce gouvernement avait usurpé le pouvoir. Eugène Pelletan, qui fut membre du Gouvernement de défense nationale après le 4 septembre 1870, a laissé un petit ouvrage assez étonnant, pour disculper ce gouvernement. Il pose la question: pourquoi a-t-on constitué ce gouvernement, si ce n'est pour assouvir des ambitions ? C'est pour rétorquer aussitôt: "Mais le pouvoir n'était à ce moment qu'un baril de poudre à côté d'une fournaise !" Alors, à défaut de tomber sous l'accusation d'avoir installé au pouvoir les républicains les plus radicaux, ce gouvernement a-t-il "pactisé avec la faction de la Commune" ? A-t-il été traîné au collet par "la secte hébertiste" ? Non pas: les "sectaires de la Commune", écrit Pelletan, étaient profondément hostiles aux hommes "relativement modérés" qui formaient ce gouvernement. D'ailleurs, c'est ainsi que les nomme le rapport de la commission d'enquête. Jamais, écrit-t-il, il n'y eut de collusion entre les deux partis. Bien, nous voilà fixés, croyons-nous, sur le Gouvernement de Défense nationale: il s'est fondé sur l'insurrection, mais une insurrection légitime, puisqu'elle renversait un tyran qui, pour mettre le comble à ses crimes, allait perdre la patrie. Puis, il a résisté aux factieux qui voulaient la Commune. Alors, l'insurrection initiale, contre l'Empire, est légitime ? Pelletan le laisse penser, quand il oppose deux formes de la violence politique: celle de l'Ordre, celle de l'Insurrection. Pour se faire mieux comprendre, Il use, par métaphore, du précédent qu'a constitué la féroce répression exercée en 1848 contre sa capitale le roi de Naples, le "roi Bomba", comme l'appelait Marx. Les libéraux du royaume avaient demandé au roi une constitution. Ce monarque fit mine de l'accorder, ensuite la dénonça, puis châtia les coupables de son propre coup d'État. Pour le lecteur d'aujourd'hui, Bomba, c'est à première lecture Monsieur Thiers, les massacres de Palerme en 1848, croit-on lire, c'est la répression de mai 1871 à Paris.
C'est, du fond de son cabinet et en robe de chambre, qu'il lâche son armée et qu'il sème le meurtre sur sa capitale: à l'heure où le sang coule, il fume un cigare ou il prend une glace et respire délicieusement, au bruit de la canonnade, la brise méditerranéenne chargée d'un parfum de citronnier. Et pendant ce temps-là, par ses ordres, au coin des rues ou dans les cours de prison, on exécute, par masse et en tas, les prisonniers, notés hommes dangereux parce qu'ils croient au droit et qu'ils aiment la liberté. Quand l'émeute de la rue procède de cette façon, et fusille sans jugement, c'est assassiner: le parti conservateur en jette un cri d'imprécation à fendre le granit. Et en effet, c'est pour lui le crime des crimes, le crime, en débraillé, exécuté par les bras nus, les mains noires, par une foule la plupart du temps déguenillée.
Mais lorsque l'insurrection dorée d'un coup d'État assassine, elle assassine proprement, méthodiquement, en uniforme brodé et d'une main gantée. C'est le meurtre comme il faut, le crime gentilhomme, le crime musqué et pommadé, et le parti conservateur sent pour lui une inépuisable indulgence, parce que le massacre respire le bon ton, et après tout, qui a-t-on fusillé ? Un plébéien ou tout au plus un bourgeois. Ce sang-là mérite-t-il tant d'intérêt ?
[...] La liberté, prétend (le despote), dégénère en licence et la licence en anarchie, mais moi pouvoir incontesté, assis sur l'affût d'un canon, le seul vrai trône aujourd'hui, je protège la tranquillité et la tranquillité suffit à une nation. Ordre public, salut de la société, puisque le malheur des temps pose de nouveau la question entre nous et nos adversaires, nous demandons la permission de redire ce que nous avons déjà dit ailleurs.
À supposer que la liberté dégénère nécessairement en licence, que vaudrait-il mieux avoir à subir de l'agitation populaire ou de la silencieuse immobilité du despotisme ? l'émeute sans doute a la mine inquiétante, elle crie, elle hurle, elle défonce, elle renverse, et par le tapage comme par le désordre de sa mise en scène, elle porte aux nerfs et révolte tous les sens à la fois: c'est plus qu'un trouble d'un moment, c'est un manque d'égards: on pardonne un coup de main en habit galonné comme on vient de le voir, mais une descente en blouse sur la place publique a quelque chose de grossier qui choque la délicatesse.
Quel mal cependant l'émeute, qui n'est après que le despotisme du trottoir, peut-elle faire à une nation ? Le mal purement matériel d'une rue dépavée, peut-être même incendiée, d'une statue brisée, d'une grille abattue, mais elle n'a que la durée d'un accès de fureur, elle frappe et elle passe... parce qu'il est dans sa nature de passer comme du torrent de couler.
On comprend soudain: Pelletan oppose le torrent vivifiant de l'insurrection, qui ne détruit que des objets réparables ou remplaçables, et qui n'est que la forme extrême de l'action politique, dès lors qu'elle vise à remettre le pouvoir à ses récipiendaires légitimes, au despotisme. Qu'est-ce que le despotisme ? C'est une forme de pouvoir, un pouvoir qui s'établit pour ne plus céder la place, et qui s'attaque en profondeur à l'âme. Il tue la société à la tête et au coeur, écrit Pelletan. Bien sûr, nous le voyons maintenant, il désigne l'Empire de Louis Bonaparte. On comprend alors que ce despote, figuré par le roi Bomba, ce n'est pas Monsieur Thiers: celui-ci est innocent du drame despotique, l'usurpation, qui a précédé le 4 septembre.
Et le patient meurt longuement, en douceur, et il ignore qu'il meurt: il trouve même à sa mort une volupté secrète comme à l'ivresse de l'opium [...]. Et vous qui traverserez plus tard un désert, passez: il y avait là un peuple, ne prenez pas la peine de vous baisser pour lire son épitaphe, passez vous dis-je, un peuple qui a consenti à mourir de cette mort, ne mérite pas qu'on cherche son nom sous l'herbe.
On songe évidemment à Tocqueville, pour qui les temps démocratiques sont nécessairement agités, et dont l'agitation témoigne, de la vitalité de la tête et du coeur. Le 4 septembre, voilà le sursaut salutaire qui a réveillé les âmes, arrêté la chute de ce peuple. Mais la Commune ?
L'émeute, dit Pelletan, n'a aucune chance: car elle s'attaque au pouvoir. Elle a, contre elle, toute la force organisée d'un gouvernement: une bande ne saurait avoir raison d'une armée. L'émeutier n'échappe à la mort que pour tomber sous la main de la justice. Qu'est-ce à dire ? Que l'émeute est nécessaire pour secouer le joug de la tyrannie: si elle persiste contre la démocratie rétablie, elle devient coupable. Les guenilles ne sont honorables que contre le tyran. Bel aveu. Alors, voici ce qu'écrit Pelletan à propos du Gouvernement de Défense nationale:
L'émeute arrive, il lui tire le chapeau: l'émeute disparaît, il lui envoie des fusils pour qu'elle revienne avec plus de chances de succès. Il sait qu'il en sera la première victime, mais il a une soif inextinguible de martyre: le danger augmente, la lutte approche: l'insurrection a la complaisance de lui signifier par ses journaux, par ses menées, par ses plénipotentiaires, la reprise des hostilités et il croise ses bras ou il met la tête sur l'oreiller et il dort: il dort au 31 octobre, il dort au 8 novembre, il dort au 22 janvier, et quand la fusillade le réveille en sursaut, il n'ouvre l'oeil que pour retomber dans le sommeil.
Quelle belle ironie, contre l'Enquête parlementaire, qui juge le gouvernement de Défense nationale responsable du désastre de la guerre civile ! Bien sûr, le gouvernement de Défense nationale n'a pas agi de cette façon imbécile. Mais il ne pouvait mener la guerre et sauver la France. Pelletan juge que Monsieur Thiers a sauvé la France à force de courage, de patriotisme, de bon sens. Il a sauvé la France du communisme. Ce que le gouvernement de Défense nationale ne pouvait faire, Thiers l'a fait:
En aurions-nous fini avec la Commune elle-même, mais ce sang aurait crié contre nous et de chaque goutte serait né un communiste de plus.
Ce que les Républicains ne pouvaient faire, Monsieur Thiers l'a fait. Il a obligé la Commune à rendre Paris à la France ! Mais alors, Monsieur Thiers serait le héros de la République, qui fut évincé par ceux du parti de l'Ordre, ceux qui voulaient un nouveau despote ? En 1874, Eugène Pelletan ne voyait plus, déjà, en Monsieur Thiers, qu'un libérateur. Jeanne d'Arc fut bien abandonnée par le peuple qu'elle avait délivré. Le débat n'est donc finalement pour lui, qu'entre la république qu'incarne Monsieur Thiers, et le despotisme nouveau que représente le maréchal Mac Mahon ? Mais alors, de quelle insurrection parlait-il ?
C'est pourtant simple: le gouvernement de Défense nationale a été continué par Monsieur Thiers, devenu par l'effet de la Providence, le plus grand des républicains. La Commune, impensable le 17 mars 1871, c'est l'Enquête parlementaire qui le dit, n'a été qu'une parenthèse malheureuse, l'effet d'une circonstance imprévisible: on n'avait pas désarmé la Garde nationale, des émeutiers ont voulu dérober le pouvoir à la République à peine renaissante. L'armée était contaminée, les Prussiens seuls auraient pu désarmer l'émeute. Mais aussi, quel déshonneur, si on l'eût laissé faire ! Voilà, la nation, par le bon sens de Monsieur Thiers, renaît de ses cendres, sous réserve de République, bien sûr.
Quelle étrange période ! Voilà ce qu'ont compris ces gens-là. Et voient-ils, comme Pelletan, que "les sociétés sont naturellement pondérées": que, pour "avoir la réalité de tous les besoins, de tous les intérêts, pesés à leur véritable poids et à leur véritable influence", il suffit du suffrage universel ? Le temps des révolutions est passé, la Commune fut anachronique. Les hommes de la République n'ont plus, comme au temps des ténèbres, à soulever les foules déguenillées. Le temps est venu de l'opinion publique éclairée par l'instruction, la presse libre. Elle est l'unique représentation, véritable, de la nation. Elle est plus encore, elle est la justice 189. On dirait du Proudhon.
Avant de conclure, je voudrais laisser s'exprimer un homme qui se trompa. Il l'avoua, avant de défendre âprement ceux-là, à qui il avait d'abord fait tant de mal, par mépris de lui-même. C'est d'Octave Mirbeau qu'il s'agit, qui, après avoir barbouillé les stupidités pour lesquelles une presse ignoble le payait, était devenu l'auteur du Journal d'une femme de chambre et défenseur de Dreyfus. Il écrivit un article, le 10 juin 1894, dans Le Journal. J'en donne l'essentiel.
Je pense qu'on a été, dans la Presse, très injuste envers M. de Galliffet. Et cela m'encourage à le défendre.
Je n'aime pas beaucoup ce général, même quand sa brillante épée se double de la plume brillante de M. Joseph Reinach. À lui tout seul, il suffirait à justifier tout ce que M. Hamon a écrit de peu flatteur et de très effrayant sur la profession militaire. On ne peut pas, non plus, oublier le rôle sanglant qu'il joua dans la répression de la Commune. Son sabre fut rouge, à lui aussi, car il tua beaucoup. Il tua tout ce qui lui tombait sous la main. Sa dextérité dans l'égorgement, son brio dans le massacre furent merveilleux et demeurent proverbiaux. Depuis, pas un général ne les dépassa et même ne les atteignit. Écoutez n'importe quel officier parler de M. de Galliffet. Avec enthousiasme, il vous dira que nul ne sut, comme lui, communiquer à ses troupes ce que les honnêtes gens appellent le diable au corps. En cette bienheureuse époque de la guerre civile où Paris se transforma en un véritable et horrible charnier, l'armée de Galliffet, grâce à son chef, poussa l'héroïsme et la pratique des vertus militaires jusqu'à se faire le bourreau de toute une ville. Dans certains quartiers, on montre encore des places commémoratives, qui restèrent longtemps poisseuses de tout le sang qui y fut versé. Deux mois après, malgré les lavages, rapporte un historien, cela collait encore aux pieds. [...] Cela n'empêche pas que M. de Galliffet n'ait proclamé une vérité, lorsqu'il confiait à MM. Charles Morice et Henri Varzuel, son impuissance totale à conduire deux cent cinquante mille hommes à la bataille. [...]
La Révolution française, l'insurrection des fédérés de 1871 et le "prolétariat révolutionnaire"
Est-il bien utile de procéder à une étude comparative de deux événements qui, même au plan idéal typique, ont si peu d'éléments en commun ? Tout dépend de ce qu'on veut comparer, et avec quelle liberté d'esprit. Il faudrait tout comparer: les situations sociales et politiques, l'état de bien-être ou de mécontentement au plan "économique", la "frustration relative". Il faudrait s'assurer que ces facteurs sont aussi déterminants à deux époques si éloignées. Il faudrait savoir si, par bien-être, on entend la possibilité de survivre, ou l'insatisfaction dans une perspective de changement social. Il faudrait tenir compte aussi de l'effet de répétition, qui, nécessairement porte en soi l'illusion du même, interrompu, et recommencé. Delescluze n'espérait-il pas refaire 93 ? Il n'était pas le seul à vouloir réécrire l'histoire. D'autres voulaient venger, ou refaire, en évitant les "erreurs" du passé, juin 1848, et, on le sait, les "vieilles barbes de 48" ne manquèrent pas à cette Commune. Le sentiment patriotique a joué dans les deux cas. Il a joué différemment: en 1792, l'enthousiasme révolutionnaire était porté par un idéal universaliste, le désir de débarrasser les autres peuples de leurs tyrans et de leurs superstitions. Car le sentiment patriotique signifiait, alors, le sentiment de fraternité entre les peuples libres. Il est vrai que la guerre servit aux bellicistes, tel Danton, y compris pour détourner les énergies qui pouvaient l'arrêter dans la conquête du pouvoir, et les enquêtes sur l'honnêteté de ses comptes.
En 1871, c'est tout autre. Un climat de défaite, d'humiliation nationale, que les partis se rejettent mutuellement au visage. Le défaitisme bourgeois et rural de 1871 n'eût pas pu s'exprimer ainsi en 93, parce que bourgeois et ruraux étaient sur la défensive. L'impulsion, qui avait changé d'origine, était, dans son essence, si différente qu'elle ne pouvait aboutir au même unanimisme. Il était deux partis en présence: les ruraux et les républicains. Les seconds voulurent poursuivre la guerre contre le Prussien, parce qu'ainsi, ils rompaient avec plus d'un demi-siècle de bassesse dans le "concert des nations". Ils ranimaient la flamme patriotique. Oui: les fédérés, les insurgés des villes industrielles, Lyon, Marseille, Toulouse, le Creusot, etc., étaient voués au silence et aux procès de mutinerie, mis au ban de la nation, lorsqu'ils prétendaient rompre le pacte de progrès, qui les liait aux partis "avancés", dès qu'ils dénonçaient l'exploitation dont ils étaient victime, bien avant que l'Assemblée de Bordeaux penche pour la capitulation.
Dira-t-on que ce qui a manqué en 1871, ce furent Danton, Saint-Just, Robespierre, Gracchus Babeuf ? Mais ceux-là ont été écrasés par les vrais vainqueurs de la Glorieuse Révolution française: les acquéreurs de biens nationaux, les gens qui constituèrent la "classe politique" et qu'on retrouva sous toutes sortes de régimes. Lors du soulèvement de la fédération de la garde nationale en 1871, n'avait-on pas Theisz, Frankel, Varlin pour diriger le mouvement ouvrier ? N'avait-on pas Duval et Brunel pour généraux insurgés ? Dira-t-on que les premiers furent trop modestes, intimidés par le pouvoir, incapables de le saisir, tandis que leurs aînés de 93, ou de 96, pour Babeuf, avaient franchi le pas décisif. Duval et Brunel ne valaient-ils pas autant que Kléber, Marceau ou Hoche ?
C'est vivre sur une illusion. On nous l'a assez répété: le "peuple" français de 1793 n'était pas composé pour l'essentiel de révolutionnaires ardents, même s'il s'en trouva suffisamment pour soutenir les dirigeants les plus radicaux. Encore ceux-ci aspirèrent-ils au pouvoir, sauf Babeuf, si l'on m'en croit. Robespierre voulut-il, aussi bien que Cromwell, à qui on le compara, devenir roi ? Là, me semble-t-il, n'est pas la question. Il voulut fonder une République, même si, et Babeuf le lui reprocha, il ne sut résister à la tentation d'usurper la souveraineté. À Paris, en 1871, la question était l'évanouissement du pouvoir: la place enfin laissée vacante, du moins pour ceux qui ne voulaient pas de Monsieur Thiers, Jules Favre et consorts. Aussi, comme le dit Tocqueville 193, la question était celle des travailleurs devenant des affranchis, mais qui s'étaient affranchis par eux-mêmes, au prix d'un dur labeur: le siège, les privations, les combats inutiles. Ils possédaient un lieu, et combien symbolique, où leurs maîtres n'avaient pas de place. Ils étaient armés, organisés, payés par l'État (ou la Commune). Ces gens-là ne voulaient pas leurs trente sous, pour survivre à force de travail servile. Ces trente sous, c'était le prix, alors, qu'il fallait dépenser pour être citoyens libres. Or les affranchis, l'histoire le montre, constituent un facteur de décomposition de toute société hiérarchique. Ils refusent le travail, qu'ils assimilent à la servitude, comme l'écrit d'ailleurs Tocqueville. La prospérité des nantis s'en trouve atteinte, si ces affranchis ne peuvent être employés au même titre que le commun, car une fois affranchis par eux-mêmes, pourquoi s'abaisser, et contribuer à faire travailler les autres ?
Le splendide isolement des fédérés parisiens n'augurait rien de bon, quant à leur bonne volonté. C'est tout l'univers du travail salarié, ce monde du silence contraint imposé aux "apporteurs de travail", qui se trouvait menacé, et s'ils ne purent communiquer avec ceux de Marseille, de Lyon, de Toulouse, du Creusot, etc., il existait un risque immense qu'ils finissent par le faire. Tel fut le crime de ces assassins, qui ne tuèrent personne, ou presque, qui ne détruisirent rien avec intention, sinon la Colonne Vendôme et la maison de Monsieur Thiers. Et même s'ils ont incendié les monuments emblématiques du pouvoir, ce n'était que de la pierre. Ces pierres empilées ne constituaient pas leur patrimoine. Les Tuileries, la Bourse, et même le Louvre ne leur avaient jamais appartenu. Tandis que les obus versaillais ravageaient les quartiers, incendiaient les maisons, tuaient aveuglément, avant que ne commencent les massacres organisés au nom du rétablissement de la légalité et de la paix civile.
Si la Commune est le plus souvent réduite à son Assemblée, qui ne prit que des mesures de circonstance, qu'encore elle ne parvint pas, en général à faire appliquer, l'erreur est de croire que la révolte des Parisiens, en 1871 peut être représentée par cet aréopage bruyant, brouillon, tatillon, jaloux, versatile. Les membres de la Commune furent pour une grande part des phraseurs, comme il s'en rencontre partout. Pour leur malheur, ils se trouvèrent devant la guerre la plus impitoyable, et ne voulurent pas y croire. Il se trouva quelques hommes d'action, et mieux, quelques hommes réfléchis et courageux, qui savaient ce dont ils ne voulaient plus, à quoi ils préféraient ne pas survivre. Ces hommes-là, et je devrais dire aussi ces femmes-là, étaient comme des égarés, dans une cohue de rivalités personnelles, d'ambitieux soudain à même de jouer leur rôle, de poltrons, d'uniformes et de grades honorifiques, de commissions, de sous-commissions qui n'étudiaient rien, ne prenaient pas de décisions, se disputaient la préséance comme ils se disputaient les canons. Ceux-là: Varlin, Theisz, Frankel, Malon, Brunel, Duval: celles-là: Louise Michel, Paule Mink, et combien d'autres dont l'histoire n'a pas retenu le nom: ceux et celles qui se battirent, non pour une assemblée de bavards: non comme l'armée "progressiste" opposée à l'armée "rurale", mais comme libres humains: ceux-là et celles-là ne furent représentés par personne.
La métaphore, parfois même l'analyse, ont été fréquemment employées pour rendre compte de deux "fractions de classes", qui se seraient disputé le pouvoir au cours du temps. Ce fut vrai, lorsque Cobden, en Angleterre, réunit une Ligue pour l'abolition de la protection des grains britanniques. Les Landlords voyaient leurs intérêts directement opposés à ceux des entrepreneurs capitalistes, manufacturiers, négociants ou banquiers. Ceux-là souhaitaient le libre-échange pour assurer l'expansion capitaliste. Encore faut-il préciser que, parmi les Landlords, un grand nombre étaient eux-mêmes intéressés à cette expansion, ne serait-ce que parce que les voies de communications, routes ou canaux leur appartenaient, mais surtout parce qu'eux-mêmes avaient investi dans les sociétés de capitaux. Lorsqu'on se donne à tâche d'expliquer pourquoi la Commune vaincue fut une assemblée de bavards, et Versailles, où siégeaient des nullités commandant des incapables, le camp des vainqueurs, l'explication ne vaut plus. Toutes les "fractions de classes" qui se disputaient le pouvoir étaient du côté de Versailles. La suite des événements le démontre assez. Thiers, ce héros au sourire si doux, fut remercié. Mac Mahon, ce magnanime vainqueur, lui fut préféré, en attendant Henri. Plus tard, après que les clans monarchistes se furent suffisamment expliqué, vint l'heure des radicaux, et ceux qui étaient sortis par les fenêtres rentrèrent par la porte, comme Jules Ferry. Non, ce qui était en question, ce n'était pas le pouvoir politique mais quelque chose de beaucoup plus profond. La "société" française du XIXe siècle a vécu une peur étonnante, celles qu'éprouvent les propriétaires, grands ou petits, à la ville ou à la campagne, à l'idée que "le Travail" va leur voler leur propriété. Ce vol ne résulterait pas seulement de l'impôt progressif, ni même des lois sur les droits sociaux. La césure était profonde, comme le fossé de Romulus, que son frère, sous peine de mort, ne devait pas franchir. La charité publique ne profite à personne, car les contribuables anonymes ne font le "bien" qu'en dépit d'eux-mêmes, tandis que la classe évergétique jouit de ses propres bienfaits. Qu'on l'accepte ou pas, Tocqueville avait vu juste: une nouvelle aristocratie, qui ne serait pas une classe, qui ne s'emparerait pas du pouvoir politique, et coexisterait à la démocratie politique, était sur le point de faire des travailleurs sa chose. Mais il fallait d'abord les mater. Car, tout comme le prévoyait Tocqueville, la division du travail ne les avait pas encore complètement soumis à cette existence répétitive, subordonnée à ceux qui savent faire fonctionner la machine, qui sont dignes de diriger, qui se connaissent entre eux. Aussi, la leçon devait-elle être dure. Après seulement, l'industrie pourrait se développer en dehors de la politique, mot qui, je le rappelle, signifie gouvernement de la cité.
La mauvaise volonté évidente du "peuple" de Paris à se laisser enrégimenter, n'eut d'égal que son acharnement à se défendre lorsque l'armée envahit Paris. C'était de mauvaise politique, c'était un effort tardif, un gaspillage inutile de sacrifices humains. Peut-être. Mais en tout cas, cela prouve au moins une chose: que personne dans ce "peuple" ne voulut de la prétendue dictature: pas plus de celle du Comité central que de celle du Comité de salut public. En quoi cela démontre-t-il un manque de résolution de ce "peuple" ? Ce n'est pas parce que Delescluze continuait à rêver ses chimériques Jacobins: que Raoul Rigault se prenait pour un dandy chef de bande, ou que Félix Pyat parvint au jour le jour à persuader à quelques esprits faibles de la Commune que le Gouvernement de l'Avenir était instauré: ce n'est pas pour ces têtes vides que les ouvriers, les petites gens, ceux qui vivaient avec trente sous, se battirent.
Et Marx, et le matérialisme historique, la dictature du prolétariat ? Peut-on voir la première ébauche, évoquée par lui, dans la Commune de Paris, d'un gouvernement ouvrier ? Mieux vaut n'y plus penser en ces termes. Marx ne voulut pas cet événement. Il tâcha d'en tirer la leçon, de montrer ce que les travailleurs pouvaient en tirer. La Commune ne fut pas cette ébauche, mais elle ne fut pas le bûcher horrible qu'on donna en spectacle. "Un spectre hante l'Europe -- le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe ont conclu une alliance sacrée pour traquer ce spectre", écrivait Marx, dans Le Manifeste du parti communiste. Il pensait à une "histoire naturelle", dans laquelle le prolétariat était l'acteur central, de nécessité. Car le prolétariat seul, selon lui, pouvait surmonter, par le fait sans précédent qu'à sa complète dépossession de toute richesse, s'ajoutait le rôle central, absolument unique dans la production de la valeur, qui le libérait du stade des croyances, de la vision idéologique du monde. L'illusion des représentations, jusque-là universellement partagée, par les dominants aussi bien que par les opprimés, devait céder, comme un plancher pourri, sous le poids de la vérité même. Le prolétariat devenait une force, non d'idées, mais de fait. La condition de l'affranchissement, la rédemption de la chute, du silence, de l'oppression subie, ce n'était que la prise de conscience de la nécessité de révolutionner le monde.
Marx s'est trompé sur les faits, car il voulut que les récits qu'on lui faisait, les légendes diffusées par la presse en Angleterre, où il était cloîtré, malade, fussent vrais. Mais ce n'était pas de l'aveuglement, c'était le livre du courage. Car, peu importe, au fond, la part de vérité et de mensonge qu'on trouve dans La Guerre Civile en France, l'ouvrage que Marx a écrit, puis réécrit, sur la Commune.
La plus grande mesure prise par la Commune, c'est sa propre existence. Elle oeuvre et agit dans des circonstances d'une difficulté inouïe. Le drapeau rouge, hissé par la Commune de Paris, ne flotte que sur le gouvernement ouvrier de Paris.
Il affirme encore que le peuple n'a pas remis son pouvoir entre les mains des "saltimbanques républicains des classes dirigeantes". C'est un écrit de propagande, mais, à la différence de La Lutte des classes en France ou Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, ce n'est pas une bonne analyse de la réalité, du social-historique, parce que ce n'est pas un reportage. Le même Marx, qui parlait de gouvernement ouvrier, avait écrit à Varlin et à Frankel, les seuls auxquels il savait pouvoir faire confiance. Dans une lettre du 13 mai 1871, il leur écrivit, en français, pour les mettre en garde:
Chers citoyens Frankel et Varlin, [...] j'ai écrit plusieurs centaines de lettres dans votre cause à tous les coins du monde où nous avons des branches. La classe ouvrière était du reste pour la Commune dès son origine. Même les journaux bourgeois de l'Angleterre sont revenus de leur première férocité. Je réussis à y glisser de temps en temps des paragraphes favorables. La Commune semble perdre trop de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles. On voit qu'il y a d'autres influences que celles des ouvriers. Tout cela ne ferait rien si vous aviez du temps pour rattraper le temps perdu. [...] Ainsi, prenez garde !
Prendre garde, pour le présent. Marx songeait à son grand oeuvre: il y avait le destin de l'Internationale Ouvrière, l'idée que les travailleurs du monde entier pourraient bien s'inspirer de l'exemple, l'incroyable de cette guerre pour reprendre Paris aux ouvriers.
De l'autre côté, il écrivit à son ami Kugelmann, dès le 17 avril:
Les canailles bourgeoises de Versailles placèrent les Parisiens devant l'alternative de relever le défi ou de succomber sans combat. Dans le dernier cas, la démoralisation de la classe ouvrière serait un malheur bien plus grand que la perte d'un nombre quelconque de "chefs". Grâce au combat livré par Paris, la lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste et son État capitaliste est entrée dans une nouvelle phase. Mais quelle qu'en soit l'issue, nous avons obtenu un nouveau point de départ d'une importance historique universelle.
C'est assez dire que, selon Marx, la Commune est une brisure, et non un accomplissement. Goethe écrivit qu'avec la canonnade de Valmy, un monde nouveau naissait. Avait-il tort ?
Seule est à rejeter l'aperception téléologique, celle qui croit à une fin dernière. Ce que la Révolution française de 1789 portait en elle, elle ne l'a pas achevé. Cette grande Révolution, qui s'est terminée dans la corruption du Directoire, puis dont les principes ont été rejetés par la dictature de Bonaparte, n'a pas été effacée de l'histoire. En 1796, Gracchus Babeuf avec quelques autres tentèrent de mener à son terme une Révolution, qui eût été la dernière, qui eût à jamais comblé les voeux de tous ceux qui souffrent, rejetés dans le silence et l'oppression. Il échoua, et bien sûr, sa tentative était vouée à l'échec. Elle ne fut pas vaine, car elle reste dans les esprits. Qui peut croire que la Commune de Paris eût pu faire mieux, comme point final de l'exploitation et de l'humiliation ? Elle n'avait aucun projet, elle était née d'un soulèvement d'indignation. Elle fut traitée comme un repaire de brigands, la lie de la société. Même si quelques voix se sont fait entendre pour dire la vérité, elles étaient trop éloignées du Pouvoir. Cet épisode a rendu public et visible la misère d'un monde, où dominent la corruption, la soif de dominer, l'âpreté au gain, la haine envers les vaincus, qui sont pourtant les seuls, par leur défaite même, à incarner ce que Simone Weil nommait "la vraie grandeur".
Mythologie
Et après ? L'Église catholique s'était prononcée par la voix de Pie IX, lorsque le 8 décembre 1864, parut l'encyclique Quanta cura suivie du Syllabus. C'était une suite d'attaques contre la Liberté, la démocratie, le Socialisme, le Progrès. Blanqui ne s'y trompa pas, en écrivant:
C'est une très heureuse idée que le pape a eue là, il ne pouvait mieux faire les affaires de la Révolution. C'est un testament et un suicide, il n'y a qu'un cri là-dessus, et malgré l'arrogante attitude du clergé, je suis convaincu que cette tuile l'a jeté dans le désespoir. Ils font bonne contenance, mais ils doivent se sentir perdus. C'est un changement immense dans les situations respectives. Le catholicisme s'est décuirassé et mis à nu, en armant de pied en cap ses adversaires [...].
Cette Église ne se remit jamais des crimes qu'elle avait bénis, en dépit de ceux qui voulurent la remettre dans la voie de la fraternité, en dépit de l'héroïque simplicité de bien des hommes de son clergé, curés de campagne ou, plus tard, prêtres ouvriers. Rien n'était changé, lorsqu'en 1936 éclata la Guerre d'Espagne: Les Grands Cimetières sous la lune de Georges Bernanos, ce livre seul, ou presque, sauva l'honneur des catholiques, bien mieux que le "catholicisme social" d'Albert de Mun. L'armée, catholique et patriote, ne manqua pas d'un bouton de guêtre lorsque sa hiérarchie, au nom de la patrie, couvrit des faux, pour faire condamner Dreyfus, 24 ans plus tard. Puis Clemenceau refit surface, son heure était arrivée. Après avoir été "premier flic de France", selon ses propres termes, après avoir maté les grèves ouvrières, il "fit la guerre" en 1917-18 et il devint héros national. Quant aux ouvriers, Fernand Pelloutier, l'un des plus célèbres représentants de l'anarcho-syndicalisme, il écrivait:
La section française de l'Internationale dissoute, les révolutionnaires fusillés, envoyés au bagne ou condamnés à l'exil: les clubs dispersés, les réunions interdites: la terreur confinant au plus profond des logis les rares hommes échappés au massacre: telle était la situation du prolétariat au lendemain de la Commune.
L'anarcho-syndicalisme refusa la lutte pour le pouvoir politique, comme elle refusa le jeu des partis. Les ouvriers ne voulurent plus se sacrifier, pour servir les ambitions d'hommes politiques. Ce mouvement de sécession n'eut qu'un temps, il fut happé par le "mouvement ouvrier", qu'incarna Jules Guesde, et le reste finit dans le fracas de quelques bombes, et des "lois scélérates". Ce qui restait de blanquistes entra en religion nationale, du côté de Boulanger, ou pire. Des condamnés s'étaient échappés, tel Rochefort, éternel miraculé, grand hâbleur. D'autres moururent en déportation. Quelques-uns revinrent, comme Louise Michel. Mais une légende tenace était née : celle d'une continuité du "mouvement social". Certains historiens le firent remonter à la Révolution française. Ainsi Daniel Guérin, l'auteur de La Lutte des classes sous la Révolution française, voyait un programme prolétarien dans une révolution bourgeoise. D'autres virent, dans la Commune, la fondation exemplaire de l'État ouvrier. Les Bolcheviks prétendirent s'en inspirer, alors que Marx lui-même, fin 1870, avait mis en garde les ouvriers français, contre les dangers d'une insurrection armée. On sait qu'il réécrivit La Guerre civile en France, en 1872, après que la vérité se fut fait jour pour lui. Mais il était trop tard pour qu'il reniât cet écrit, c'était déjà une pièce de l'histoire que l'on raconte. À sa façon, Georges Sorel tira la leçon. On la trouve principalement dans ses Réflexions sur la violence, dont la première édition est de 1906. Une idée-force se dégage de l'introduction, qu'il écrivit sous forme d'une Lettre à Daniel Halévy, en 1912. La violence révolutionnaire n'a rien à voir avec la conquête de l'État:
La violence prolétarienne change l'aspect de tous les conflits au cours desquels on l'observe; car elle nie la force organisée par la bourgeoisie, et prétend supprimer l'État qui en forme le noyau central. Dans de telles conditions, il n'y a plus aucun moyen de raisonner sur les droits primordiaux des hommes; c'est pourquoi nos socialistes parlementaires, qui sont des enfants de la bourgeoisie et qui ne savent rien en dehors de l'idéologie de l'État, sont tout désorientés quand ils sont en présence de la violence prolétarienne; ils ne peuvent lui appliquer les lieux communs qui leur servent d'ordinaire à parler de la force, et ils voient avec effroi des mouvements qui pourraient aboutir à ruiner les institutions dont ils vivent: avec le syndicalisme révolutionnaire, plus de discours à placer sur la Justice immanente, plus de régime parlementaire à l'usage des Intellectuels; -- c'est l'abomination de la désolation ! Aussi ne faut-il pas s'étonner s'ils parlent de la violence avec tant de colère.
D'où la critique lancée contre les soi-disant socialistes, Viviani en tête, qui n'ont rien compris à la violence prolétarienne:
Que l'on fasse une insurrection lorsqu'on se sent assez solidement organisé pour conquérir l'État, voilà ce que comprennent Viviani et les attachés de son cabinet; mais la violence prolétarienne, qui n'a point un tel but, ne saurait être que folie et une caricature odieuse de la révolte. Faites tout ce que vous voudrez, mais ne cassez pas l'assiette au beurre !
Et, à propos des martyrs, je songe à Duval, à Varlin, à tous ces anonymes, Sorel n'a pas de mots assez durs pour reprendre Ernest Renan, selon qui "on n'est martyr que pour les choses dont on n'est pas bien sûr". Comme l'écrit Sorel, Renan confond les convictions avec les certitudes qui ne sont jamais que le produit d'une pédagogie ressassée, cuistre le plus souvent.
Lénine, en avril 1911, publia un texte, dans le Rabotchaïa Gazéta (Journal Ouvrier), où l'on peut lire:
Dans une période normale de l'histoire, une république démocratique bourgeoise aurait facilement résolu les problèmes énumérés plus haut (je précise: guerre, ruines, chômage...). Mais quand la bourgeoisie s'y refuse, c'est le prolétariat qui résout ces problèmes violemment par une révolution, et la Commune en était une.
Nous ne discuterons pas ici de l'opportunisme de Lénine, ni de ses revirements, là n'est pas l'objet de ce livre (7). Bonaparte fut opportuniste, il conquit l'État : que demande-t-on de plus à un tel homme ? En revanche, il faut redire que la Commune a servi de caution, de monument aux Morts autant que de Bible, et Maurice Thorez pouvait écrire dans Fils du peuple:
La Révolution (russe) a repris et continué l'oeuvre ébauchée par les héroïques pionniers de 1871. Elle a bâti sur un sixième du globe une Commune victorieuse.
La Commune servit de précédent, comme lorsque le Quinto, régiment formé par le Parti communiste espagnol, lança le slogan "Madrid, le Verdun de l'Espagne", quand les franquistes attaquèrent la ville, à la suite du coup d'État des généraux. Défendre une capitale quand on a laissé occuper le pays, refusant d'armer les ouvriers à temps. C'est le mot d'ordre de la Commune, c'est-à-dire plutôt s'enterrer sous les ruines que se rendre. Elle a servi de justificatif, aussi, et le Mur des Fédérés, à l'instar d'autres murs, a servi à bien des lamentations.
------------
Notes
1) Eugène Pelletan, membre de ce Gouvernement, a publié un livre pour défendre ce gouvernement et critiquer les méthodes de la commission d'enquête. Son ouvrage est assez verbeux, mais révélateur.
2) Il est nécessaire de se reporter à l'Histoire de la Commune de Georges Bourgin, "Bibliothèque socialiste: numéro 41-42", Paris, Publications de la Société nouvelle de librairie et d'édition, 1907.
3) Par Thiers.
4) Pour ne citer qu'un exemple, on trouve dans La Commune et la Question militaire, textes choisis et présentés par Patrick Kessel, Paris: UGE, 1971, dans l'introduction, cette phrase: "Quant à Lénine, on peut dire que les enseignements qu'il a tirés de la Commune sont multiples: non seulement en élargissant la pensée de Marx et Engels, mais en appliquant concrètement la leçon des erreurs et des insuffisances de cette Commune dont il ne se lasse pas de dire qu'il ne faut pas l'imiter. A tous ces titres la Commune de Paris a été objectivement une victoire du prolétariat international et il ne faut certes pas, de ce point de vue, minimiser son rôle." (p. 10) Mon intention n'est pas d'épiloguer sur l'auteur de ces lignes, qui d'ailleurs met en garde le lecteur contre une répétition de la Commune. Cependant, j'écrivais dans ma thèse d'État en 1973: "Dernier sursaut de la bourgeoisie révolutionnaire française, cette guerre était chargée d'une idéologie pour l'avenir, le mythe de la guerre révolutionnaire, armant le prolétariat pour la guerre nationale. La guerre de la Commune ouvrait la voie à l'aliénation complète du prolétariat, armée de travail, et armée pour la guerre du capital". C'était ma conclusion, reprise telle quelle dans La Ballade du temps passé, guerre et insurrection de Babeuf à la Commune, que je publiai chez Anthropos en 1977. Pourquoi un auteur se cite-t-il, sinon pour se mettre en difficulté ? Dans le cas présent, pour signaler la constance de ses convictions: ce qui n'est pas toujours bon signe. Ici, je prie le lecteur de noter l'immense changement de perspective intervenu depuis les années 70. Querelles bouffonnes aujourd'hui ? Que le lecteur juge en conscience.
5) Bourgin, Op. cit., p. 12, décrit ainsi ces intéressants personnages: "J. Simon, tiède radical, J. Favre, bourgeois haineux du socialisme, J. Grévy, égoïste profiteur, Picard, critique de la législation ouvrière du second Empire." C'est ce qu'il dénomme "la gauche fermée" sous l'Empire. Quand à J. Ferry, Bourgin écrit: "Il n'était qu'un homme d'action, hostile à l'antagonisme des classes, cause, à ses yeux de la réussite du coup d'État, plein de mépris pour les chefs du prolétariat, qui ne sont pour lui qu'une tourbe d'impuissants et d'intrigants, (ainsi qu'il l'écrit à Gambetta)." (p. 13).
6) Cluseret n'inspira guère de sympathie. À l'entendre, lui seul eût été capable de mettre sur pied une armée, s'il n'eût été arrêté. On sait les disputes qu'il eut, particulièrement avec Delescluze, le "vieux jacobin".
7) J'ai tiré cet article de mon livre Sur la Commune, Cerises de sang, L'Harmattan, Paris, 2003.
Copyright © Philippe Riviale / La République des Lettres, Paris, mercredi 04 février 2009. Droits réservés pour tous pays. Toute reproduction totale ou partielle de cet article sur quelque support que ce soit est interdite.
Cliquez ici pour vous abonner à la Lettre d'information gratuite
Google | Twitter | Facebook | Blog | | Fnac | Kobo | iTunes | Amazon
Copyright © Noël Blandin / La République des Lettres, Paris, lundi 22 juin 2015
Siren: 330595539 - Cppap: 74768 - Issn: 1952-4307 - Inpi: 4065633
Catalogue des éditions Noël Blandin | République des Lettres
Éditions Noël Blandin | Livres numériques en librairie
Brève histoire de la République des Lettres
A propos de la République des Lettres
Nous contacter