Immanuel Wallerstein
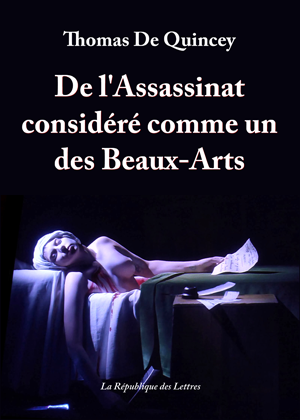
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques
Immanuel Wallerstein L'Universalisme européen, de la colonisation au droit d'ingérence (éditions Demopolis).
L'Universalisme Européen est le livre d'un très jeune homme de 77 ans, un auteur qui a su rester -- ou du moins redevenir -- en toute vraisemblance plus jeune que la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, puisqu'il a pu comme très peu d'entre nous, en cette époque entre toutes de désinformation, de poudre aux yeux, de faux-semblant et de trivialisation, rester sereinement en éveil sur le fil tranchant d'un radical questionnement théorique, politique et intellectuel. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un homme, d'un auteur toujours plus jeune d'esprit, puisqu'au fil de ses écrits -- il a bien publié près d'une trentaine de livres marquants entre 1961 et nos jours - il s'approche toujours davantage de la mise à nu de ce qu'il y a de plus nécessaire, mais aussi de plus inconfortablement lucide, pour tout un chacun (tout citoyen) qui voudrait au temps présent non seulement survivre, mais si possible espérer et continuer de penser activement, de façon politiquement créatrice.
Immanuel Wallerstein est ainsi à 77 ans ce jeune homme qui vit dangereusement sur le tranchant d'un questionnement radicalement à contre-courant nourri de près de cinquante ans de réflexion rigoureuse sur le système-monde où nous vivons -- celui du Capitalist World System considéré dans la perspective de la longue durée -- et qui le fait non seulement avec vigueur, mais dirait-on même, avec le sens croissant d'un certain détachement jubilatoire. En recourant toujours, pour ce faire, à des outils conceptuels macroscopiques hérités de l'historicisme marxiste, mais aussi de Fernand Braudel, sa touche stylistique semble néanmoins à chaque livre se faire plus légère, plus jazzistique, affectant par moments presque le dilettantisme (au sens étymologique) ou la feinte nonchalance. On a ainsi l'impression que ce maître de la Longue Durée et du Macroscopique veut toujours moins le paraître, et se surprendre constamment lui-même en ne se dérobant pas au paradoxe et à l'incertain. Il s'agit là moins d'un des effets d'une longévité intellectuelle exceptionnelle ou de quelque élixir de jouvence, que, au delà de l'outillage conceptuel qu'il a retenu de ses deux grands maîtres (l'accumulation exponentielle du capital, la lutte des classes et le perspectivisme mondial de la longue durée), du fait qu'il a su relever les défis épistémologiques de la nouvelle science de la complexité. Ainsi, grâce à une pensée systémique rajeunie par la théorie du chaos, en avance en cela sur bien des politistes et des penseurs du social des deux côtés de l'atlantique, il a su mettre en chantier cette unification des champs théoriques entre Hard Science et sciences humaines d'une part, et entre pensée scientifique et posture humaniste ou littéraire de l'autre, qui pourrait bien nous valoir les prolégomènes d'une nouvelle culture. Ce faisant, il apparaît, avec la simplicité de l'évidence, comme étant parmi les très rares penseurs de notre temps à continuer à relever le défi -- et à assumer le devoir -- d'un renouvellement constructif et prospectif de notre vision.
Pour y arriver, Immanuel Wallerstein nous confronte à l'inconfort de questionnements de fond, au cours desquels il va nous malmener allégrement à propos de trois socles majeurs du nouveau consensus de notre bienpensance la plus actuelle: les Droits de l'Homme et le droit/devoir d'ingérence, le retour implicite de l'orientalisme sous forme de "westernisation" néo-impériale, la réforme de l'enseignement supérieur mondial et les nouvelles épistémé/formes de production du savoir.
Tout d'abord, en ressuscitant et en réactualisant le débat historique entre Bartholomé de Las Casas et Juan Ginés de Sepulveda sur les Indes d'Amérique au XVIe siècle, Immanuel Wallerstein nous force avec le moins de ménagement possible à nous poser la question de savoir si notre "droitdelhomisme" tant proclamé et le triomphalisme trop souvent creux de notre droit d'ingérence ne sont pas en réalité en passe de devenir -- sinon déjà très largement devenus -- les cache-sexes fatidiques d'un nouveau colonialisme, (voire, pour paraphraser un peu abusivement Clausewitz, "la mise en oeuvre du génocide par d'autres moyens"). Bien sûr, il plane là le danger d'en rester aux ornières du vieux débat binaire entre droits collectifs de classe et droits inaliénables de l'individu, jadis traités trop souvent de "bourgeois" par ceux qui avaient tout avantage eux aussi de s'en dispenser au titre d'un pouvoir personnel. Mais il est désormais impossible de s'aveugler sur la diabolique habilité avec laquelle un système de domination à nouveau en appétit de férocité à grande échelle a su progressivement reprendre au rebond et à son compte l'idéalisme des ONG de la société civile et des activistes des Droits de l'Homme pour tenter de justifier une nouvelle, et catastrophique, ère d'interventionnisme unilatéral.
Face à ce premier questionnement, à son accoutumé, Immanuel Wallerstein n'esquive pas le fond quasi-théologique de la question: existe-t-il quelque chose que l'on pourrait appeler le "droit naturel" ? Si la réponse est négative, comment, au seuil de l'âge planétaire et d'un monde multipolaire, élaborer une communauté vraiment universelle de valeurs qui ne soit pas en fait simplement le reflet plus ou moins habilement dissimulé du particularisme de tel ou tel groupe de dominants, la rhétorique de tel ou tel groupe de puissants ? Autrement dit, comment, au delà des pièges du particularisme de l'universel (du genre: "universel, c'est-à-dire Français"), déboucher sur un "universalisme (véritablement) universel" ? Comment et à travers quel processus de négociation infiniment complexe aboutir plutôt au métissage d'une pluralité d'universalismes, à "un réseau d'universalismes universels" ? Autrement dit encore (en paraphrasant Montesquieu, et pour passer à la deuxième question) : "Comment peut-on être non-orientaliste ?" Comment échapper au piège de la myopie historique qui veut trop souvent que là où nous sommes, ou croyons être les plus universels, nous sommes en réalité -- et souvent avec une atroce injustice -- justement en train d'être les plus aveuglement particularistes ? Comment douter juste assez à temps de l'universalisme de notre particularisme, au nom duquel nous allions nous permettre d'intervenir dans la chair vive de sociétés autres, avec dans la balance des conséquences inexpiables ? Et tout cela, sans succomber au piège diamétralement inverse du cynisme d'un relativisme absolu, d'un universel des particularismes faussement égalitaire, position intenable où convergent actuellement fondamentalismes et extrémismes politiques de tous bords...
Ainsi, on le voit, Immanuel Wallesrtein n'a en rien perdu de l'art désinvolte de poser les questions cruciales. Hors de tout repli identitaire sur le culturalisme, contre un quelconque retour aux traditions et au "choc des civilisations" qui en est l'inséparable corollaire, il se pose ici en véritable héritier des Lumières, au delà de l'européocentrisme et de l'universalisme du particulier, à la recherche de raison et rationalité nouvelles. A l'instar de la nouvelle science, cette nouvelle raison, cette rationalité nouvelle ne sauraient être désormais que paradoxales, complexes et non-linéaires. Elles devront relever de ce que Wallerstein appelle, avec des accents presque "taoistes'" (et l'air de rien faisant un bond titanesque au delà de vint siècles de Métaphysique occidentale), de "la théorie du tiers non-exclus". Elles se devront sans doute aussi avant tout -- mais sans rien renier de la rigueur de leur combat méthodologique -- plus modestes, plus hésitantes et un peu moins triomphalement hégémoniques que leurs illustres devancières.
Et c'est justement là que cette troisième question avec laquelle Immanuel Wallerstein ne va pas non plus nous laisser tranquilles intervient, et "consiste" avec les deux premières. Alors que la "science occidentale" de la modernité conquérante s'est depuis un peu moins d'un siècle hissé au rang de dernier avatar -- particulièrement incontournable et difficile à confronter sans tomber sous les anathèmes de l'obscurantisme et de la régression - du discours universaliste de l'Occident, voilà que cette science en elle-même commence à avoir maille à partir avec la non-linéarité, l'indécidable et la complexité. Alors que le discours scientifique entre en crise et atteint les confins de la certitude généralisable, comment continuer à maintenir artificiellement en place cette opposition (et surtout cette subordination systématique) entre les "deux cultures" (scientifique / humaniste-littéraire) qui continue à constituer le fondement même de nos systèmes d'enseignement supérieur actuels, tout en fournissant les colonnes du temple quasiment inamovibles de son inégalité, de son "échange inégal mondial du savoir" ? Il s'agit là encore d'un questionnement génialement inconvenant, mais combien plus riche en ressources pour notre réflexion et le devenir de nos institutions, à l'heure d'une nouvelle remontée en surface nationale du serpent de mer de la réforme de l'université et des absurdes mea culpa face à un palmarès d'excellence dressée à partir d'internet par deux étudiants doctorants de l'université technologique de Shanghai. Avec ce troisième chapitre, Immanuel Wallerstein nous permet ainsi de commencer à nous poser sérieusement, et comme toujours à partir du fond, non seulement la question convenue (et mille fois psalmodiée) de la concurrence mondiale et de ses moyens (éventuellement tragiquement en tension avec la démocratisation), c'est-à-dire la question du comment, mais aussi celle du pourquoi (avec à la clé et en filigrane l'idée que, si l'on veut vraiment être performant, créateur et producteur de savoir dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait peut-être surtout combler les vielles ornières disciplinaires et dépasser la querelle des "deux cultures", en s'efforçant de trouver les moyens de faire autrement....). Tout cela, bien entendu, sans succomber aux sirènes intéressées et aux impasses débilitantes des nouveaux obscurantismes.
Mais derrière ces trois questions, en arrière-fond il n'y en a qu'une seule: celle des rapports entre pouvoir et discours, entre rhétorique et puissance. Avant tout, bien sûr, celle qui lie historiquement universalisme européen et domination. Immanuel Wallerstein démontre que tant que le système-monde moderne a fonctionné, ces rapports ont été circulaires, l'un vivant de l'autre dans un mélange dynamique, mais instable de parasitisme et de prédation. Tant que le système-monde a maintenu sa dynamique et sa vitesse de croisière, malgré un perpétuel maintien en éveil des facultés critiques, tous les discours ont subi sa contrainte, toutes les rhétoriques ont fini par s'incliner devant son potentiel de récupération/perversion institutionnelle. Puis il y a le moment où nous sommes, où le système étant entré en crise, le pouvoir et le discours justificateur ne pouvent plus du tout coïncider ni se recouvrir, la puissance apparaît dans sa réalité nue, et les discours critiques peuvent devenir réellement opératoires.
Ainsi, à 77 ans, au sommet de sa pensée et de son champ disciplinaire (la Capitalist World-System Theory, qu'il a très largement lui-même contribué à conceptualiser), Immanuel Wallerstein semble rallier, aussi bien du point de vue épistémologique, que sur le plan stylistique, une position qui réussit à être à la fois totalement réaliste et en même temps novatrice. Aussi bien du point de vue de la pensée que de l'écriture, en intégrant dans sa logique l'incertitude et le paradoxe, au delà d'une modernité progressiste défunte, il débouche ainsi sur une posture que l'on pourrait à bon droit qualifier de "post-moderne" (si dans L'Universalisme européen il ne critiquait pas lui-même cette notion ! Mais cette expression, que j'ai déjà employée dans mon introduction de 1998, ne vise pas tant une quelconque "fin des Grands Récits" que plutôt le salutaire retournement critique/dépassement du regard de la Modernité occidentale sur elle-même, dont Wallerstein lui-même est de plus en plus visiblement l'un des plus importants artisans...). Ou peut-être pourrait-on le qualifier mieux encore, de penseur et épistémologue "néo-baroque".
Tout cela, il va sans dire, n'est pas pour faciliter la tâche du traducteur, lequel doit éviter à la fois le Charybde de la trompeuse simplicité, avec le gommage des mises en boucle stylistiques de l'original dans un classicisme académique trop lisse, comme s'il s'agissait d'un livre de vulgarisation, et le Scylla d'un littéralisme trop hirsute qui confinerait à l'illisible. En effet, ce n'est nullement à un résumé ou à un manuel que nous avons affaire, mais plutôt au recueil le plus récent d'une immense méditation encore en chemin, voire à une conversation à bâtons rompus de l'auteur avec lui-même. Ainsi, traduire Immanuel Wallerstein, c'est nécessairement penser avec lui, d'ailleurs la souplesse et l'ouverture informelle de sa stylistique y convie. Développer dans les volutes d'une autre langue les rigoureuses virtualités de sa pensée, qui affectionne le laconisme et la rude suggestion, et à l'occasion ne se refuse pas à l'équivoque, à l'hésitation ou à l'oxymore. Ainsi, c'est toute notre logique binaire qui fait l'objet d'un rappel à l'usine, et qu'il faudrait d'urgence remettre sur le métier. Comme l'avait pressenti depuis longtemps un Arthur Rimbaud, du côté des "humanités" (mais dans la nouvelle perspective qu'annonce Immanuel Wallerstein, pourquoi le poète "horrible travailleur" ne pourrait-il pas être également un épistémologue, c'est-à-dire un shaman des temps à venir ?) en conclusion d'un poème en prose déjà très consciemment non-linéaire (Conte): "La musique savante manque à notre désir". Pour traduire Immanuel Wallerstein, la langue des sciences humaines aurait peut-être elle aussi besoin à nouveau d'un tel constat, d'un tel influx d'inventivité, de souplesse, de capacité d'hybridisation accrue. Pour rendre sa pensée, il faudrait pouvoir même écrire des mots qui n'ont pas droit de cité dans la langue de Descartes, comme par exemple: "l'unidiversalité". Des mots qui mettraient au défi les catégories binaires du langage et leurs effets meurtriers. Il faudrait pouvoir mobiliser des notions à la fois rigoureuses et articulées, mais aussi baroques, paradoxales, post-modernes. Franchir hardiment avec Immanuel Wallerstein le rubicon profond entre les "deux cultures". Pouvoir dire, avec lui, un peuple de peuples, une universalité universelle, une multiplicité d'universalismes, un réseau d'universalismes universels... Pas si facile. Il faudrait pouvoir être à la fois flou et précis, flottant et déterminé, circulaire et décisif, clair et tautologique, modeste et puissant, paradoxal et lumineux. Mettre plus hardiment encore en langue la nouvelle raison, l'épistémé nouvelle...
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter