Julien Gracq
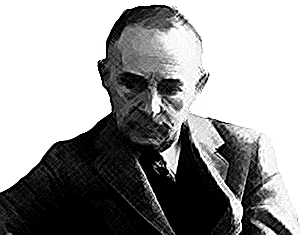
Julien Gracq, pseudonyme de Louis Poirier (Julien en référence à Julien Sorel et Gracq en hommage aux Gracques), est né le 27 juillet 1910 à Saint-Florent-le-Vieil (Maine et Loire).
Issu d'une famille de commerçants, il suit brillamment ses études, d'abord au Lycée de Nantes (ville qu'il décrira longuement dans La Forme d'une ville), puis en Hypokhâgne au lycée Henri IV de Paris où il a notamment pour professeur le philosophe Alain. En 1930, il commence à suivre des cours à l'École libre des Sciences Politiques de Paris tout en intègrant l'École Normale Supérieure, d'où il sort agrégé d'Histoire Géographie en 1934.
Entre-temps, il découvre le surréalisme, le romantisme allemand, l'opéra wagnérien et quelques lieux (Londres, Venise, Brocéliande,..) qui deviendront plus tard de hauts lieux romanesques de son oeuvre. En 1936, après son service militaire, Julien Gracq enseigne l'histoire-héo à Nantes puis à Quimper, tenté en même temps par une carrière universitaire, l'engagement politique (il adhère au Parti Communiste) et la littérature. C'est finalement l'écriture qui l'emporte.
Son premier récit, Au château d'Argol, est refusé en 1938 par Gallimard (NRF) mais publié l'année suivante dans un tirage confidentiel de 150 exemplaires chez le libraire-éditeur José Corti, à qui il confiera ensuite toute sa production littéraire. L'univers gracquien se trouve déjà tout entier dans ce premier récit dont l'intrigue psychologique et sentimentale, inspirée en partie par Les Affinités électives de Goethe, relate la désunion de deux hommes et d'une femme dans un paysage désolé et mystérieux de lande bretonne. Dans un Avis au lecteur, Julien Gracq y rejette le terme de "roman" et revendique à la fois l'héritage de l'hégélianisme et de la légende arthurienne. Loué par André Breton, qu'il rencontre à l'occasion de cette publication, Au château d'Argol passe cependant presque inaperçu.
Mobilisé en juin 1940, Julien Gracq part avec son régiment pour la Lorraine et les Flandres, expérience d'une drôle de guerre qu'il relatera plus tard, en 1958, avec Un balcon en forêt. Fait prisonnier, il est incarcéré dans un stalag de Silésie avant d'être libéré et rapatrié pour raisons de santé en mars 1941. L'année suivante, il trouve un poste d'assistant de géographie à l'Université de Caen et enseigne ensuite dans divers endroits (Amiens, Angers,...) jusqu'à la fin de la guerre.
En 1945, Julien Gracq publie son second roman, Un beau ténébreux, où se ressent toujours l'influence du surréalisme et de la mythologie celtique. Le mythe du Graal est également présent dans une pièce de théâtre écrite parallèlement, Le Roi pêcheur. De cette époque date aussi un recueil de textes poétiques en prose intitulé Liberté grande (1946). Le Roi pêcheur, représentée au Théâtre Montparnasse de Paris en 1949, avec Maria Casarès dans le rôle de Kundry, est mal reçu par la critique qui juge la pièce inactuelle et trop précieuse. Ces commentaires injustes provoquent une réponse de l'écrivain dans un bref mais féroce pamphlet sur les moeurs littéraires, publié en 1950 dans la revue Empédocle. Intitulé La Littérature à l'estomac, le texte stigmatise tout à la fois l'incompétence de la critique, le système du vedettariat des écrivains exhibés comme bêtes de foire et la farce des prix littéraires.
Installé à Paris à partir de 1947, Julien Gracq enseigne dès lors, et jusqu'à sa retraite en 1970, l'histoire-géo au Lycée Claude Bernard — où il aura pour élèves entre autres Jean-Edern Hallier, Jean-René Huguenin ou encore Roger Nimier — tout en poursuivant son oeuvre littéraire. En septembre 1951, l'écrivain connaît le succès avec la publication de son chef-d'oeuvre, Le Rivage des Syrtes, où il évoque des paysages marins envoûtants qui engloutissent inexorablement une sorte de cité vénitienne pourrissante. Le roman reçoit le Prix Goncourt 1951 mais il refuse le prix pour les raisons décrites dans La Littérature à l'estomac.
Après La Route (1963), Julien Gracq se fait critique avec Préférences (1967), puis nouvelliste avec le recueil La Presqu'île (1970). Impressions de voyages et de lectures et hommages à certains écrivains classiques admirés (Balzac, Stendhal, Chateaubriand, Jünger,...) composent ensuite ses principaux livres, écrits dans la veine de Préférences: Lettrines (1967 et 1974), Les Eaux étroites (1976), En lisant, en écrivant (1981), La Forme d'une ville (1985), Autour des sept collines (1988) et Carnets du grand chemin (1992). Ces textes, où l'écrivain exprime sa haute conception de la littérature et sa vocation de géographe, sont plus considérés comme des "vues" instantanées que comme des fictions. Pour Julien Gracq, le langage est l'instrument qui permet "de communier avec le monde, de le comprendre mystiquement".
Au total, Julien Gracq, reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle en dépit de son petit nombre de lecteurs, a publié 19 livres. La plupart, destinés à un public lettré, n'ont pas connu de grands tirages et n'ont jamais été publiés en poche. Homme discret et secret, il vivait retiré depuis de nombreuses années dans son petit village d'Anjou, fuyant les cercles médiatico-littéraires de la capitale.
Son oeuvre exigeante, traduite en de nombreuses langues, est entrée de son vivant dans la collection de la Pléiade (2 tomes, 1989 et 1995) et fait l'objet de nombreux essais littéraires et thèses universitaires. Certaines nouvelles et son roman Un balcon en forêt ont également été adaptés au cinéma.
Julien Gracq est décédé à Angers le 22 décembre 2007, à l'âge de 97 ans.