Sous-Commandant Marcos
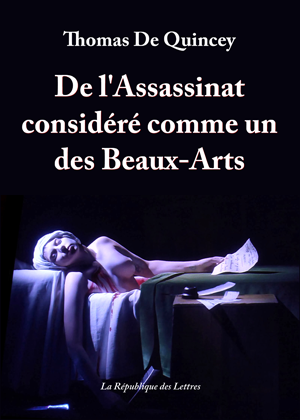
- Thomas De Quincey
De l'Assassinat considéré comme un des Beaux-Arts
Éditions de La République des Lettres
ISBN 978-2-8249-0195-4
Prix : 5 euros
Disponible chez • Google • Fnac • Kobo • Amazon • iTunes
et autres librairies numériques

Le sous-commandant Marcos, leader charismatique de la guerilla du Chiapas, pourrait en fait n'être qu'un imposteur, sans doute génial, mais qui n'en n'a pas moins entraîné les populations indiennes du sud du Mexique dans un conflit long, harassant et inutile. Cette thèse, polémique et choquante pour les inconditionnels du célèbre guerillero masqué qui voient en lui l'ultime héritier du Che Guevara, est exposée dans un livre du correspondant du journal Le Monde au Mexique, Bertrand de La Grange. Le journaliste -- "vexé" par les méthodes du sub envers certains médias conservateurs -- a rédigé tout à la fois une biographie du chef de l'EZLN (Armée Zapatiste de Libération Nationale), une analyse de l'histoire récente du Mexique et, il faut bien le dire, une sorte de "règlement de comptes" intellectuellement malhonnête. Sous-commandant Marcos, la géniale imposture écrit en collaboration avec Maïte Rico, correspondante à Mexico du quotidien espagnol El Pais, annonce dès le titre une volonté de provocation. Depuis l'apparition au Chiapas le 1er janvier 1994 de la guerilla zapatiste, Bertrand de la Grange a enquêté sur le terrain et rencontré la plupart des principaux protagonistes pour découvrir que "beaucoup de questions restaient sans réponses" et que "des nuances s'imposaient". L'auteur dresse de la révolte zapatiste un bilan sans complaisance. "Avec la guerre, écrit-il, les divisions et la pauvreté se sont aggravées au sein des communautés indiennes, toujours dans l'attente des bienfaits qui devaient surgir du sang purificateur et de la mort rédemptrice". Marcos, explique-t-il, a privilégié le spectacle et les techniques modernes de communication et, en mettant en avant sa propre personnalité -- indéniablement séduisante --, a favorisé l'apparition d'un mythe tandis que l'insurrection qu'il dirige "s'est convertie en une géniale imposture, catapultée à l'échelle planétaire par le réseau Internet". Très critique à l'égard de Rafael Guillen -- la véritable identité du guerillero masqué -- le livre ne l'est pas moins vis-à-vis du gouvernement mexicain, coupable lui aussi d'imposture pour avoir tenté de vendre à l'étranger la fausse image d'un pays démocratique. Car, reconnaît de la Grange, "un des mérites de Marcos -- son seul véritable succès selon lui -- est d'avoir ouvert la boîte de Pandore en démasquant le discours officiel, qui avait inventé un pays prospère, démocratique et respectueux des populations autochtones." Dans ce jeu de masques à la mexicaine, il n'y a au bout du compte dit-il qu'un seul perdant : les populations indiennes entraînées dans "un champ de bataille où s'affrontent désormais zapatistes et partisans du PRI (le parti au pouvoir), catholiques et évangélistes, Indiens et Blancs".
Dans un article publié par le quotidien mexicain Reforma l'écrivain péruvien réactionnaire Mario Vargas Llosa s'est félicité de la sortie de ce livre qui démontre, selon lui, "que la rébellion armée zapatiste" n'a pas servi "du tout à améliorer la situation des communautés indiennes" du Chiapas. Selon l'écrivain, avant la rébellion armée, commencée le 1er janvier 1994, "la dictature corrompue du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, au pouvoir depuis 1929), était entrée dans un processus d'affaiblissement". Varga Llosa soutient que cette évolution a été "sérieusement remise en cause par les actions de guérilla et que celles-ci, bien avant les Indiens du Chiapas, ont favorisé le régime du PRI en lui offrant un alibi providentiel pour se présenter comme le garant de la paix et de l'ordre". "Personne ne pouvait soupçonner alors l'évolution particulière que prendrait la première révolution postmoderne, comme l'a appelée Carlos Fuentes, ni la transformation du sous-commandant masqué à la pipe et aux deux montres en une star internationale", estime Vargas Llosa. Cette transformation a été rendue possible "grâce à la frénésie sansationnaliste avide d'exotisme des médias et à la frivolité irresponsable d'un certain progressisme occidental", écrit-il, citant entre autres trois Français: le sociologue Alain Touraine, l'écrivain Régis Debray et l'ancien président François Mitterrand.
 Facebook
Facebook Lettre d'info
Lettre d'info  Twitter
Twitter